Lettre à mon ancien confrère
M. Georges DUHAMEL 1.
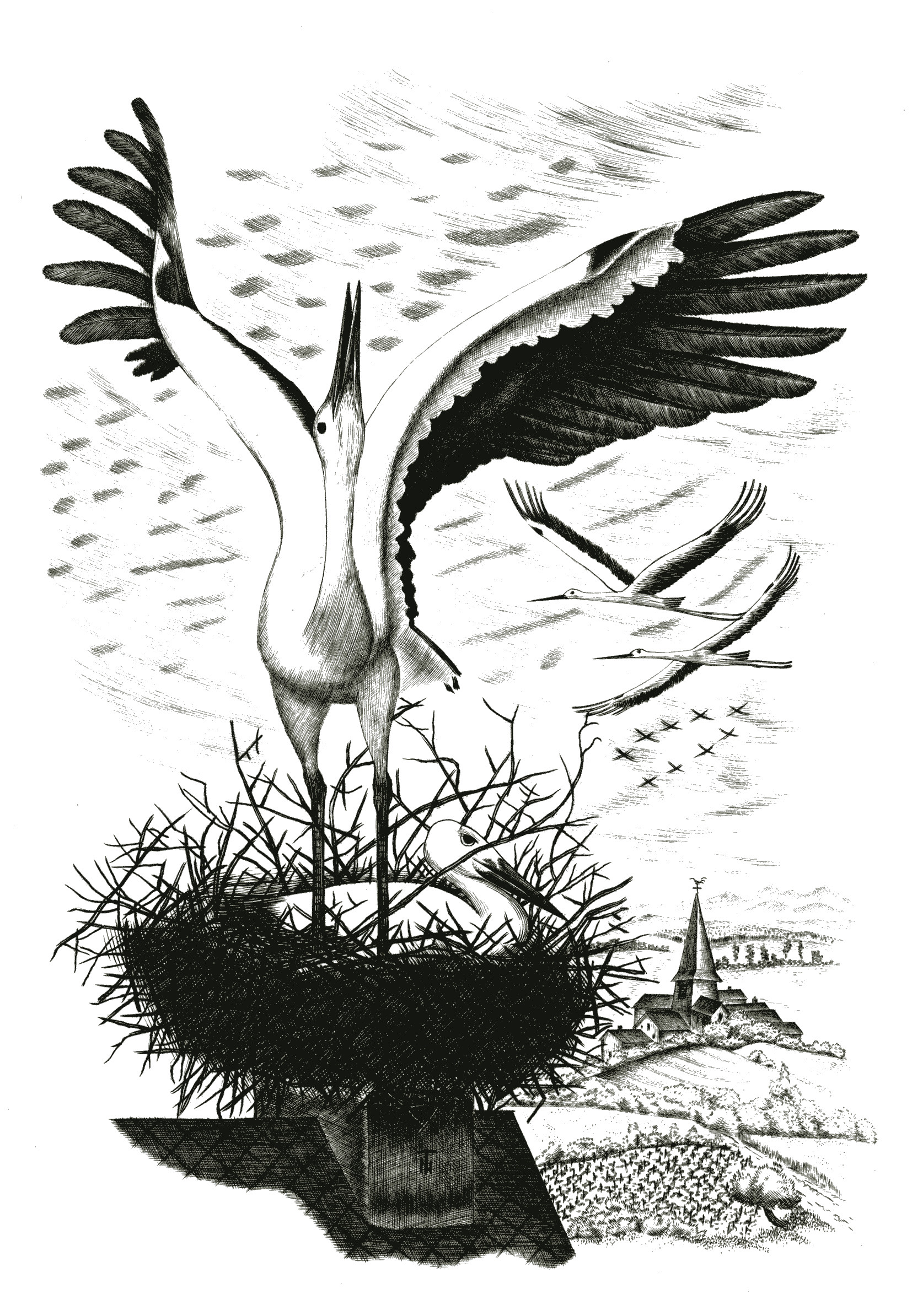
JARRES DE BIOT ou bi-otto ou seize ou deux fois huit, du nom du village provençal où se fabriquèrent les nobles récipients de l'Huile d'olive et du Blé ; le Blé de ma lettre à Georges Duhamel sur les deux langues françaises et l'Huile des dix petits poèmes.
Charles MAURRAS. 2

J'ai pu suivre de loin vos quatre interventions publiques contre la loi des dialectes à l'école, les réponses qui vous ont été faites par un ministre, l'adhésion unanime de l'Académie à vos remontrances, celle 3 du chef de l'État. #
J'arrive trop tard après la bataille. Mes objections à vos critiques paraîtront hardies et prolixes autant que tardives. Mais la question est d'intérêt national et même d'intérêt humain, dans la large mesure où l'avenir du monde dépend du peuple et de l'esprit français. Comme au pape mieux informé, j'en appelle à vos réflexions, à celle de l'Académie. Quant au chef de l'État, ce haut fonctionnaire a dû être ravi de vous préférer à ses père et mère. Avec eux, vous dit-il, il a commencé par parler le dialecte ; mais, peu après, ce qu'il oublie de dire, il a chanté et fait chanter pendant quarante ans, au prolétariat languedocien, la chanson « du passé faisons table rase ». La faute, la voilà. #
Pour moi, croyez que, au surplus, j'enrage d'avoir à vous donner tort, et de me voir presque contraint d'acclamer Marianne IV. Me voilà du même côté que mes ennemis personnels les plus directs, mes vils et perfides emprisonneurs, faux témoins et témoins parjures, ces chefs démocrates-chrétiens que je connais pour destructeurs de l'ordre et de la patrie, simulateurs et exploiteurs de tout ce que j'honore et vénère dans le catholicisme. Le nom de Dieu fait, sur leur langue, figure d'hostie profanée, de même le nom de France ; car ils ont été au premier rang de nos désarmeurs, puis les promoteurs de la guerre de 1939, d'où ont procédé tous nos maux. Cependant, il n'importe ! Sur le point qui nous divise, vous et moi, inimicus M. R. P. sed magis amica veritas, malgré leurs idées haïssables et leurs abominables personnes, un caprice provisoire de la Fortune leur défère l'honneur indu de voir juste sur le rôle du dialecte à l'école. Ils ont raison, je n'y puis rien. #
Je dois dire qu'il est beaucoup de vos principes qui, nous étant communs, devraient nous avoir mis d'accord. Comment différons-nous sur leurs conséquences ? C'est ce que je vous prie de considérer avec moi. #
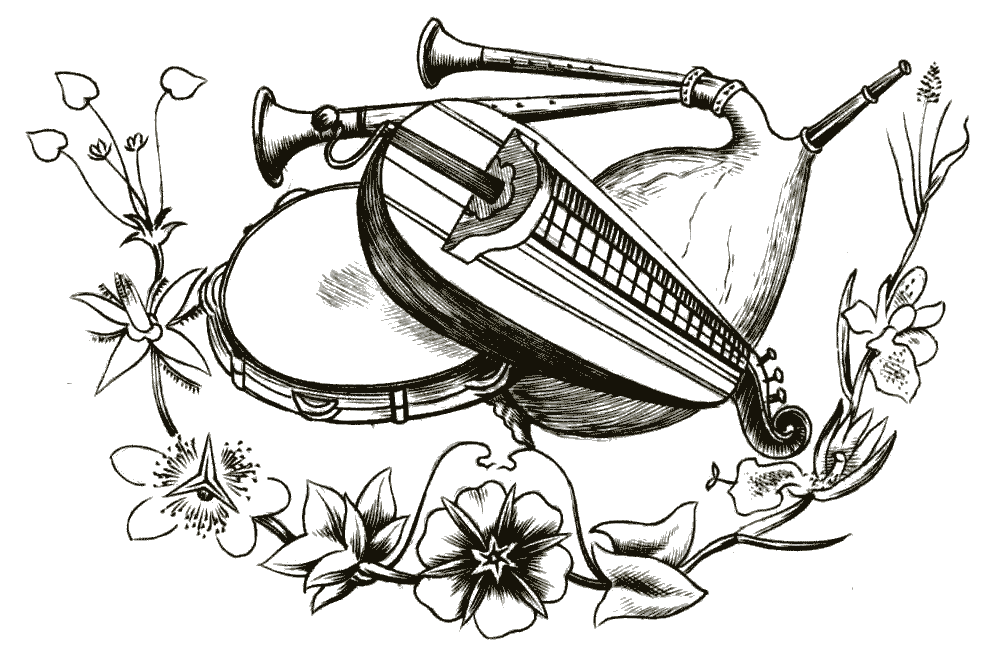
Du babélisme
Et tout d'abord votre cri d'alarme : « Tour de Babel ! » Il n'est rien de plus juste ni de plus opportun. La confusion des esprits, mal du siècle et de l'heure, vient de la confusion des langues. Le dégât est d'autant plus cruel en pays français que notre esprit, notre passé, notre coutume millénaire nous avait plus richement dotés et armés contre ce malheur. Les biens que nous gaspillâmes ayant été plus précieux qu'ailleurs, il devient plus urgent de les recouvrer. #
Mais enfin, ce n'est pas de termes bretons, basques, flamands, alsaciens, provençaux qu'est embrouillée la langue courante. Ce sont tous les idiomes de l'Étranger qui pèsent lourd sur notre usage verbal. Il est des coins particuliers où notre vocabulaire, déménagé, est remplacé par de l'anglais et de l'américain. Le jargon des affaires perd son expression française. La page sportive de nos journaux est anglo-saxonne. On dit que la chose est fatale. Elle ne l'est point, l'expérience en répond. Nos frères canadiens ont eu le courage de traduire, mot pour mot, le répertoire entier des jeux de deux mondes dans leur irréprochable français. Mon collaborateur et ami regretté Lucien Dubech, dont les chroniques sportives firent autorité, imita cet exemple des Français d'Amérique, son initiative fut suivie et réussit même à s'imposer quelque temps. Il n'a manqué à son succès que de la durée de sa propre vie. Mais, touché gravement de l'épouvante qui lui causa la déclaration de la guerre en septembre 1939, il est mort le 17 janvier 1940. Sa course de 1936 aux jeux olympiques de Berlin lui avait fait toucher du doigt l'énorme supériorité militaire ennemie. #
L'œuvre du patriote et du lettré n'est-elle pas à reprendre ? On pourrait la faire figurer dans une manière de programme académique fénelonien. On pourrait aussi l'élargir. Nos pères nous ont appris qu'une science était une langue bien faite ; vous savez mieux que moi ce qu'il y aurait à redire aux suprêmes débordements des néologismes en médecine, et dans certaines disciplines contiguës. Là, c'est le grec qui sévit. Quel grec ! Peut-être, je dis en tremblant, peut-être que, dans un certain nombre de cas désignant d'incontestables nouveautés, un bon vieux substantif flanqué d'honnêtes épithètes ferait bien mieux l'affaire qu'un seul terme de trente-six syllabes. #
C'est une simple question que je me pose. #
Où l'abus me semble certain, c'est sur le plan de l'abstraction métaphysique et du patois de Chanaan que l'on en tire, au grand dam du concret, du vivant, du direct et pour le trouble commun des sens directs comme des intentions latentes. Aux obscurités nées d'un abus des généralités s'ajoutent celles qui procèdent d'un recours excessif à ces spécialités de métier qui seraient si aptes à enrichir et à éclairer la langue s'il était fait avec discernement. Ce n'est pas tout. Dès le temps de Musset, l'imagerie romantique faisait bien voir que « quatre métaphores ont étranglé Barbier 4 ». La profusion de ces figures multipliées jusqu'à la folie rend les asphyxies plus fréquentes. On ne s'entend plus parler, et la parole même échappe à la pensée. Je n'ai malheureusement pas sous la main le curieux rapport où mon ami Henri Boegner montre comment certaines populations de la périphérie parisienne tendent à se satisfaire de vagues onomatopées et même à borner l'expression des émotions les plus diverses dans un lâcher judicieux du mot de Cambronne. Le même rapporte l'espoir, auprès du mal le remède ; dans les mêmes faubourgs, des institutrices primaires habiles et dévouées ont stimulé l'ambition, le goût, l'esprit naturel de leurs petites sauvages, elles en ont tiré de jeunes Parigotes très sensibles à tous les contacts spirituels de l'air français. Ah ! si seulement, du haut en bas des élites de la nation, l'on voulait s'y mettre avec cœur ! L'Académie pourrait prendre l'initiative d'un effort aussi beau. Mais je parle de ce que j'ignore et de ce qui est probablement ou déjà fait ou en bon train. #

Reste la langue politique. Sa révision sérieuse serait d'autant plus nécessaire et bienfaisante que Démos, aujourd'hui roi, sera dieu demain, si l'on s'en tient aux phrases de ses thuriféraires. Il est vrai que personne ne sait plus ce que c'est que la démocratie ; l'O. N. U. et l'U. R. S. S. en ont débattu sans résultat. Les démocraties où le vote est secret porte aux nues leur championnat de la dignité humaine. Celles où le vote est public prétendent être seules à la magnifier. D'égales controverses se sont engagées autour de tous les mots que l'on porte en saint sacrement. Rappelez-vous le sens contraire attaché à l'individualisme parce que individu veut dire, pour les uns, le numéro abstrait partout identique à lui-même (un homme, un vote), et d'autres comprennent par ce mot l'être de chair et d'os, défini par ses propriétés et ses différences, tel celui de Carlyle qui peut être un héros. Mais il ne faudrait pas alors qu'un âne fût un individu, ni le plant de chardon qu'il vient de brouter. Voilà deux exemples pris au hasard. Il y en aurait des milliers, tous propices aux mêmes malentendus massifs. Assurément, un Forum où l'on discute vaut mieux qu'une boucherie l'on se saigne, il est plus sage de parler que de s'assassiner, mais on en vient aux fatalités de l'assassinat quand le « parlage », au lieu de communiquer des idées, n'en tire que des quiproquos. On tremble à penser aux faux sens et aux contre-sens perpétuels que dictent nos textes de circulaires, de règlements, de lois. Des lois de ce style et de ce patois : quelle action voulez-vous qu'elles aient ? On ne saurait exagérer l'effet des puissances et des impuissances du mot, leur valeur inouïe pour le bien et le mal. Leur définition claire ferait partout l'office d'une véritable asepsie. Le plus grand réaliste du siècle écoulé, l'auteur des Ouvriers européens, Frédéric le Play, terminant le quatrième volume de sa Réforme, jugea que le plus sûr acheminement de son rêve de « paix sociale » serait une table alphabétique et la traduction claire des mots sur lesquels ses contemporains (et les nôtres) se prennent aux cheveux. Il jugeait comme vous, monsieur et ancien confrère, que le monde moderne souffre et meurt principalement de « Babel ». #
Mais, outre notre intérêt naturel à ne pas mourir, ni nous laisser mourir, la langue politique française devrait éprouver la très urgente nécessité de faire sa toilette. On va avoir besoin d'elle. Le prodigieux rapprochement des distances va faire désirer au peuple, par-dessus les chauvinismes et leurs rivalités, une langue commune aussi claire que possible tant pour l'interprétation diplomatique des intérêts que pour les messages supérieurs de l'esprit. Quel malheur si nous n'étions pas fin prêts, frais, polis et brillant pour les amphictyonies nouvelles qui nous attendent ! Faute d'avoir bondi hors de ces bornes provisoires, manquerons-nous à la grâce de nos destins ? #
Vous le voyez, Monsieur : sur les dommages positifs que nous cause Babel comme sur ses manques à gagner, je cède tout. Si je maintiens que la violence et le volume des désordres immédiats priment de beaucoup les risques et périls éventuels que vous redoutez de l'enseignement des dialectes à l'école, je ne nie point ces derniers, a priori, et je crois même qu'ils seraient graves s'ils étaient réels. Mais ils ne le sont pas, et leur image chimérique vous détourne de sentir de devoir le bienfait, le progrès, les hautes promesses de cet enseignement. #
Avant de les exposer, un second point d'accord me paraît devoir être touché ici. #
Le législateur à sa place
Il y a quelque chose de choquant, en effet, dans la confection d'une loi de l'État central sur l'enseignement du dialecte local. #
Opérations de foi babélique, la forme de cette loi, son objet. #
Elle ne devrait pas être loi d'État. Ni ce qu'elle touche, toucher l'État. #
L'État national doit avoir le haut contrôle des écoles primaires, non leur gestion. Le programme de cet enseignement ressortit au village, aux villes, provinces et pays. On s'est moqué avec raison du ministre impérial qui récemment disait : « à cette heure tous les lycéens de France font un thème grec. » Le geste n'est pas moins ridicule pour marquer que tous nos écoliers au même moment, écrivent une dictée. #
Le préteur, du haut tribunal de sa capitale, ne s'englue pas dans ces minuties. #
Seulement, c'est un fait patent : aujourd'hui, le préteur est un personnage collectif, anonyme et irresponsable, qui, des hauteurs de l'État central, se mêle exactement de tout. Sur les petites choses et sur les grandes choses, l'égal débordement de son incapacité et les inondations de son incompétence ne peuvent être arrêtées que d'une manière : il lui faudra promulguer la loi d'État qui le remette dans son lit. Voyez, tel qu'il se manifeste, l'admirable mouvement de réaction des municipalités et conseils généraux contre les abus fiscaux, les folies du dirigisme économique, l'absurde déluge des formalités et les paperasseries des bureaux. C'est à l'État que l'on recourt pour se délivrer de l'État. Il a fait des lois d'uniformité centralisatrice, force est bien de lui demander d'autres lois pour les surmonter. #
Ces lois réparatrices seront-elles faites ? Nous en sommes réduits pour la plupart d'entre elles à un pieux désir. Mais en voilà une, toute petite, dont il vient d'accoucher. Elle est là. C'est bien le moins que d'en exprimer notre grand merci. #
Le grand mal vient d'ailleurs
Il convient ici d'attirer toute votre attention sur certains caractères peu connus de notre centralisation et du mouvement qui la contredit. Mon propos menace d'être long. Peut-être conduira-t-il à nous mieux comprendre. #
En paroles, le mouvement décentralisateur est ancien. Il a commencé, à peu près, avec ce qu'il combat. Au XIXe siècle, presque tous les libéraux, radicaux et socialistes, tous les démocrates, tous les anarchistes, tous les conservateurs ont adhéré à quelque formule de décentralisation. Mais la centralisation effective a toujours gagné sans arrêt. Aux premières années du XXe siècle, dans une brochure intitulée La République et la Décentralisation signée de nos deux noms, je faisais prévoir à M. Paul-Boncour 5, qui en témoigne dans ses Mémoires, que ni son parti, ni l'autre n'aboutirait à rien de cet ordre-là, et je disais pourquoi. En effet, jusqu'en 1939, on n'a pas cessé de serrer la vis, et il en convient. Mais, a-t-il écrit, vers 1942 ou 1943, on va voir ce que l'on va voir. De 1914 à 1950, on a vu. On a vu la plus complète aggravation de l'étatisme jacobin, consulaire et napoléonien. Si donc on excepte les quatre années de la rémission maréchalienne où la présence de l'Étranger entravait, masquait, viciait des réformes heureuses, on n'aperçoit de 1789 à 1950 qu'une véritable mesure de décentralisation administrative viable et tangible : la suppression des sous-préfets de chefs-lieux de département par le roi Louis XVIII. #
Ce n'est pas d'hier ! Cependant le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone, l'avion tendaient à contracter et à ratatiner nos départements que voilà réduits aux dimensions morales d'un canton de l'An VIII, et j'entends dire que l'hélicoptère exige le cadre spacieux de la région. Mais la région est la première institution maréchalienne que la démocratie, restaurée en 1944, se soit hâtée d'abolir. Elle a établi quelques préfets régionaux, mais en prenant ses mesures pour que la région ne soit pas. #
La cause de l'échec des décentralisations est donc bien celle que je disais à M. Paul-Boncour. Elle tient essentiellement à notre régime politique. Il ne faut pas se laisser conter des histoires. La centralisation n'a pas résulté de ce que l'on va plus vite de Paris à Marseille et que l'on communique plus facilement de Paris à Strasbourg. Des pays beaucoup moins centralisés que le nôtre sont autant ou plus dotés que le nôtre des applications industrielles de la science. Et s'il arrive qu'en ces mêmes pays, la Suisse ou l'Amérique, un puissant reliquat de vie locale ait subi des diminutions relativement récentes, c'est par l'action du même facteur politique dont l'opération est limpide chez nous : le Gouvernement des partis électifs, leur démocratie de moins en moins tempérée centralisent fatalement. #
Schématiquement, les partis ne se maintiennent au pouvoir qu'en multipliant les fonctions et les fonctionnaires chargés d'assurer leur réélection. Leurs intentions et leurs programmes de décentralisation n'y peuvent rien. Leur volonté de vivre et de durer est la plus forte, elle les oblige à une politique d'intérêts et de salut qui n'a rien à voir avec l'intérêt public et le salut public, c'est de leur salut propre qu'ils se soucient préalablement. C'est ainsi que depuis 1787, en Amérique, en 1848, en Suisse, par les progrès de la démocratie, les villes, cantons, États ont dû perdre du terrain, la confédération centrale en gagner. Chez nous, les révolutions ont facilité le même courant, en brisant tour à tour chacun des freins opposés à la volonté électorale : les monarchies, les aristocraties, les corps militaires et judiciaires dont le dernier sursaut fut liquidé en 1899 par la révolution dreyfusienne, à laquelle succéda un grand élan d'étatisme pédagogique et fiscal. En vain M. Paul-Boncour et ses amis ont-ils pu devenir ministres, la mécanique des partis a fonctionné inflexiblement. On a inscrit dans la Constitution de 1946 de nouveaux textes d'autonomie administrative : il est facile de prévoir que le sacrifice des préfectures et sous-préfectures, s'il est consommé en l'honneur du pouvoir électif, sera soldé à coup sûr par une action plus forte et plus efficace des partis centralisateurs qui, de Paris, mèneront tout de plus en plus. #
Le spectacle du même mécanisme nous a été donné dans l'Allemagne de 1919 et de 1945. L'introduction du parlementarisme démocratique et du gouvernement des partis chez nos vaincus y a reconstitué, en l'aggravant, l'hyper-centralisation bismarckienne. L'intérêt des partis compétiteurs a centralisé et unifié, malgré nos vertueux efforts en faveur des « pays » et de leur autonomie fédérale. Les bonnes volontés des Allemagnes réelles n'ont rien pu contre la loi vitale de leur pays légal, et des partis artificiels organisés à notre voix : par deux fois à un quart de siècle de distance, les paysans bavarois ont répété en vain leur loss von Berlin. L'importation de la machine démocratique annulait ces spontanéités. L'ancien autonomiste rhénan Adenauer a bien compris cela. Nous aurions dû répudier cette politique enfantine, ou prévoir l'automatisme de son retour à la grande Allemagne, alors même qu'elle reste coupée en deux. L'esprit de la démocratie peut bien liquéfier les nations qui sont déjà faites. Le mouvement matériel de ses administrations centralise les peuples qui se font. #
Mais il y a un fait nouveau en France. C'est l'explosion du mécontentement des municipalités et des départements, des maires des villages et des villes, des conseillers généraux qui sont membres du Conseil de la République. Aux intérêts de parti s'opposent ces intérêts du pays réel. C'est la vie de ces intérêts qui souffre, se débat et crie. C'est elle qui ne veut pas mourir. Peut-être sera-t-elle assez puissante pour exiger et obtenir des remèdes réels, des concessions substantielles sur le trop perçu des administrations et des bureaucraties de l'État. Peut-être parce qu'il s'agit de réalités tangibles, celles que leur concentration abusive gaspille et dissipe, celles que sauverait ou que reconstituerait une redistribution judicieuse, peut-être, dis-je, ce curieux mouvement spontané va-t-il déterminer le retour des choses dont on désespérait et qui rouvrirait les portes de l'avenir. Mais attention ! Les partis sont là, ils veillent. Ils savent leur métier, qui n'est que de tromper et de forger des appareils de tromperie ; je ne les crois pas incapables d'inventer et d'adapter les masques et les costumes à la faveur desquels ils sauront cacher, accentuer, perpétuer le douloureux désordre étatiste et étatiseur. Si le malaise du pays est profond, il est aveugle. Sa réaction n'a d'autres guides que les vues très générales et les très généreux sentiments qui ne sont accessibles qu'à une rare élite. Au contraire, la mise en défense de la destruction est inspirée et illuminée par l'intérêt majeur des bandes qui en vivent et qui ne vivent de rien d'autre. Entre le dernier et le premier, la partie paraît inégale. #
Cependant, si « ma » loi, une des rares lois politiques dont la découverte m'appartient personnellement, la loi que toute démocratie est centralisatrice, si cette loi continue à se vérifier et que j'aie le malheur d'avoir toujours raison contre M. Paul-Boncour, ce régime de partis électifs sur notre malheureuse patrie continuera d'y déchaîner des phénomènes d'inertie et de sclérose, de paralysie et d'ataxie, de délire et de convulsions destinés à passer tout ce que nous avons vu en ce genre. Alors, où va la France ? Où allons-nous ? #
Un autre espoir pourrait venir doubler le premier si, parallèlement à la révolte naturelle des intérêts sociaux, il se produisait dans l'esprit public un élan d'intelligence et de réflexion désintéressée et que, par conséquent, la révolte instinctive reçût des directions d'ordre cérébral, nettes et claires, comme pour compenser la cruelle lucidité viscérale inhérente à la défense des partis profiteurs ; en un mot s'il resurgissait une doctrine politique ferme et sensée, servie par de bons citoyens, unis et hardis. J'ai déjà vu cela, qui peut se retrouver. Mais cet espoir no 2 ne prévoit qu'une simple influence. Pour faire ou pour défaire des lois dynamiques, il faut un organe matériel, tel que fut le pouvoir non élu, mais légitime et légal, du maréchal Pétain, ou tel encore que serait l'institution d'une Monarchie plus forte que les factions coalisées. Nous y allons sans doute. Nous n'y sommes pas. #
Un bon symptôme, c'est le murmure ou même l'articulation nette d'un mot chargé d'avenir et qui, bien compris, serait un bon guide. Mais on a déjà réussi à le dévier. #
C'est le mot Fédération. #
Fédération est déjà pris dans le sens d'une construction d'États-Unis d'Europe qui ne peut aboutir qu'à la Néphélococcygie 6 de la vieille Athènes. Cette cité des Coucous et des Nuées a déjà débordé le cadre excellent d'une solide coalition militaire, d'une Symmachie qu'il fallait mettre sur pied à la façon de celles qui vainquirent tour à tour Xerxès, Napoléon, Guillaume II, Hitler, et que doit reconstituer de lui-même le stalinisme de Moscou. Au lieu de perfectionner contre lui cette arme de défense, l'équipement et l'armement, on a entrepris la copie juridique de l'Union américaine, et l'on est en train d'instituer des joutes parlementaires, des compétitions ministérielles et présidentielles, comme pour épuiser en vanités tapageuses et tumultueuses les peuples déjà dévorés du morbus democraticus 7, alors que d'autres peuples sanglants, durs et avides viendront les désorganiser et les absorber ; comme a été défaite en vue d'une union européenne la fédération habsbourgeoise, ainsi seront dilacérés entre leurs voisins les précieux composés belge et helvétique. On ne pense pas à cela. Ça se fera sans qu'on y pense, le plus logiquement du monde, sur la simple aspiration de ces deux unités imaginaires, l'Europe ou l'Occident. Autrement dit : primauté de la barbarie. Ce fédéralisme à l'enseigne strasbourgeoise va réaliser le commun postulat de Guillaume II et d'Hitler, il mettra l'Europe sous la direction des plus industrieux et des plus nombreux de ses peuples. Un concours égalitaire est ouvert entre ceux-ci, mais à un très mauvais moment pour nous, qui en sommes l'enjeu. Il est impossible de nous dissimuler que les chiffres posés à la date de 1950 nous désignent comme perdants ; eux étant plus de 80 millions, nous un peu plus de 40 ! Il était facile de voir dès 1939 la même inégalité funeste depuis que nous avions abandonné en 1923, en 1930, en 1935, nos supériorités de positions militaires sur la Ruhr, le Rhin et la Sarre ; aujourd'hui, l'on veut abandonner cette autre supériorité de position, la dernière, hélas ! qui s'appelle nos tarifs douaniers et nos frontières politiques. Celle-ci abolie, la loi des vases communicants va jouer de façon pacifique et terrible pour rétablir « le juste » équilibre des populations, l'immense espace vital convoité par les pangermanistes et par les nazis leur sera adjugé sans combat à même notre métropole, sans parler du reste de l'empire. Nous n'aurions pas perdu des millions d'hommes aux deux dernières guerres si nous nous étions alors déclarés prêts aux concessions qu'organisent les Schumann, les Paul Reynaud et consorts. L'Empereur et le Führer les auraient acceptées avec un grand merci. Il est vrai que ces sacrifices monstrueux déchaîneront une autre guerre, civile et sociale, celle-là, parce qu'à tout bout de champ français, à tout seuil de maison française, se heurtera la longue file des vingt millions de Germains qui, en excédent sur leur territoire, viendront exiger sur le nôtre d'être abrités, nourris, instruits à nos dépens, non sans nous proposer de nous montrer comment mieux exploiter notre antique bien de famille. En vain répondrons-nous que nous serons déjà bien embarrassés pour loger, vêtir, nourrir les quelques centaines de milliers de gosses que nous a valus notre récente repopulation. Eux, voudront s'installer. Nous, résister. On se battra. #
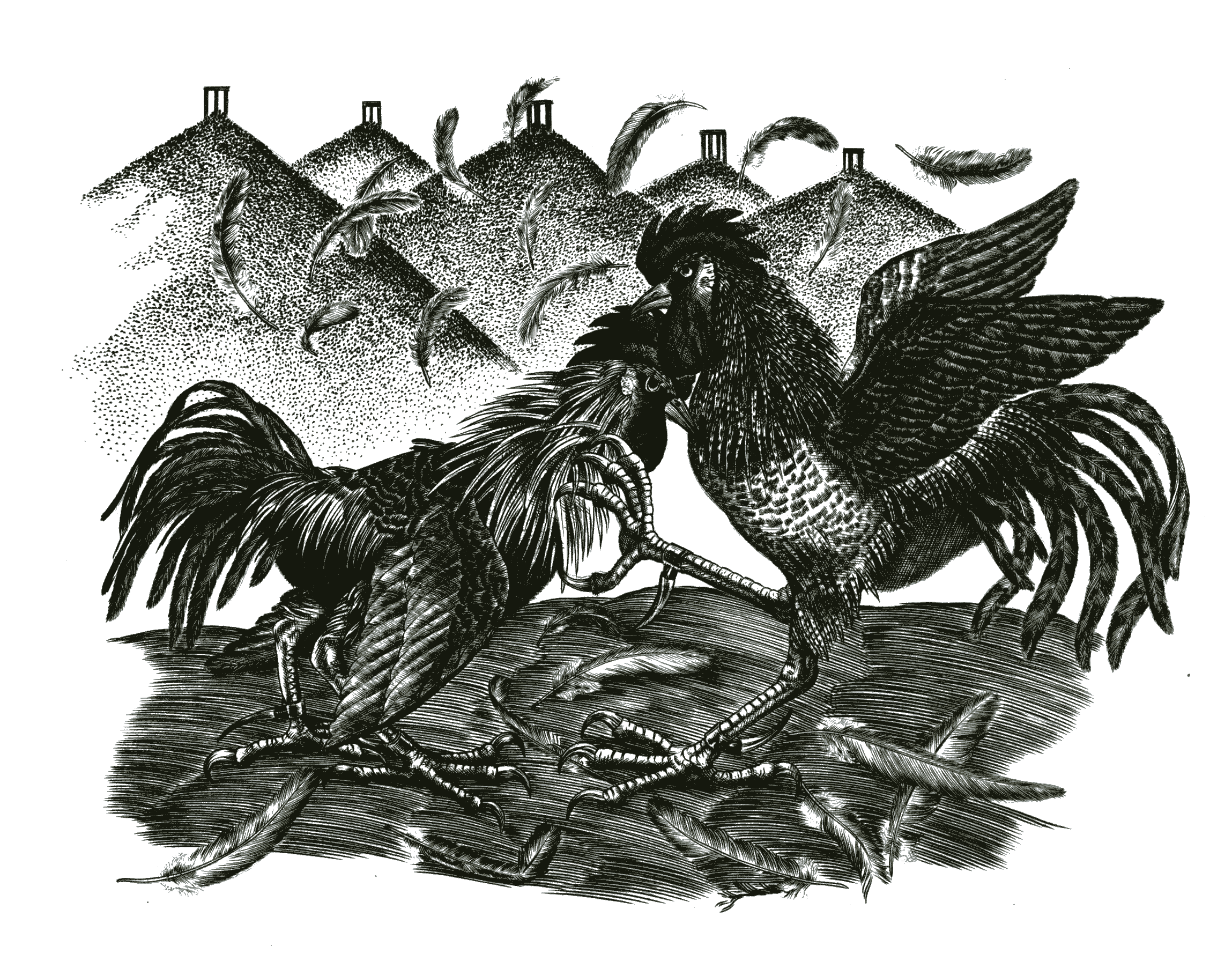
Ce sera une de ces guerres intérieures où excellent les Fédérations, témoin la guerre du Sonderbund en Suisse, la guerre de Sécession en Amérique, les expéditions punitives du Reich fédéral de Weimar contre le Rhin, la Bavière, le Hanovre, la Saxe et même Berlin. Mais celle qui va suivre notre déluge de pénétrants pacifiques sera nécessairement plus violente en raison de l'étendue et de la valeur des proies disputées. Ce sera la pire catastrophe de notre Histoire. #
« Pire que 1940 ? #
— Oui, pire. »#
Et faite en somme des mêmes mains, Reynaud, Churchill, etc. J'ai eu le chagrin de prédire l'autre. Pour la prochaine, j'ai le droit d'ajouter que la présente intrigue fédéraliste et sa manœuvre de Strasbourg est synonyme de trahison. On objecte : l'Amérique le veut. Mais les Américains ne sont pas des brutes. Il doit être aisé de faire entendre à ce peuple ami, ouvert et généreux, que les Français ne peuvent pas vouloir le suicide de la France : fut-ce payé en milliards de dollars, c'est trop cher. #
Le véritable fédéralisme est tout autre. Il est même l'inverse. Il ne court pas la prétentaine des nuées extérieures, il renouvelle, en en relâchant la fausse rigueur, les liaisons internes de la patrie. #
Fausse rigueur, ai-je dit de ces liaisons purement administratives, et j'en ai bien le droit. Preuve : elles ont été peu résistantes aux poussées de l'Étranger ennemi. Elles l'ont laissé venir au cœur de la Champagne en 1792, l'invasion a recommencé l'année suivante et, quand les ressources de la vieille France eurent été épuisées par vingt ans de guerre aussi pleins de gloire que purs de profit, Paris a été pénétré deux fois, 1814, 1815. Cinquante ans plus tard, l'empire centralisé d'un autre Napoléon a été battu par une confédération de tribus germaniques présidées par le roitelet de Berlin. Nos dix départements occupés de 1914 à 1918, puis la submersion de 1940, suivie des ruées et des ravages en tous sens de 1944 sans compter tout le sang et tout le pus d'une guerre civile, établissent suffisamment que l'asservissement du citoyen à la bureaucratie est une solution bâtarde qui n'a pas raffermi la cohérence du corps ni de l'esprit français. Il y a mieux à faire, et certainement autre chose. Le retour à « la constitution fédérative de l'ancienne France 8 » réorganiserait la vie locale d'abord et, de proche en proche, les organes intermédiaires de la vie nationale. #
Il faudrait recommencer par le commencement, par reprendre aux fondations, se souvenir d'abord du principe directeur qui est celui de la préséance et de la précellence de la plus petite unité. #
Principe bien oublié, bien méconnu, c'est le b. a. ba de toute politique réelle. Le hasard d'une même lecture au cours d'un bel après-midi de prison me l'a fait rencontrer par trois fois, coup sur coup, en compulsant des documents pontificaux, en relisant La République de Platon et en me mettant en règle avec le livre précieux que venait de publier ou de rééditer M. Philippe Etter, l'ancien président de la République helvétique. La formule de ce dernier était d'ailleurs la plus clairement motivée. L'entité sociale élémentaire, disait-il, la première et la plus petite de toutes, doit assumer toutes les fonctions dont elle est capable, absolument toutes et c'est seulement quand elle a donné au maximum le plein de ses pouvoirs qu'il doit être fait appel à l'entité sociale supérieure. Tout ce que peut la Commune doit être fait par la Commune seule. C'est après l'épuisement de ses compétences et de ses facilités que le Canton devra être saisi de son appel au secours. Et c'est après que le Canton se sera tout à fait consumé à la tâche, que lui est dû l'appoint de la Confédération ou de la Nation. À chaque cellule, à chaque fibre, à chaque organe, la nature des choses chantera à voix haute le Quantum potes, tantum aude 9 de l'hymne angélique, chacun y trouvera la conscience, la clairvoyance, la gloire de son action propre, de son être distinct et de son esprit singulier. Tout au contraire, les récipients démesurément élargis, les cuves immenses de l'État totalitaire, le tout-à-l'égout de son étatisme moral et matériel juxtapose pêle-mêle et confond tous les éléments de l'énergie nationale ; ici, tout au contraire, on les retient selon leurs affinités dans leurs compartiments naturels, ils se différencient et se perfectionnent en se filtrant et en se distillant par les degrés d'une hiérarchie ascendante. Il en est de même pour les ressources. Elles ne se précipitent pas dans une caisse unique pour être bues et dévorées comme l'eau du désert. On les laisse répandre et se diviser sur place, dans de petits trésors bien surveillés, sous le contrôle de qui les utilise et de qui les produit, contribuables et usagers. #
M. Etter inscrit au bas de son trinôme l'unité communale. Peut-être faudrait-il prendre la chose à un niveau inférieur encore, celui du foyer, et conférer aux chefs de ces foyers une sorte de grade et de dignité civique, les habilitant à certaines fonctions judiciaires et financières auxquelles ils ne sont pas impropres : le vote plural leur serait utilement conféré, ils auraient autant de suffrages que d'enfants, et peut-être conviendrait-il d'ajouter des votes supplémentaires pour constater leur ancienneté dans le métier, dans le pays, et encore le degré d'instruction théorique et d'activité pratique. On ferait ainsi servir cet enrichissement du régime électif à son amendement, et la démocratie étendue mais tirée de sa sauvage uniformité se résoudrait en aristocratie rationnelle. #
Les documents pontificaux de Léon XIII, Pie XI et Pie XII me semblaient aussi converger en ce sens : le foyer, la maison, le couple. Quant au divin Platon, dont la Cité, comme toute cité antique, n'est pas très populeuse, il a bien soin de stipuler à la base de l'État un simple effectif de trente-cinq couples qu'il a chargés de l'immédiat : travaux, jeux, fêtes, mariages, relations du premier degré. Là pèsent les responsabilités fondamentales, qui ne sont allégées par en-haut que dans la proportion stricte du besoin urgent. #
Après ces théoriciens, écoutons le témoignage d'une expérience française en 1944–1949. Cette France, furieusement et inutilement bombardée, ne se reconstruit donc pas ? Un officiel de l'Épuration, qui en fut le ministre, a même dit un jour que les nouvelles maisons s'useront plus vite qu'on ne relèvera les anciennes. Certes, l'initiative civique, personnelle et collective, a fait sur tel ou tel point du pays plus d'une merveille. L'industrie privée s'est distinguée aussi. Mais quelle disproportion de ces remèdes au mal ! Avec ses lois générales, ses caisses plus générales encore, et sa grande diablesse d'administration, ce que l'on a obtenu le plus en ces cinq ans a été inertie et malfaçon. Tout serait relevé depuis longtemps si la structure administrative et toute sa paperasserie ne s'opposaient à la division naturelle du travail qui serait partie des cellules inférieures, fraternellement réunies, aidées, secondées, promues par les groupes supérieurs, dans la seule mesure des nécessités et des convenances. Il se faut entr'aider, c'est la loi de nature, mais l'entr'aide imposée, l'entr'aide superflue fait plus de mal que de bien. En appauvrissant, en desséchant, en endormant les unités élémentaires, la centralisation a pris le problème à l'envers et par le plus haut bout, en vue de tout résoudre ensemble, et d'aboutir à tout manquer. Ce désordre est particulièrement injuste pour ceux qui vivent sans toit ou que cette carence laisse à la porte de la vie. Ce n'est cependant qu'un désordre entre bien d'autres, depuis que les bureaux s'acharnent à capter, en la refoulant, la vraie vie du pays. Au premier signe de cet engourdissement général, on s'est aperçu que le citoyen tournait à l'administré, selon le mot du comte de Chambord. Le voilà devenu un assujetti, puis un employé. La dégradation qui l'atteint dans sa personne et dans sa race n'en donne pas plus de vigueur à la société, qui ne prospère pas ; il a bien fallu s'avouer le vaste retard économique, la dépression et la régression sociales qui s'observent depuis quarante ans dans notre pays. #
Ce que la centralisation avait d'utile et de bienfaisant s'est perdu faute d'une matière humaine à centraliser suffisamment riche, active et productive. Le Français d'élite garde de hautes aptitudes, qu'il a su montrer ici et là, dans la Métropole et l'Empire, avec un éclat exceptionnel. Il reste le Français moyen, qu'on a abruti ou qu'on a laissé s'abrutir. Il faut lui rendre l'air, l'espace, le mouvement, le soin de juger et de choisir, c'est-à-dire, dans la mesure du possible et par degrés, le gouvernement de toutes les choses qui le pressent et qui l'entourent, parce qu'il les connaît ou peut les connaître aisément à moins d'être un malade, un criminel, ou un nigaud, ce qui en général se sait, car on y remédie de toute façon ; entre la Commune et le foyer, le voisinage veille et, un peu plus loin, le quartier ou, dans la grande ville, l'immeuble ou le pâté de maisons. Tous ces points de départ existant, cela peut s'organiser. #
Le véritable fédéralisme, constructeur et non destructeur, ne s'arrête pas à la restauration de la plus petite unité ; il s'élève de là à des unités supérieures dans lesquelles le canton, l'arrondissement (ancien district de l'An II) formaient à l'unité municipale le premier contrefort, le plus proche, afin qu'il soit le plus efficace. Toutes les affaires non solubles dans la Commune devraient pouvoir être réglées au chef-lieu le plus voisin, exception faite pour ce qui est d'un domaine extrêmement élevé. On n'a pas réussi à supprimer les sous-préfectures, puisqu'il s'agit de trois cents petites villes que leur déchéance administrative risquerait de frapper gravement ; on verrait disparaître à meilleur compte le rang administratif des chefs-lieux de département qui ne seraient pas promus têtes de provinces. Soixante-dix à soixante-quinze villes ont d'autres cordes à leur arc, et le départ de quelques bureaux préfectoraux serait peut-être même un stimulant pour elles, plutôt qu'une dégradation ; elles pourraient relever leur activité propre au service de leurs arrondissements respectifs, leur imprimer une direction plus vive au point de vue agricole et industriel, et leurs assemblées locales recouvreraient valeur et influence par un contact plus étroit des intérêts et des autorités. Les conseils d'arrondissement, si ternes, si pâles, si vains aujourd'hui, deviendraient l'antichambre vivante des assemblées provinciales ; avec une permanence (ou une fréquence supérieure), sans doute, elles prépareraient activement les sessions des grands États régionaux. Les assemblées des deux derniers types seraient naturellement soustraites (comme les conseils communaux) à la loi brutale du Nombre, par la représentation née des libres activités économiques ou morales propres à chaque cercle, au prorata de l'importance et de l'ancienneté, et aussi par l'action prépondérante de l'élite, au moyen du vote plural de tous les citoyens. Dans les deux cas, on dirait aux numéros deux et trois « Fais d'abord tout ce que tu peux, réunis toutes tes facultés et tes capacités quantum potes… » Il ne faudrait pas craindre d'appeler les uns et les autres à l'action dans la mesure de l'étendue de leur compétence, le contrôle suprême s'exerçant au nom du National et non pas du Provincial… #
Mais je vous prie, Monsieur et ancien confrère, écoutez mon qui vous meut ? Qui vous point ? #
Tel que me voilà, vous avez devant vous probablement le plus ancien fédéraliste de France. Le premier manifeste fédéral est sorti de cette pauvre plume en un mois de février 1892, qui tient à ma vingt-cinquième année. Cette Déclaration des jeunes félibres se réclamait de maîtres révolutionnaires comme Proudhon et Comte et de réactionnaires comme Bonald et Le Play, parlait de dépêtrer la France des usurpations du pouvoir central, d'alléger le pouvoir, de tirer l'État de l'Étatisme, mais non de diminuer ni d'affaiblir cet État : tout au contraire. Ah ! non, nous n'étions pas « séparatistes » ! Dès nos premiers mots, nous posâmes que la mise en question de notre loyalisme français entraînerait la visite de nos témoins et promenade sur le pré. L'injurieuse réputation faite à l'autonomisme nous exaspérait. Elle nous indigne encore aujourd'hui. #
Je vous entends. La confusion vous paraît inhérente aux faits. Vous en citez. Je me demande si l'on ne vous a pas fortement exagéré, par exemple, l'autonomisme alsacien ? Le régionalisme d'Alsace, avec ses particularismes, dialectes compris, rendait de grands services avant l'autre guerre. Songez au docteur Pierre Bucher et à ses courageuses campagnes menées d'accord avec les Alsaciens de France, encouragées de Paris par Barrès et Léon Daudet. L'autonomisme s'est aigri après 1918. Mais comment ? D'abord par la politique incertaine et myope de nos gouvernants, ils ont tâtonné jusqu'en 1924. Que faisaient-ils, ils l'ignoraient. Voulez-vous lire avec moi cette lettre de Paul Cambon (8 janvier 1919, Correspondance, tome III), où ce diplomate consommé et ce grand esprit rapporte une conversation avec Clemenceau, alors tout-puissant. #
Pour l'Alsace, je lui ai demandé ce que signifiait cette constitution d'un nouveau Comité chargé de préparer la législation de l'Alsace et de la faire préparer par nos Chambres. Je lui ai dit que cette idée soulevait tous les Alsaciens, qu'en fait, ils jouissaient du point de vue administratif d'une autonomie complète, qu'ils légiféraient eux-mêmes par leur Landtag de Strasbourg sur toutes les matières n'ayant pas d'intérêt impérial, que le gouverneur Stathalter, représentant l'Empereur, sanctionnait les lois sans en référer à Berlin. Je lui ai donné quelque indication sur l'organisation culturelle de l'Alsace, très supérieure à celle de l'An VIII, aujourd'hui surannée et condamnée par tous les esprits libéraux… #
« Je ne veux pas reconstituer les anciennes provinces, s'est-il écrié. » Discussion où j'ai eu le bon bout, car il ignore l'administration. À la fin, il m'a dit : #
« Vous voudriez donc modeler l'administration de toute la France sur celle de l'Alsace ? #
— Oui, ai-je répondu. #
— J'y réfléchirai… » #
Autant en emporta le vent. Mais voilà tout le mal qu'un ancien préfet, homme d'État, qui fut vingt ans ambassadeur à Londres, pensait en 1919 de nos institutions de l'An VIII, de leur usure et de leur despotisme. Elles ne pouvaient que nous nuire en Alsace. Les cinq premières années passées, on s'est avisé, avec le Cartel, d'élaborer quelques menaces centralisatrices aux libertés spirituelles de ce pays si religieux ! Ni les efforts de la Fédération Nationale Catholique et du général de Castelnau, ni ceux de l'Action Française, avec Daudet, Pujo et nos amis d'Alsace, ne pouvaient compenser l'énormité de la maladresse. #
Sans ces deux calamités venues de Paris, l'autonomisme alsacien aurait été inoffensif, bienfaisant et exemplaire pour la patrie. C'était l'avis de Millerand et c'était celui de Barrès, tels qu'ils le manifestaient déjà vers 1916 ou 1917, c'est-à-dire en avance même sur Paul Cambon 10. #
Les déviations de l'autonomisme breton et méridional sont d'un ordre à peine différent. De ce côté, comme pour la cinquième colonne allemande, il eût suffi, aux années 30, d'une police vigilante et bien en main. Mais vous avez vu alors l'incertitude et la division de l'État, peu sûr de ses buts, et de faible sens national, complaisamment ouvert à tout mouvement d'anti-France, lui-même travaillé par de tels mouvements, incapable de les réprimer avec quelque constance, parce que lui-même y avait tendance secrète. De quel front prêcher ou imposer la patrie si l'on n'y croit pas ? Vingt ans avant les manifestations des premiers conscrits anti-patriotes (elles eurent lieu vers 1905), Mistral les avait annoncées comme un effet naturel des directions scolaires, religieuses, économiques et administratives de la démocratie 11, et cette grave crise se produisit comme il l'avait dit, dans la ligne des recrues déclassées et dépaysées, que la grande ville ou la grande industrie avait rendues insensibles à leur origine terrienne, nullement du côté des paysans trop fidèles aux particularismes de clocher ou du dialecte natal. Les pronostics de Barrès dans Les Déracinés avaient également précédé l'hervéisme 12 d'une bonne semaine d'années. Selon les pêcheurs de la mer d'Azov, c'est toujours par la tête que pourrit le poisson. La crise vinicole de 1907, caractérisée par la révolte d'un régiment, n'a été sur place qu'un épisode vite oublié. Mais l'hymne aux « braves soldats du dix-septième », en français, s'il vous plaît, a été diffusé sur tout le territoire par le grand parti centralisé qui s'intitule Section Française de l'internationale Ouvrière, S. F. I. O., et dont le principe est dérivé du « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », ce qui amorce également l'union de tous les propriétaires et par conséquent la destruction de toutes les nations. Les autonomismes locaux ne prirent point de part à ces gentillesses. #
Jaurès savait Mirèio par cœur. Il en récitait des chants entiers dans les couloirs de la Chambre, son accent quercynois devait les rendre bien curieux ! Mais Jaurès n'est jamais monté à la tribune de la Chambre pour proposer ou soutenir une mesure de particularisme provincial. Cependant, un ministre de Clemenceau pouvait appeler le chef des S. F. I. O. « l'orateur de l'Allemagne au Parlement Français », et celui-ci faisait chanter dans toutes les cérémonies de son parti « crosse en l'air et rompons les rangs » de l'hymne de Pottier. Cette nappe d'anarchistes anti-français n'a pas cessé de s'étendre depuis le début du siècle. Il y eut des rémissions, des reculs, des conversions (comme celle de Gustave Hervé en personne), le progrès du mal a été continu. Les Hervé de l'après-guerre se sont appelés Jean Zay ou Aragon, leur action matérielle a été décuplée. Au mois de juillet 1914, on n'avait abouti qu'à un simple projet de grève générale formulé par Jaurès, repoussé avec horreur par Jules Guesde comme un acte de « haute trahison » contre la nation la plus socialiste, la France ; puis Laval alla bien à Kienthal conférer avec les socialistes de l'empereur ou s'acoquiner d'un peu près au Bonnet rouge, comme Briand à Lancken. Mais devant l'Ennemi, l’État d'alors, reformé à l'union sacrée, s'était retrouvé encore en pleine énergie autour de Clemenceau. Ce fut bien autre chose aux abords et au cours de la dernière guerre ! Ce n'était plus en paroles que l'on refusait le travail à la défense nationale. Un grand parti, allié de la Russie, elle-même alliée de l'Allemagne, minait nos usines, nos casernes, nos administrations. Les tarifs horaires du travail au ralenti étaient homologués au nom de syndicats reconnus officiels, incorporés comme des membres actifs et militants à l’État, l’État « Front populaire », s'il m'en souvient bien ? On n'a pas osé dire encore combien de formations d'armée régulière ont mis bas les armes face à l'envahisseur de 1940. La même invasion a déterminé une large apostasie administrative, collaboratrice et complice de l'exode civil et de ses sept à huit millions de victimes, Nous avons vu pire encore. Nous continuons à le voir : cent quatre-vingt-trois séparatistes à peu près avoués tiennent presque un tiers d'une assemblée qui se dit nationale ; ils prétendent représenter plusieurs millions d'électeurs citoyens égalitaires. Il est difficile de le contester. Nos ports et nos gares sont de temps en temps menacés par ce même parti puissant et vigoureux pour interdire la réception des cadeaux américains et le départ de renfort et de matériel pour notre armée d'Indochine. La plaie est là. Elle suppure au grand soleil de notre État centralisé. Le régime qui nous a ouverts à l'invasion sept ou huit fois depuis 1789 est le même qui laisse se décomposer ainsi le patriotisme. La preuve est donc faite que l'école publique, que l’École de l’État central, si elle sait encore former de bons Français, ne peut plus grand-chose pour empêcher la fabrication en série des mauvais. Le scandale crie, ses causes sont criantes. Devant elles, je me demande comment il vous reste, Monsieur et ancien confrère, le loisir de craindre les effets d'un mal à venir ? Tout le mal possible paraît échu. Le devoir pressant serait de refaire un patriotisme et de recoller les membres déchirés de la patrie elle-même. Vous me direz que, tout de même, vous n'avez point tort de vous opposer à l'ouverture d'une plaie nouvelle. D'accord, mais si vous nommiez plaie ce qui est traitement ? Si vous étiquetiez poison ce qui est antidote ? Voilà la question. Je ne la fuirai pas. #
Avant de l'aborder, répétons que les méfaits récents de l'autonomisme breton furent bien peu de choses auprès du champ de ruines que nous venons de parcourir. Ces méfaits ne doivent pas tromper sur le génie et sur l'esprit de la Bretagne. Quelque anarchie qui soit empruntée au fond celtique de sa race, le Breton, paysan, marin, guerrier ou prêtre, tient à sa terre, à sa terre de France, et il l'a prouvé c'est peut-être lui qui, en 1914–1918, et depuis, a fait les plus lourds sacrifices à la patrie, si l'on en juge par le total des morts de la VIe et de la Xe régions militaires de Nantes et de Rennes. Tous ceux des Bretons qui se sont déclarés les premiers et les plus ardents provincialistes étaient d'irréprochables Français, on peut dire aussi des Français forcenés. Personne en France n'a parlé de notre unité comme Renan, fondateur avec Narcisse Quellien du Dîner celtique. Notre ami et confrère Charles Le Goffic, que vous avez connu Français modèle, était Breton bretonnant. #
Il y a partout des fols. #
J'ai connu pendant l'autre guerre un gentilhomme provençal qui se croyait destiné à gouverner la Provence pour Guillaume de Hohenzollern. Ses deux fils se battaient comme des lions ; personne ne prit sur soi de révéler la démence de leur père. On en rit tristement. La faute extravagante n'en était pas plus à l'esprit provençal que l'éversion du monument de Rennes à l'âme bretonne. #
Je n'ignore pas quels pièges lui ont été tendus du dehors. Les manœuvres de l'invasion, et surtout ses prodromes non surveillés par le pouvoir central, ont gâté sur quelques points l'autonomisme breton, mais l'Allemagne n’y a pas été le seul amateur et instigateur du séparatisme. Croyez-moi, l'attentat à la statue du « collaborateur » Duguesclin porte une signature qui n'est pas d'outre-Rhin, mais d'outre-Manche. Je le dis avec certitude. Il y a une vingtaine d'années, certaines communications druidiques ou archi-druidiques avec nos voisins insulaires gardaient leur caractère de folklore, pittoresques, parfois d'émouvante poésie. Cela a mal tourné depuis. J'ai lu l'autre année, dans des journaux franco-allemands qui ne sont pas publiés en Allemagne, de curieuses séries d'articles écrits en français, non pas précisément d'Angleterre, mais du Pays de Galles ; la suite du ton, la violence des paroles, la précision et l'âpreté de l'excitation contre la France ne laissaient rien à désirer comme offense caractérisée au droit des gens. Si l'information de M. Auriol eût été aussi complète que la mienne, nul doute qu'il en eût touché deux mots pendant son voyage à S. M. le Roi, ou madame Auriol à S. M. la Reine, afin que la Grande-Bretagne laissât l'Armorique tranquille. S'il était le digne successeur de Paul Cambon ou de M. de Saint-Aulaire, notre ambassadeur à Londres multiplierait en ce sens les démarches et les instances motivées. Il en faudrait beaucoup. Un tel mal n'est pas supportable entre pays amis et alliés, mais la tentation pour nos chers voisins est très forte. Avoir brûlé la Normandie et les trois quarts de la Bretagne en 1944 serait de peu de prix en comparaison de la chance de pouvoir se réinstaller sur ces bords cinq cents ans après Jeanne d'Arc et quatre cents ans après François de Guise. Cela paierait de l'Inde, se disent-ils, même sans le vouloir, même en ayant un peu honte de le dire, parce que ce n'est pas du beau jeu. M. Churchill et M. Spears en ont joué bien d'autres. #
À mon avis, Monsieur et ancien confrère, vous ne tenez pas un compte suffisant des négligences et des déficiences de notre pouvoir central. Toutes ces malheureuses histoires bretonnes seraient enterrées depuis longtemps si l'on eût libéralement aidé une noble population à honorer, en même temps que sa patrie française, sa matrie 13 celtique, et qu'une exacte police intérieure réprimât comme il convenait certaines impiétés démentes tandis que l'on eût fait respecter, au dehors, une politique d’État ferme, digne, ni assistée ni asservie. #
C'est là, au centre, qu'il faut le plus veiller. Les réformes s'imposent. Dans un milieu de plus en plus anarchisé, tout, y compris le meilleur, peut être retourné par l'anarchisme et employé pour l'anarchie. Qu'un nouvel essor de la vie locale soit indispensable, les mauvais éléments voudront s'en saisir comme de tout ; qu'il faille restaurer les bases de la patrie et du patriotisme, les anti-patriotes feront effort pour organiser leur résistance même sur ce terrain, avec les facilités de hasard qu'ils pourront y trouver. Ne mêlons pas l'accessoire avec l'essentiel, ou plutôt voyons-en le vrai rapport. Nos fédéralistes de 1892 se doutaient eux-mêmes d'un péril éventuel : voulant rétablir les anciens États, ils avaient tout de suite songé au renforcement de l'État central. Voulant désétatiser leurs petites villes, leurs grandes provinces, ou leur pagus originel, ils ne voulaient pas démanteler la patrie, ils voulaient le contraire. Beaucoup opinaient que le relâchement du réseau bureaucratique devait être accompagné d'un renforcement de l'Exécutif. #

C'est ce qui me rallia pour ma part, en peu d'années, à la formule de Le Play : démocratie dans la commune, aristocratie dans la province, monarchie dans l'État. À ceci près que, déjà convaincu que la démocratie était le mal et la mort de toute société, je ne voulais pas, même pour la commune, de l'absolu du Nombre ; je lui souhaitais un statut populaire, en partie direct, comme il fonctionnait dans l'ancienne France, avec ses assemblées de paroisses dominicales et des réunions générales de « citoïens de tout estat 14 », en partie représentatifs de tous les corps de la ville, avec, comme on l'a vu, le suffrage plural des chefs de foyers, patriciat nouveau, contrôlé, bien entendu, par le pouvoir central, mais très énergiquement défendu de la gestion immédiate de Préfets ou de Ministre. Plus cette résistance périphérique redevenait solide, ces libertés locales étaient-elles assurées, et mieux elles devaient être équilibrées, tout en haut, par la liberté de l'État, c'est-à-dire l'intégrité de sa vie, l'action de sa puissance, la qualité de sa compétence. #
Fortement établi dans sa stricte fonction nationale (Affaires étrangères, Armée, haute Justice), un chef non seulement unique et viager, mais héréditaire et traditionnel, supérieur aux compétitions, affermi dans la permanence de son droit historique et la judicieuse division du travail politique, permettait le retour à la grande période française bourbonnienne de 1636 à 1792, où nulle pointe étrangère ne mordit profondément notre sol, où nulle armée ennemie n'est entrée dans Paris, où nul habit vert ou rouge ne souilla la Seine ou la Loire, mais où notre diplomatie ne fut jamais non plus débattue dans les rues, les cafés, les journaux, les Chambres, où jamais elle ne sortit du Conseil « d'en haut » et du Conseil « étroit » où le Roi seul, avec quelques ministres, pas tous, avaient accès, et d'où cette autorité puissante rendait intangible la première des libertés qui est la sécurité du territoire et l'indépendance de la nation. #
Voilà nos précautions de 1892–1897 contre les excès prévus de l'autonomisme. Nous nous demandions encore si elles suffisaient contre le mouvement, l'évolution, si vous voulez, des idées et des mœurs. Sous les Bourbons, les États provinciaux qui avaient subsisté pour un tiers de la France ne furent pas toujours de tout repos. Les conditions de la vie moderne pouvaient aggraver la difficulté. Une vie locale intense peut aspirer à peser indûment sur le centre. Des problèmes réservés à l'échelon suprême pouvaient être usurpés par les degrés inférieurs. #
Comment faire ? #
Avec nos pauvres conseils de département, ce n'est qu'un jeu : à la moindre incartade, le préfet se lève, se couvre, s'en va, tout est dit. Avec de grandes assemblées de provinces aux riches budgets, aux moyens puissants, traversées par des souffles d'intérêts passionnés, capables de grands biens, mais aussi de méfaits et même de forfaits au cas où l’Étranger réussit à s'y infiltrer, ces menus freins juridiques et formels seraient sans valeur. Les anciens États de Bretagne tournaient parfois au champ clos ou à l'émeute. Les États futurs pouvaient récidiver. Comment régler cette balance des forces ? Environ cinq ou six ans après avoir vu ce que j'appellerai la nécessité mécanique de la monarchie, tout au début du XXe siècle, je débattais la question avec un Breton de la grande espèce, passionné pour la restauration des libertés de sa terre-mère, mais Français cent pour cent, et qui l'avait prouvé : le général de Charrette 15. Il ne badinait pas sur l'unité française, non plus que sur les conditions du traité de la duchesse Anne. #
« Comment voyez-vous cela ? » voulut-il bien me demander un jour dans les bureaux de la Gazette de France où j'avais l'honneur de le rencontrer. #
À Breton et demi, Provençal et trois quarts ! Ni moi non plus je ne niais la gravité de ce risque. Ni je n'admettais qu'il fût licite de rien entreprendre sur l'État national et royal quand on n'était qu'un État provincial, quel que pût être en théorie juridique l'argument fédératif et confédératif, la vie souveraine de la nation devrait tout primer. #
« J'aime mon village plus que ton village, j'aime ma Provence plus que ta province, j'aime la France mieux que tout », disait le catéchisme avignonnais rédigé par Félix Gras. Je n'inventais donc rien quand je répondis qu'il fallait songer à la sauvegarde française d'abord : #
« Mon général, dis-je, l'assemblée de province qui empiète sur la nation la trahit. De la part d'un orateur ou d'un chef de parti local, l'usurpation du pouvoir central doit entraîner la même sanction que la haute trahison, une peine capitale. » #
Le héros de Patay 16 ne fut point étonné de la motion féroce. C'était le plus doux et le plus charmant des vieillards. Haut comme une tour, fin comme l'ambre, gai comme un pinson, il n'aimait rien tant que de conter, au lieu de ses campagnes, sa vie inimitable, d'après Mentana, quand les jolies Transtévérines faisaient leur cour publique au beau jeune Français colonel des zouaves du Pape : « Je te donne cette fleur… Je te donne cette rose… » Morceaux d'anthologie qui ont été écrits, je le sais, et qui ont peut-être été réunis déjà. Ils le seront sans doute. J'entends encore pointer le joli chant de l'idylle galante et pieuse. Mais quand j'eus proposé la peine de mort pour tout crime ou délit tangent au séparatisme total. Charette ne sourcilla point, et dit : « C'est cela, c'est ce qu'il faut, le pouvoir local à sa place, le pouvoir royal à la sienne, et tout ira bien. » #
Ma pénalité vous paraîtra vive. Les précautions sévères arrêtent au point juste de mortelles déviations. #
Refrain, ce n'est tout de même point de là que sortent en ce moment les entreprises centrifuges capables de servir l'ennemi. Nos factions politiques et sociales en font bien d'autres, vous l'avez vu, sans interventions d'assemblées régionales ou d'écoles dialectales. Vous avez trouvé dans votre courrier, avec un juste scandale, des lignes honteuses et stupides : sur les ruines de l'unité, des malheureux y annonçaient qu'ils fraterniseraient avec les Barbares de l'Orient ou de l'Extrême-Orient, au nom des groupes bretons, alsaciens ou provençaux. Mais ces groupes me paraissent plus rêvés que réels. Vous observez même que le vocabulaire et le style uniforme de ces papiers trahit une source de rédaction unique. N'en doutez pas. C'est à quelque faction centralisée et centralisatrice que vous avez affaire, à des sectes de l'anarchisme individualiste ou du marxisme moscoutaire, l'un et l'autre fort bien outillés par nos grands partis au pouvoir ou voisins du pouvoir. Elles sont au travail depuis longtemps et s'accommodent très bien de la centralisation administrative et scolaire pour organiser déchirement et démembrement. #
Or, prenez bien garde à ceci : cela est produit par l'impulsion qui leur est propre, en vertu des liaisons logiques de leurs négations fondamentales avec leur action anti-française. Cette logique n'existe pas entre les conclusions de vos correspondants et aucun patriotisme supposé basque, breton ou provençal. Car d'abord, celui-ci est un patriotisme : il part de la terre natale, il implique le sens et le culte homogène des premiers cercles concentriques de cette patrie, les gradations qui lui sont inhérentes le conduisent naturellement du champ au village, du village à la ville, en demandant de place en place le secours, le soutien, le service et l'appui fraternel supérieurs. Que ce patriotisme primaire ou secondaire aspire à des campagnes heureuses, à des villes ou à des villages actifs, vivants, regorgeant de peuple et de liens, cela veut aussi une patrie nationale saine et libre, un État central indépendant et bien défendu : ni Marseille ni Saint-Jean-de-Luz ne sont gaillards quand Paris est pris. Que, par des accidents très accessoires, ces vérités éblouissantes puissent être voilées par des passions ou des ignorances particularistes, que les frénésies puissent l'emporter sur le bon sens, on l'avoue puisqu'on songe à s'en prémunir ; il n'en est pas moins vrai qu'aucune causalité rationnelle ne relie ces erreurs à la restauration du pouvoir local ni au dialecte local. L'esprit de ces derniers objets milite dans le sens opposé, patriote, donc national. #
Le véritable Ennemi est campé à la place où sont artificiellement concentrées toutes nos forces, et le mal s'y fait de haut en bas, il va du milieu aux extrémités. C'est à la périphérie que survivent, sans doute grâce aux dialectes et aux autres particularismes, des éléments jeunes, sains, et capables d'un beau service. Mais il faudrait que le Centre se réformât et que l'État, pour revenir de ces absurdités qui le sapent, commençât par apprendre à douter un peu de ses propres abus. Il veut faire croire à sa toute-science et à son infaillibilité, quand il ne sait rien et se trompe à tout coup. Il s'est mis à envahir la philosophie, la morale, le droit, la théologie, la religion, toutes les sciences et les principes disciplinaires entre lesquels il n'a aucun moyen de se prononcer. Les thèmes époustouflants qu'il a tirés de son cru imposent risée et dégoût à tous les esprits réfléchis, soit qu'il vaticine de la liberté ou de la fatalité, de l'avant ou de l'arrière des temps, de l'égalité ou du Progrès, à plus forte raison les opinions qu'il professe à voix plus ou moins haute sur les invasions germaniques, la mission de Jeanne d'Arc ou les morales comparées d'Auguste Comte et de Jean-Jacques, toujours sans en rien savoir ni pouvoir savoir, car tel n'est pas son métier. Cela est si vrai qu'il se garde de proposer ses postulats fantasques aux professeurs de Facultés et même de Collèges, dont l'esprit critique est en état de faire des objections à ces sornettes ; il les impose bel et bien, des hautes cimes d'une chaire qui n'est qu'une mangeoire, aux malheureux maîtres d'écoles primaires, dans les Écoles Normales où ils lui sont laissés sans défense, et c'est là-dessus qu'il se fonde pour invoquer une certaine « unité morale » du « pays », et refuser ou contester la liberté, la puissance, les moyens matériels d'enseigner à ceux qui ont une doctrine ferme, ceux qui possèdent, pour la défendre ou l'étayer, des motifs autrement valables que ces Nuées inanes dites laïques, mais qui sont des croyances religieuses beaucoup plus gratuites qu'aucune foi. #
Et cet État-docteur, sommant son chef-d'œuvre d'hypocrisie, de lâche prudence et d'impudence effrontée qu'il juge bien assez bon pour le peuple, mais qu'il n'ose plus trop brandir contre les élites informées, cet État-docteur renseigné sur l'évolution du monde, le sens de l'Histoire, les distributions du bien et du mal moral, mais qui se démontre à tout coup parfaitement empêché d'appuyer d'une seule raison de tels placita fantasmagoriques ou sentimentaux, le même État ne possède aucune certitude sur lui-même, sa fonction, sa valeur et son existence. Là, il n'ose rien. Là, sur ce terrain réel et concret, où lui reviendrait quelque compétence, là où il aurait le droit, le pouvoir, le devoir de se définir comme l'organe et le serviteur d'une société dite France, il en ignore tout, il fait preuve d'un creux, d'un vide, d'un néant, d'une absence d'intelligence et de conscience absolus. L'État-docteur ne se sait pas l'armature ni l'armure de cette société, il s'ignore en tant que somme de ses moyens de protection, de conservation, de durée, et qu'expression de sa volonté de vivre, ou ressort essentiel des instruments de sa vie. Sa pratique la plus constante est d'alterner entre le jeu du tyran qui ne connaît aucun frein social pour le modérer, et celui de l'esclave contre qui l'on se permet tout. Sa généalogie, écrite dans l'Histoire, lui échappe. Il ne sait pas de quels efforts collectifs de la société, de quel ensemble de paternités physiques est sortie la première paternité politique. Il ignore encore plus combien le citoyen, fils et père de la Cité, lui est postérieur comme individu, antérieur et supérieur comme membre de la Nation, son cohéritier-né. L'État-docteur a vaguement entendu parler d'une théorie contractuelle ou quasi-contractuelle de son entité, mais cette faribole juridique, étant contradictoire, est inutilisable, il n'en peut rien tirer, hormis dans les cas heureusement imaginaires de la dissolution de la société. Il doit exister pourtant, de façon visible, un statut fondamental qui lie les Français à la France et qui ne peut se transgresser ni se contester sans ingratitude ni obnubilation de l'esprit. Mais l'État-docteur ne peut formuler ce statut, ni seulement le désigner par un nom. Entre ces réalités nécessaires à sa vie et les « grues métaphysiques » (comme disait Paul La Fargue 17) qui lui ont délivré un bonnet de docteur et estampillé son diplôme, il n'y a ni lien ni rapport. Progrès fatal, liberté native, égalité obligatoire, ces formes sans contenu n'emportent en rien la nécessité pratique de l'Être français. Lira-t-on que l'Être français comportait ces Nuées ? La prétention est fausse. On peut pressurer à l'infini le corps et l'esprit de la France sans en voir jamais sortir aucun de ces monstres. La France et les Français ont donné des vulgarisateurs de premier ordre aux idées révolutionnaires ; celles-ci leur sont venues d'ailleurs, ils ne les ont pas inventées. La même France, les mêmes Français ont fourni à la contre-révolution ses maîtres les plus originaux, comme les réactions de défense d'un vieux pays qui ne voulait pas se laisser tuer 18. Quoi qu'il en soit, l'espèce de catéchisme spirituel que notre État impose sans conviction à ses disciples, victimes et dupes, du plus bas degré, ne saurait remplacer nulle part cette doctrine d'elle-même que la France doit à ses enfants. Faute de quoi, ce qui est essentiel à la défense de la vie est livré, ludibria ventis, à des vents d'aventures contradictoires, rien n'y est primordial ni sacré, rien d'intangible, rien qu'il faille respecter en soi, et bien au contraire ! Ces discussions de principes, ces dénégations, ces mises en doute de l'Obligatoire essentiel ont fini par s'incorporer au bagage des politiciens en mal de parvenir. Cette carence scandaleuse leur assure un bénéfice constant, il entre dans leur usage le plus courant de s'ouvrir le chemin des honneurs en se déclarant contre la concorde intérieure et le travail paisible, pour la lutte des classes, la grève générale et le drapeau dans le fumier. On débute en se faisant inscrire au carnet B des anarchistes, on s'immatricule à la Fédération libertaire de la Haute-Garonne, on va négocier à Kienthal ou à Copenhague avec les socialistes de l'empereur, trahissant ceux des socialistes qui sont au gouvernement de la France, et c'est la porte triomphale dite d'extrême-gauche, porte de gloire qui ouvre sur le bruit, le succès, la première notoriété de carrière ; puis, de façon plus ou moins sensible, on se range des voitures dans la direction du profitariat et l'on s'achemine vers Matignon ou l'Élysée, ou le Palais de la Société des Nations. On a donné de la voix dans un hallali fangeux contre le Président de la République de 1894, on occupe sa place en 1920, pour la quitter quatre ans plus tard selon le même rythme, avec un coup de pied quelque part. Le papier-monnaie qui achète normalement le Pouvoir est au timbre de l'anarchie. Au lieu de la note d'infamie qui aurait dû marquer leurs débuts pour les arrêter net, Briand, Millerand, Laval et tant d'autres ont assuré les premières prospérités qui leur ont mis le pied dans l'étrier ou l'arrière-train sur la selle, au moyen de quelque coup d'État contre l'ordre ou contre la Patrie. #
Erreur de jeunesse bien pardonnable ? Va pour le pardon aux hommes, mais leur acte ? ses effets ? ce qui reste du mal produit subsiste, dure et s'étend, la somme de déficience morale dont le pays demeure blessé, puis infirme ? Le premier scribe ou bavard venu gagne réputation, crédit et clientèle à insulter tout ce qu'il convient d'honorer. De pompeuses funérailles viennent d'auréoler deux hommes, M. Blum, M. Sangnier. Il n'est pas besoin de rappeler par quels défis au moins imprudents le premier a découvert et dénudé notre pays, son désarmement unilatéral qui suffit à sa gloire, résume tout un monde d'hostilités aux organes de la défense nationale. Pour le second, moins connu, on peut douter que les autorités civiles et religieuses qui l'ont inondé d'eau bénite et d'encens se rappellent que le fondateur du Sillon est entré dans la vie en ridiculisant, dans sa pièce de théâtre Par la Mort les bons Français qui avaient gardé en 1900 le culte des provinces perdues, le simple souvenir de Strasbourg et de Metz ; il a continué en prêchant à ses premiers disciples : Tue tes chefs, en leur affirmant la définitive impossibilité de la guerre, en leur garantissant l'inutilité radicale de l'armée et de l'État. Ces mauvaises notions, dont il aurait dû répondre, ont été sanctionnées à rebours. #
L'État français ne paraît plus du tout en souci de faire sentir quel est le prix de la France pour les Français. S'ils ne s'aiment plus entre eux, c'est qu'il a d'abord oublié de leur apprendre à s'aimer eux-mêmes, et comme tels. Faute d'avoir pris les choses à leur humble commencement, c'est-à-dire à la circonférence du pays, à la naissance des premiers devoirs et des préférences élémentaires (sur la Chine ou la Négritie, l'Angleterre ou l'Amérique), cet État a pris l'habitude d'être renié, bafoué, lapidé sans avoir rien su répondre à des détracteurs qui ne vivent que de lui. Un immense capital historique est ainsi offert à une érosion bénévole illimitée. Attaqué de toutes parts, rien ne le protège. Si l'on rêve de le défendre, tout est à refaire, au moins sur trois côtés : la liquidation complète de l'étatisme, la réfection d'un État normal, la rééducation des mœurs sociales. #
Autant redire en conclusion que rien n'est possible si l'on ne vient pas à bout de la florissante industrie des politiciens, principale bénéficiaire de nos vices comme de nos malheurs, telle que l'a organisée la révolution de 1944. Son discrédit, ses tares, n'ont pas beaucoup réduit son pouvoir corrupteur. Ajoutons : la colère des honnêtes gens, l'évidence de l'intérêt public, l'imminence de périls mortels qui nous sont perpendiculaires… Pour combien tout cela peut-il compter devant cette machine à favoriser toutes les fraudes, à les couvrir, à défier tous les contrôles, à garantir les profits indus, à en supprimer pleinement les risques, la belle machine à tenter et à pourrir tout reste de vertu, la machine géante et formée de compartiments si spacieux et de si vastes récipients ? Si uniformément établie à l'échelon national ou international que toute action personnelle y soit pratiquement noyée, perdue, effacée, annulée ! Ni vu ni connu ! Pas une richesse nationale qui n'y soit aspirée. C'est un océan de facilités sans mesure. Rien n'a jamais été monté de si simple ni de si puissant contre la bonne foi, l'honnêteté et la justice élémentaire de chacun. L'ensemble est calculé pour que chacun y soit d'abord perdu, puis perverti. Chacun y est intéressé à corrompre le tout. Désordre social qui équivaut à un parricide permanent et alternatif, le mal du citoyen opéré par le mécanisme de la cité, le mal de la cité par l'intérêt du citoyen. #
Cette triste vue de la situation générale ne me fera pas inculper d'optimisme, je n'ai pas d'illusions. Mais enfin, Monsieur et ancien confrère, il y a des fortunes heureuses et des coups de soleil inattendus. N'y comptons pas, mais soyons prêts à les servir s'ils percent nos nuages. Ce long discours n'a d'autre objet que de vous recommander ces deux cas aussi favorables qu'inopinés, l'un de demain peut-être et l'autre d'hier. #
Une loi qui instituerait ou élargirait les pouvoirs locaux, une loi qui habiliterait communes et départements à gérer directement les intérêts dont ils sont capables, à régler les affaires dont ils ne sont pas inégaux, une loi qui, ce faisant, serait assez prudente pour dire aux partis centralisés : « À bas les pattes ! » et pour conférer une indépendance réelle aux pouvoirs locaux restaurés, cette loi serait bonne dans son essence, tous les bons citoyens qui ne font pas de politique alimentaire lui devraient approbation et concours. #
Une telle loi, statutaire et constructrice, existe-t-elle ? Non. Le pouvoir local compétent et agissant sur place n'existe pas encore. Eh ! bien, alors, cette autre loi, faite à Paris, mais favorisant un mode d'instruction primaire qui ne peut être expédié tout fait de Paris, cette loi sur l'enseignement du dialecte local à l'école est encore une bonne loi parce qu'elle fait appel à des fonds naturels profonds et anciens de notre périphérie autochtone. Remercions-en les auteurs, fussent-ils indignes comme le M. R. P. #
Elle apporte un concours appréciable à la cause des libertés, des libertés positives, des libertés autoritaires et substantielles, desquelles dépendent le réveil et la régénération du pays. #
Un bienfait pour le peuple
Vous me dites : « Non, car l’État y est conduit à manœuvrer contre lui-même, il se diminue et il se déchire. » #
Permettez-moi de le redire, c'est la fausse apparence, non la réalité. #
Une telle toi travaillant contre l'Étatisme, l'État en bénéficiera beau premier. Cela ressort déjà de tout ce qui a été soumis à vos réflexions sur la nécessité d'en finir avec une machine paperassière et anti-humaine pour la remplacer par des organismes d'action vivante. #
Reste à vous exposer le principal en ce qui touche au vif du sujet. #
Le vif du sujet, c'est le bien du peuple. #
J'entends le peuple en sa partie la plus nombreuse et la plus pauvre, celle dont nos démocraties s'instituent les curatrices et les fondés de pouvoir. #
Ce qui ne vous paraît peut-être pas devoir aller tout seul. #
Je vous ai confié mon anti-démocratisme essentiel. Ne suis-je pas en train de me contredire honteusement ? Pas du tout. #
L'on peut s'opposer au gouvernement du peuple par le peuple, et désirer, de tout son cœur, que le peuple soit gouverné pour son plus grand bien. #
Si c'est du paternalisme, où est le mal ? Comme il n'y a pas de fraternité concrète sans paternité, le reproche est léger du moment que l'égalité démocratique tue les peuples, vérité qui devrait être acquise au premier examen. #
Mon respect du peuple me garde de lui mentir. Mon amour du peuple me défend de lui donner contre lui-même des armes empoisonnées. Mon anti-démocratisme ajoute à ma démophilie 19 profonde un élément de clairvoyance qui n'ôte rien à la chaleur de ma pensée. #
De ma personne, j'ai travaillé plus de trente ans, chaque nuit, de la soirée à l'aube, en coude à coude étroit avec le peuple parisien, ce peuple ouvrier du journal (Corporation du Livre) avec qui je n'ai jamais cessé des rapports cordiaux et gais, qu'il s'agît de trimer ensemble dans un cagibi ou sur le marbre de l'atelier, ou d'arroser d'un verre de vin la tranche de jambon confiée au pain frais, en portant de libres santés aux fêtes des uns et des autres. Notre seul ennemi était ma mauvaise écriture. On s'en vengeait par des brocards de bonne humeur. Il ne me souvient pas d'un seul accident de politique ou d'amour-propre avec ces collaborateurs, d'une rare élite, il est vrai. J'ignorais leur opinion. Il devait y avoir des socialistes. Tout aussi socialiste qu'eux, mais je n'étais pas démocrate ! Ils devaient savoir ce que je poursuivais sous ce nom l'exploitation ultra-bénéficiaire de la misère, de l'envie, de la jalousie, de la haine. Notre train de vie faisait un démenti vivant à cette sainte vache à lait de la lutte des classes. #
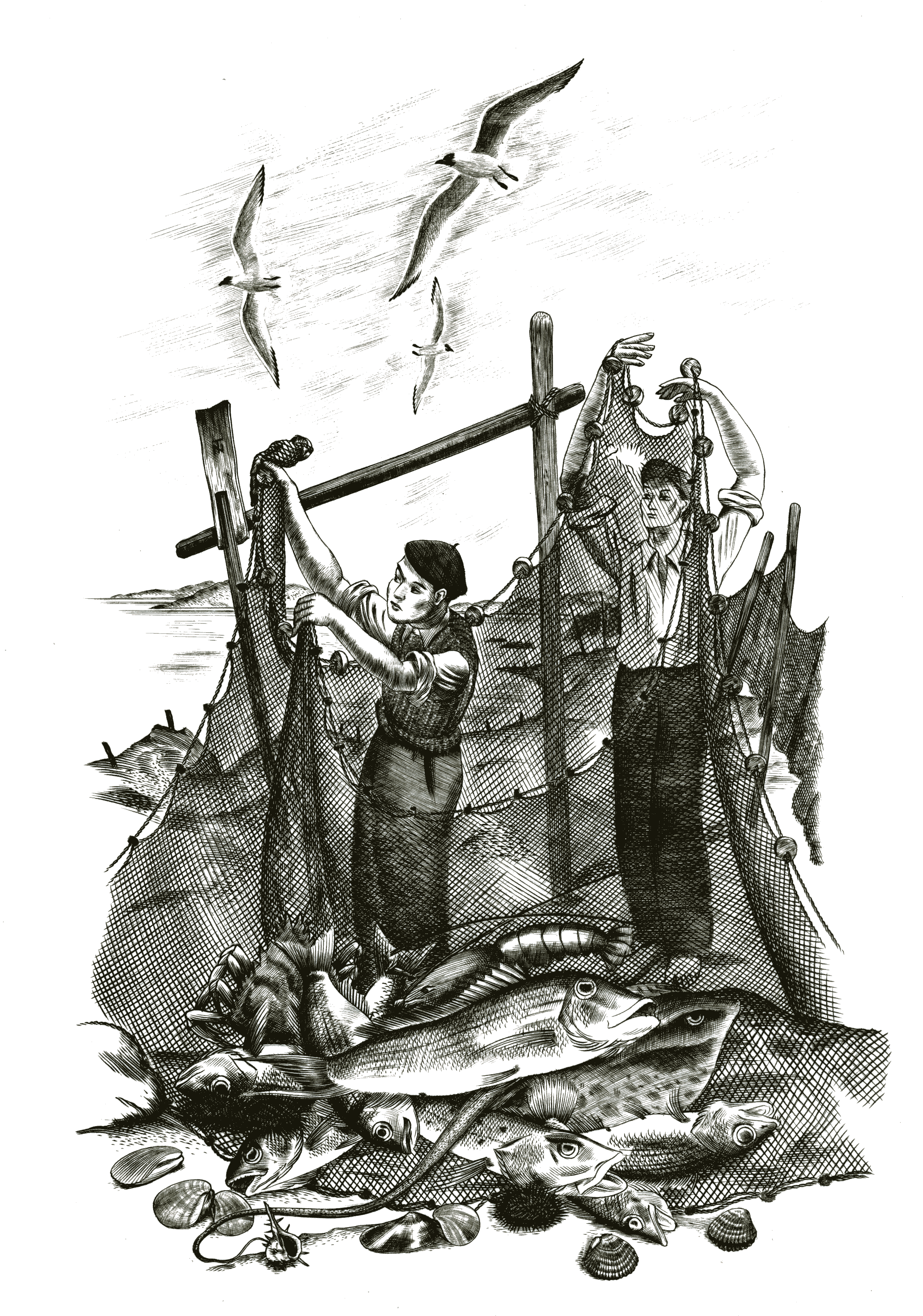
À l'autre bout du territoire, dans ma petite ville de Provence, c'est avec les pêcheurs de Martigues et de mon quartier que j'ai toujours fraternisé sans rien demander. Mais eux m'ont donné sans que je demande. Au bruit de mon procès devant la cour d'injustice de Lyon, ils m'ont adressé un brevet d'amitié si beau que j'ai l'intention de le faire graver sur le marbre si jamais je rentre dans mon jardin ; sinon, mes héritiers seront priés de le faire. En voici le texte : #
Communauté des patrons-pêcheurs de Martigues (tous ces patrons travaillant de leurs mains) — Martigues, le 16 octobre 1944. Nous, Conseil des Prud'hommes pêcheurs du Quartier maritime, représentant sept cents pêcheurs, attestons que notre concitoyen Charles Maurras a, depuis toujours et jusqu'à son incarcération, faisant abstraction de toute opinion politique, fait entendre sa grande voix auprès des pouvoirs publics pour la défense les intérêts de notre corporation. Par la presse, il a attaqué les trusts et autres grands profiteurs, ainsi que certaines administrations qui voulaient nous brimer. Pour le Conseil des Prud'hommes, le Président : Dimille. #
Par d'autres campagnes de presse, j'ai demandé que les instituteurs primaires fussent initiés aux humanités classiques, instruits du latin et du grec, dans les collèges et les lycées, ce qui complète ma vue générale du bien-être des travailleurs et du développement de la culture populaire. Rien ne me paraît ni trop beau ni trop bon pour l'éducation d'un grand peuple, le progrès de ses mœurs et de son esprit. Socrate, qui n'était pas démocrate, parlait aux Athéniens du soin à donner à leurs fils pour qu'ils deviennent meilleurs 20. Justement parce qu'il faut refuser au peuple la vaine pâture des nuées et celle des mensonges qui nous ont fait tant de mal, il faut s'efforcer de mettre à sa disposition les disciplines les plus hautes et les plus substantielles idées. #
La noble discipline, l'idée substantielle sera ici l'enseignement de la langue nationale par sa comparaison avec le dialecte natal. Nos élèves de l'école secondaire en ont éprouvé de tout temps le bienfait, grâce à l'emploi, parallèle au français, du grec et du latin, parfois de quelques langues vivantes. De toute évidence, on ne peut introduire cette méthode sous cette forme dans l'école populaire, malgré l'utopie du citoyen Bracke 21, le temps manque pour constituer la connaissance, la possession, je maniement du solide point de comparaison qui donnerait une base suffisante à la double étude. Mais, dans les pays à dialecte, ce point de comparaison existe, il est tout fait, tout prêt à être employé, et cela sur une étendue territoriale qui n'est pas médiocre. On a dans une bonne moitié de Bretagne des dialectes celtiques fort évolués ; en quelques cantons de notre Flandre, il circule au même état naturel la variante d'une langue de grande classe, le néerlandais ; en Alsace, le dialecte est germanique, et l'allemand affleure par toute cette belle et vaste province ; enfin, la langue d'oc est courante dans un tiers de la France (trente-trois départements, plus l'arrondissement de Confolens), elle fournit au premier enfant du peuple venu la claire matière d'un point de départ à l'étude des ressemblances et des différences avec la langue d'oui. #
Je peux parler particulièrement de cette dernière zone et témoigner que ces leçons parallèles y sont simples, spontanées, lumineuses ; la méthode des langues anciennes y est si parfaitement approchée qu'un grand linguiste, ayant observé le provençal dans l'exercice de cette fonction médiatrice, a pu l'appeler le latin des pauvres. On ne peut réserver le latin aux seuls privilégiés de la fortune et de la naissance, quand on en a sous la main ce succédané accompli, parfaitement propre à rendre le même service aux classes populaires. Je vous crois trop « républicain » ou trop « de gauche », Monsieur et ancien confrère, pour vous supposer insensible à cette objection. Vous avez néanmoins prévenu vos correspondants, professeurs ou élèves de l'Enseignement supérieur, que votre censure n'était pas pour eux : vous n'en avez qu'au primaire ! Vous refusez donc pour celui-ci ce « latin des pauvres » ? Vous en rejetez donc le bienfait et l'utilité ? Si oui, ce serait beau à voir. J'ose en douter. #
Peut-être doutez-vous de la réalité que je vous énonce ? Écoutez-moi. Hypotheses non fingo 22. C'est de l'Histoire. À la fin du XIXe siècle, il existait à Arles un humble Frère des Écoles Chrétiennes, homme d'ailleurs fort distingué par son savoir et ses talents, qui avait ajouté à son programme des brevets élémentaire et supérieur un cours comparatif où le français s'enseignait par le provençal. Le succès fut brillant, rapide, incontesté, soutenu. Il fallut l'âpre jalousie des pédagogues officiels et la timidité d'esprit des libéraux catholiques pour arrêter et stériliser une victoire qu'il eût été facile d'étendre à tout le Midi. Les élèves du Frère Savinien 23 étaient fameux par la pureté, le naturel et l'aisance de leur français. Plusieurs, que j'ai bien connus, lui firent honneur au premier rang de la presse régionale. Il me souvient entre autres d'un collaborateur du Petit Marseillais, Louis Sabarin. Sa langue était d'un classique et d'un humaniste, bien qu'il n'eût jamais fait que les versions et les thèmes franco-provençaux de Savinien. Bien d'autres ont ainsi contribué à la bonne tenue de nos journaux, d'Avignon à Nice. Par eux a reculé l'affreux méli-mélo des deux langues que jargonnaient Tartarin et Tante Portal : « Menicle, va bayer de civade au cival »; si bayer est un archaïsme vénérable, cival estropie un mot français, et civade couvre et cache complètement le sens provençal d'avoine… « Man ! nous allons s'amuser à la sable… » La sable, comme la lièvre, n'est féminin qu'en langue d'oc et le pronom réfléchi « se » doit être remplacé en français par « nous ». La méthode comparative met tout cela au net en peu de temps. Un enfant qui n'y est pas formé traduira tout simplement le Sieu esta, qu'il a entendu à la maison, par Je suis été ; et l'habitude en sera invincible jusqu'à ce que le sentiment de son barbarisme lui ait été donné au soleil de la comparaison avec le terme régulier J'ai été. Non seulement Savinien réussissait à faire savoir les deux langues, il les faisait s'entr'aider ; la règle des participes est le casse-tête de nos grammaires françaises, mais nos paysannes, nos ouvrières dont l'idiome sonore marque ses muettes en « a » et en « o », font d'elles-mêmes la liaison correcte de l'attribut avec le sujet ou le complément. C'est un assez joli fil conducteur. #
Ce concours spontané de la langue du peuple a été longtemps négligé par nos instituteurs publics. Ils y vinrent. Ceux qui y sont venus s'en sont montrés de plus en plus satisfaits. Très sagement, ils estiment qu'il n'y a aucune raison de se priver d'un tel raccourci vers l'épuration et la correction du langage qui aide à l'éclaircissement du discours. L'État même doit y gagner, car mieux l'homme du peuple entendra le sens des propos qu'il écoute, plus il sera gardé contre les incompréhensions ou demi-compréhensions qui le trompent et le dégradent, quelquefois en le trahissant. Est-il juste de lui refuser ce moyen d'ascension personnelle ? #
Les élèves des écoles supérieures, tout harnachés de grec et de latin, d'anglais, d'allemand, ne sont pas sans tirer eux-mêmes quelque profit des comparaisons du bilinguisme dialectal. Ceux d'entre nos méridionaux qui n'ont parlé que français, dans leur maison bourgeoise, ont dû plus tard quelque chose à la culture parallèle de l'oc et de l'oui après leur initiation aux beaux mystères du Félibrige. Les Daudet, père et fils, en sont des exemples assez en vue. Ils en ont témoigné. La prose de Paul Arène en fait foi. Et Mistral lui-même… Vous avez couronné des traductions de ses poèmes. Elles sont belles et pures. Mais ce n'est rien : d'ici une quinzaine d'années 24, à la publication de sa correspondance, je vous annonce la surprise et la joie de découvrir un magnifique et délicieux écrivain français dans l'auteur de Mireille, d'après les milliers de lettres qu'il adressa à ceux qui ne savaient pas le provençal, et même à quelques autres comme Alphonse Daudet ou votre serviteur. L'écrivain était grand et spontané dans les deux langues. Il en circule déjà des échantillons. Je citerai, merveille pure, sa réponse à la sœur de son ami Bonaparte-Wyse, madame de Rute, qui lui demandait l'autorisation de faire traduire son « Voyage en Italie » de 1891. C'est une pièce d'anthologie : « Pour vous faire plaisir, Princesse… » À celui-là non plus, la méthode comparative n'aura pas nui, compte tenu des plus beaux additifs du génie et de l'art ! #
Refrain (bis ou ter) : de quel droit refuser plus longtemps aux enfants des pêcheurs, des paysans et des pâtres de nos petites écoles un rapide et simple instrument de culture propre à les affiner et à les perfectionner ? Personne d'informé ne comprend rien à cette brimade. Eux pourraient s'en fâcher. #

Le trésor provençal
Une circonstance historique aggraverait l'iniquité de ce refus pour nos pays de langue d'oc depuis le milieu du XIXe siècle. #
Là, en effet, le dialecte a été organisé et équipé en langue normale, et sa Renaissance a mis à la disposition de ceux qui le parlent un trésor littéraire dont on ne saurait trop estimer le charme et la splendeur, ni la valeur morale. #
À peu près sur les mêmes points d'où s'était élevé, en pleine barbarie, le chant des troubadours qui furent les maîtres de chant de la France d'oui et aussi de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Italie, ces initiateurs lyriques de saint François (lui-même fils de la Provençale Dona Pica), de Dante et de Pétrarque, quasi citoyen d'Avignon, sur la même aire géographique ainsi consacrée ont reparu en troupe, au bout de sept siècles, après le Gascon Jasmin et le Marseillais Gelu, de véritables populations de poètes qui, menées par un chef égal aux plus grands, comportèrent plus que des talents de premier ordre : qui veut parler dignement d'Aubanel doit évoquer Musset et Heine, Catulle ou Sapho, et, pour qualifier Roumanille, on ne profane pas le souvenir de notre miraculeux La Fontaine. Autour d'eux, avec des mérites singuliers, gravitaient Félix Gras, Crousillat, Anselme Mathieu, Auguste Fourès, Marius André, Perbosc, Estieu. Philadelphe de Gerde, Folco de Baroncelli, Sully-André Peyre et cet admirable Joseph d'Arbaud pour qui, Monsieur et ancien confrère, vous avez sollicité et obtenu de l'Académie un honneur dont il était digne. De ces poètes, il faut l'avouer, aucun, pas même Mistral, n'a exercé sur l'art poétique de l'univers une influence comparable à celle de Bertrand de Born, de Bernard de Ventadour, de Géraud Borneil et de leurs émules du XIIe siècle. En revanche, quel qu'ait été le mérite historique de ces héros qui tirèrent de rien le printemps sacré d'une poésie, pas un n'égala, même de loin, le génie ou l'art de leurs trois grands successeurs du XIXe siècle, ils n'apportèrent pas une couronne de poèmes comparables à celle des félibres, qui a correspondu à toutes les directions de la poésie comme à tous les mouvements de l'âme, lyrisme, épopée, idylle, élégie, tragédie, comédie ou fable, et qui élabora des chefs-d'œuvre d'ordre classique par la hauteur, la clarté, la science, l'approfondissement et la dignité des matières ainsi traitées. Par son sens singulier du bon et du beau, Mistral a entraîné tout son chœur à créer (détail, mais détail à considérer) une littérature de modèles, d'exemples, de perfection, qui multiplie la valeur sociale de l'œuvre esthétique. #
Si cela est exact, et ce n'est pas niable, il en ressort que, de Pau à Nice, de Bordeaux à Valence, un enfant du peuple, avant tout dégrossissement éducatif, peut se trouver de plain-pied avec des merveilles de lumière, de joie et de consolation ; il lui suffira de savoir les lire. Mais il lui faudra aussi faire un pas que, jusqu'ici, on ne lui enseignait pas à l'école. L'école strictement française lui montrait bien à lire « ai » tantôt comme dans travail et tantôt comme dans maison, qu'au fait o, que l'o suivi d'un u s'adoucit en ou. Grâce à la loi nouvelle, ces avis préalables vont être donnés maintenant pour la lecture du provençal : il sera dit qu'au, ou, ai, se lisent un peu différemment. Rien d'ailleurs de plus simple. Cela peut s'apprendre en vingt minutes. Mettons vingt heures ou vingt jours. Ce n'est rien, comparé au trésor qu'ouvre cette clef. On ne peut chicaner des millions d'écoliers français sur l'avantage qui les fait accéder à la pleine disposition d'une grande littérature. #
Car enfin, comme disait Jules Simon, si ce n'est pas le français, c'est une langue française. C'est, dès l'origine, l'intermédiaire du roman et du français, témoins ces formes du serment de Strasbourg et de la cantilène de sainte Eulalie, plus d'oc que d'oui partout où elles ne sont pas toutes latines encore. Nos origines en sont tellement éclairées qu'on les réclame au stade de l'enseignement secondaire et supérieur. Soit ! Va pour la science en chasse gardée. Mais vous ne pouvez pas réserver à la curiosité d'une oligarchie la gloire, l'harmonie, l'enchantement, le rayonnement de beauté et de vie que de très grands poètes apportent aux plus pauvres mortels. Pour que ces nobles outils de perfectionnement puissent aller tout droit à leur public naturel, la graphie provençale a besoin seulement d'un coup d'épaule de l'instituteur primaire. Vive la loi qui permet ou prescrit de rendre ce service ! La République sera large et magnifique puisque, cet obstacle insignifiant écarté, les richesses nouvelles vont pouvoir s'épancher sur des millions d'âmes et les renouveler. #
Oh ! l'obstacle n'est pas insurmontable sans cette collaboration de l’État ! Nous nous appliquons tout au moins à le tourner depuis cinquante ans. À défaut de la classe de lecture, il y a la classe de musique. Comme Ronsard et Dante, Mistral et ses compagnons ont fait mettre un grand nombre de leurs vers en musique. La chanson de Magali s'est répandue très vite, grâce à l'air noté qui accompagnait le volume de Mireille. Cela ouvrait et indiquait une voie qui ne fut prise que plus tard. Tel que vous me voyez, sourd et ignorant de toute musicographie, j'ai, Monsieur et ancien confrère, fait faire le premier Chansonnier de Provence où chaque poème ait été accompagné de sa musique. Il a fait son chemin et le fait encore, Provençaux et Provençales de plus en plus nombreux se sont mis à chanter La Coupe, L'Aqueduc, Le Renégat, La Race latine, Les Étoiles, La Vieille Chanson, Il pleut et il fait soleil… c'est un mouvement des voix, des cœurs, des esprits qui ne s'arrête plus. Les paroles énergiques et câlines, ardentes et douces, s'envolent sur l'aile du chant, et l'essence précieuse de cette poésie pénètre de plus en plus la race intelligente et vive qui lui est très parfaitement adaptée. Par là, je crois, en grande partie, les milieux pédagogiques autrefois hostiles à l'expérience de Savinien se laissaient conquérir à vue d'œil. Il me souvient qu'au rendez-vous de Maillane, le 8 septembre 1935, cent-cinquième anniversaire de la naissance du Maître, le président du Félibrige, monsieur Frédéric Mistral neveu, me fit connaître un instituteur poète de Marseille (d'ailleurs rouge-rouge), qui s'était mis au premier rang des meilleurs serviteurs de notre poésie chantée. Depuis, j'ai entendu parler d'un pèlerinage mistralien conduit entre Arles et Avignon par les élèves-maîtres de l'École normale primaire d'Aix, comme d'un grand succès qui en prépare d'autres. À Montpellier et surtout à Toulouse, les écoles occitanes sont très actives, grâce à un animateur et un organisateur sans rival, monsieur l'abbé Salvat. Elles groupent ainsi des instituteurs privés et publics, vrais pionniers volontaires de la loi qui vient de naître. Puisque vous vous défendez, Monsieur et ancien confrère, de mettre des bâtons dans les roues à l'expansion de nos libertés, pourquoi leur disputer cette modeste consécration de la loi ? Les libertés qu'elle reconnaît seront deux fois libres ! #
Cette loi vient aussi couronner une très grande chose, qui est un bien national de la France. Je vous ai dit que la Renaissance provençale contemporaine n'avait pas eu l'effet immédiat fulgurant du chant des troubadours au pays du comte Thibaut et de Richard Cœur-de-Lion. Cependant, depuis un siècle que la voix de Mistral s'est élevée, une audience de plus en plus attentive s'est prononcée en sa faveur. Cela a commencé par l'Allemagne (phénomène aussi contrariant pour moi qu'une initiative sensée du M. R. P.) ; après la salutation incomparable de Lamartine et les signes de haute estime prodigués par de grands maîtres parisiens comme Gaston Pâris et Paul Meyer, c'est l'Allemagne qui fut la plus empressée à traduire et à commenter nos poètes. Il y eut tout de suite des chaires de provençal dans ses universités. L'Amérique suivit, enfin l'Espagne et l'Italie, avec des traductions complètes, quelques-unes vraiment admirables. Chez nous, dans la France du nord, les plaisanteries d'Alphonse Daudet, irrésistibles et perfides, ont peut-être égaré, retardé le jugement et le goût. C'est le propre fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet, qui a renversé le mouvement. De lui date un retour d'opinion certain et tel que votre ancien confrère, Jacques Bainville, natif de Vincennes, apprenait le provençal, comme Lucien Dubech, natif de Romorantin, pour le plaisir de lire Les Olivades et Le Poème du Rhône dans les originaux. Les accusera-t-on de tiédeur pour la langue de Voltaire et de Bossuet 25 ? Il y a dans Jaco et Lori une page déjà classique, où, faisant parler les oiseaux de la forêt brésilienne, l'auteur montrait en quoi le Français de Seine et de Loire passe toutes les langues civilisées, en ce qu'il parle et qu'il ne chante pas. Où sera le malheur, s'il existe d'autre part un Français qui chante ? Tout profit pour la France ! Et que ce chant français ait été conduit aux derniers confins du sublime par l'Homère nouveau et par ses homérides. La nouvelle loi en prend conscience. Bravo pour la nouvelle loi ! #
Je viens, sans y songer, d'écrire le plus grand nom de l'histoire de la poésie. Je ne pouvais ni le retenir ni le pallier. On ne peut trouver de pair à Mistral que sous la plus haute coupole. Voulez-vous un exemple ? Il y a dans les lettres européennes quelques beaux sonnettistes dont l'œuvre m'est particulièrement présente à l'esprit, Ronsard, du Bellay, Pétrarque, Dante. Si je lis un certain sonnet de Mistral « à la fille du peintre Réaltu », il me devient impossible de découvrir chez l'un de ces quatre grands poètes quelque chose à y comparer. #
Vous éprouverez peut-être la même hésitation à la lecture même de la traduction. #
Les quatrains ont la belle allure du départ d'un chef-d'œuvre, mais voyez les tercets : #
Autant comme autrefois notre reine Hermangarde,
Tu as personnifié ton grand Arles muet,
Ton Arles, cette veuve Artémise qui garde, #La gloire des ancêtres enfermée dans la tombe,
Qui porte les arènes en couronne et regarde
Sur le Rhône là-bas s'en aller les vaisseaux… #
Je ne crois pas qu'il existe un autre poème à forme fixe ouvrant ainsi sur les deux infinis de l'espace et du temps. #
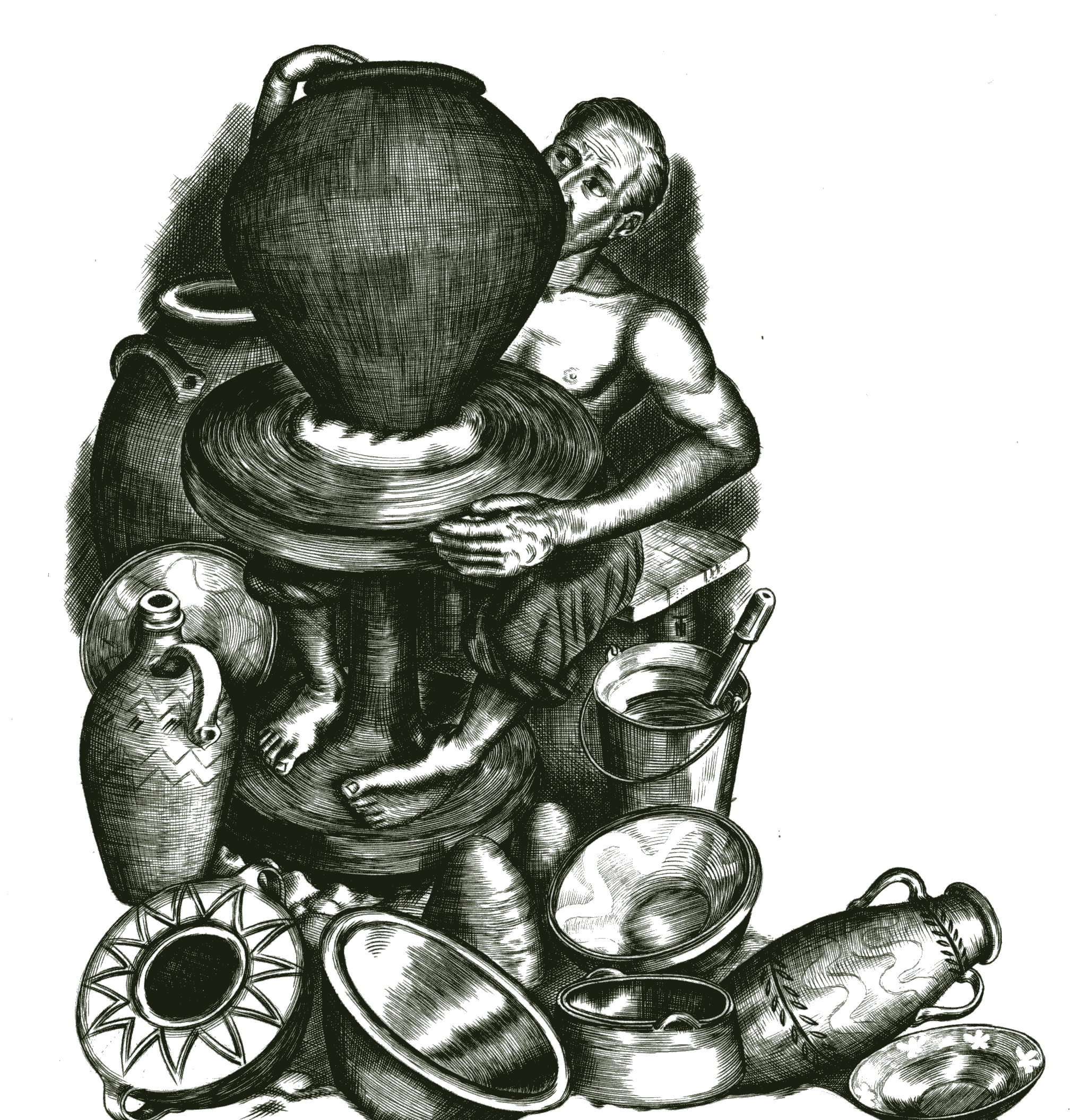
Avec l'accent oriental qui donnait une saveur unique à sa phrase, mon maître et ami Moréas me dit un jour #
« C'est un grand poèté, votré Mistral ? #
— Oui. #
— Un très grand poèté ? #
— Très grand. #
— Un plus grand poèté qué moi ? #
— Certainement. » #
Il me regarda et conclut : #
« Vous né lé croyez pas ! » #
Je le croyais et je le crois, sans faire aucun tort aux rares beautés d'Œnone, des Syrtes, des Stances et de la délicieuse Ériphyle. #
La grandeur mistralienne a quelque chose d'unique dans l'art français ; lorsque, par un autre exemple, la critique étrangère s'occupe de trouver en France un grand esprit de philosophe doublant le génie lyrique du type de Goethe, notre confrère de Bruxelles, M. Paul Dresse 26, a considéré tour à tour nos classiques, puis Lamartine, Hugo et ses épigones, dont aucun ne répond à ce qu'il cherche, il va naturellement tout droit à Mistral. Cela ne fait aucun mal à la France. Elle en a tout l'honneur. Il est d'intérêt national que le plus grand nombre possible de Français prenne un fier sentiment de ce rayon de gloire nouvelle. #
Quant à appréhender aucune concurrence entre les littératures ou les idiomes, il faudrait tenir compte de certaines proportions qui sont acquises dans l'étendue et dans la durée. Pas plus que les deux ou trois circonscriptions flamandes de Dunkerque, Hazebrouck et Saint-Omer, ou qu'un arrondissement basque, les deux départements et demi de Bretons bretonnant, ou les deux départements alsaciens ne sont de taille à se mesurer avec les vastes et puissantes possessions d’État du Français de Paris, les vastes secteurs occupés par les dialectes très variés des langues d'oc ne peuvent donner aucun ombrage ; le français d'oui y fait, de Paris, une forte figure de frère aîné. Son droit acquis n'est plus muable. Trop d'intérêts, d'habitudes, de plaisirs même y ont été incorporés. Un Alsacien régionaliste et patriote pouvait dire comme le regretté M. Oberkirch à Maurice Pujo : #
« Oui, nous sommes de race germanique, mais nous avons besoin du français comme du signe et de l'instrument du progrès », et tant que la France n'aura pas été la proie d'un européanisme insensé, tant que nous ne nous serons pas abandonnés nous-mêmes, l'élite alsacienne gardera pour prédestination et pour mot d'ordre la formule de M. Oberkirch. Le Provençal et le Gascon ne sont pas d'une autre race historique que le Parisien où le Tourangeau, et eux aussi ont besoin du français d'oui comme de l'expression indispensable d'une large part de leur Histoire et de leur personne. Ils ne se connaîtraient ni se reconnaîtraient sans lui. Louis XIV avait raison de fonder, avec lettres patentes, son Académie d'Arles, où bourgeois, lettrés, savants, magistrats l'aidaient à reculer les confins du français. Mais les justes bornes étaient touchées dès la fin du siècle suivant, comme en témoignent le style et la langue des discours prononcés en 1789 au Conseil de ma petite ville, d'après nos registres municipaux. Ainsi Louis XVIII n'avait-il pas tort de citer des vers de Goudouli 27 à l'oreille de son toulousain de ministre, M. de Villèle, qui ne les reconnaissait pas. Vers 1889, le premier comte de Paris, grand-père du noble prince qui porte aujourd'hui son nom 28, tenait Mistral pour le poète et chef d'une renaissance française, voix du pays et de son fond paysan, interprète lyrique de la famille-souche, de l'héritage des ancêtres et du retour aux antiques prospérités : celui qui eût régné sous le nom de Philippe VI eût certainement fait de Mistral un poète-lauréat, comme dit la vieille Angleterre. Du moins essaya-t-il de le faire élire à l'Académie par l'influence de votre confrère le conte d'Haussonville ; si cela ne put s'arranger, c'est que Mistral voulait prononcer son discours en provençal, ce que ne permettaient pas les statuts du grand Cardinal. L'influence du prince ne fut pas étrangère aux distinctions brillantes dont la Compagnie honora l'Altissime. Le comte de Paris dit un jour à son fils aîné, ce magnifique duc d'Orléans qui aurait dû régner sous le nom de Philippe VIII, que le temps était venu pour lui de faire une lecture approfondie de Mireille : #
« Je vais la faire, dit le dauphin, mais à une condition. #
— Laquelle ? #
— C'est que mon père, en même temps, veuille bien lire La Faute de l'abbé Mouret, de M. Zola. #
— Entendu ! » #
Les harmonies de Mireille enivrèrent le jeune prince. #
Il en témoigna aussitôt. #
« Mais, dit-il sans perdre le nord, et Zola ? » #
Un nuage se répandit sur le visage du comte de Paris : #
« C'est, répondit-il, un grand talent bien mal employé. » #
Formule lapidaire, il n'en fut pas appelé. #
Une quinzaine d'années plus tard, à Londres, comme il recevait quelques Provençaux provençalisant : #
« Ah ! je vous connais bien, dit le duc d'Orléans, vous voulez nous faire parler provençal à Paris. #
— Non, Monseigneur, répondirent-ils, nous voudrions seulement qu'il y eût à Paris un théâtre lyrique de langue d'oc à la place de l'ancien théâtre italien, le provençal ayant toutes les vertus mélodiques des langues du Midi. #
— Ah ! que vous avez raison, s'écria le jeune prince, et il se mit à fredonner en preuve la chanson de Magali dans son merveilleux texte original, bien supérieur, disait-il (en disant pourquoi) à celui de Gounod. #
— Mais, Monseigneur, d'où vous vient tout ce provençal ? #
— Du collège Stanislas, de Cannes. J'y ai passé deux ans. C'est ce que j'y ai appris de plus beau. » #
L'unité des terres de France n'avait pas à souffrir de la préférence avouée par l'arrière petit-fils de leurs Rassembleurs 29. #
L'instinct national et royal avait reconnu dans le fondateur du Félibrige un maître du nationalisme français, autant dire d'un patriotisme renouvelé par les éléments les plus concrets de la substance maternelle, l'esprit de son Histoire, l'âme des paysages, le cœur de son cœur. Lui-même sut parfaitement ce qu'il voulait faire et ce qu'il faisait dès les premiers temps de son entreprise. Les vers divins que voici sont vieux de près de trois-quarts de siècle. Ils ont été prononcés à Toulouse, après que le poète s'y fût présenté comme Français baptisé par saint Louis ; ils sont assez beaux pour traverser une traduction qui n'amortira ni la chaleur ni la splendeur : #
Ainsi le Félibrige, enfant de la Provence,
Réveillait en chantant le Midi endormi,
Et des brins d'olivier que la Durance pousse,
Il couronnait gaiement les joies et les souffrances
Du peuple son ami. #Au peuple il apprenait la grandeur des ancêtres,
Il lui sauvait sa langue et son nom, il lui faisait
Respecter les coutumes, honorer les croyances,
Enfin, de la patrie, il était comme le prêtre,
Et il la bénissait. #Pareil au soleil de juin qui adoucit la merise,
Ainsi le Félibrige tempérait les querelles
De l'âpre politique où le cœur hait,
Pour la France faisait croître des patriotes
Enthousiastes du pays. #
Per la Franço fasie creisse
De patrioto afouga dou pais #
Telle fut bien l'œuvre solaire de Mistral et de sa doctrine. Le poète sacré tint parole. Il suscita une génération d'esprits français passionnément épris de la France. Barrès avait alors quatorze ans ; Léon avait dix ans, moi neuf 30. Oui, toute notre génération des nationalistes de 1900 31, celle qui suscita le réveil national de 1912–1914, a été fortement imprégnée de Mistral. Et ce sont des milliers et des millions de petits Provençaux, Languedociens, Gascons, Limousins, Auvergnats, Dauphinois dont le chant sacré de Mistral a béni et bénira la fidélité. #
Ai-je dit tout ce qu'il fallait pour répondre à tout ? #
Peut-être reste-t-il une objection en réserve. Mais elle n'est pas avouable. Vous ne la direz pas de vous-même. Et je ne crois pas que vous partagiez le sentiment d'envie qui la dicterait. En faisant circuler parmi eux cette magnifique coupe de poésie, en mettant à leur portée la méthode comparative de l'enseignement secondaire, l'école bilingue courrait le risque de trop favoriser nos jeunes primaires ; ils en deviendraient trop savants, trop sages, trop cultivés, trop heureux, et bien au-delà de ce que peut permettre l'égalité jalouse de la démocratie. #
L'uniforme niveau proposé aux communs enfants de la France doit-il leur être imposé, selon l'avis de Proudhon : La démocratie, c'est l'envie ? Je ne crois pas qu'une pareille tentation puisse entrer dans un cœur bien fait. #
Et puis, on peut essayer de la faire taire, sinon de l'apaiser. #

Car enfin, tout n'est pas égal entre le midi et le nord de la France. Celui-ci jouit de grands avantages. Et, même régénérées par un mistralisme florissant, nos populations garderaient des faiblesses qui sont de taille. Je ne pense pas seulement au fameux accent. On ne saurait perdre de vue qu'une langue savante et apprise, venue en partie du dehors, ne peut pas charrier avec elle la totalité de ses mots concrets ; de ce fait il subsiste de grands espaces innommés et comme muets dans le champ des objets usuels, noms de plantes, de fruits et de fleurs pour ne désigner que ceux-là. #
J'ai vu de grands garçons, non pas même illettrés, mais bacheliers, licenciés, voire docteurs, qui n'ont jamais eu l'idée de la merise, ils n'ont connu que l'agriote parce qu'ils sont nés au sud de la Loire ; pour la même raison, le pissenlit a-t-il gardé pour quelques-uns le pittoresque sobriquet d'angi boufaréu. Que de termes utiles ont le même sort ignoré ! À la Chambre de la IIIe République, il n'était pas rare qu'un député méridional, traitant du cheptel, le prononçât comme il s'écrit, au scandale indigné des représentants de l'Ouest. #
Le privilège de l'école bilingue, si précieux fût-il, compenserait à peine l'infériorité géographique qui tient à l'éloignement matériel de Paris… Mais je rougirais de prolonger un débat qui serait indigne d'une nation de frères. #
La France vit une minute d'Histoire où elle a besoin d'être forte et solide partout, sous tout rapport, et face à tout événement. #
Il faut revoir de près toutes nos positions. #
Celles qui sont fondamentales ne sont pas le moins menacées. #
Ne nous trompons pas sur ce qui doit être renforcé en tout premier lieu, car les pressions de la Barbarie s'accentuent en raison de la circulation des idées ravageuses par le journal, la radio, l'école elle-même ; elles viennent heurter à nos portes et ne les ébranlent que trop. Cherchons, démêlons, désignons les éléments de vraie résistance. #
J'ai la spécialité d'un vieux guetteur de tour et reconnais parmi nos assaillants des contemporains de ma petite enfance, d'autres de ma jeunesse ou de ma maturité ; de plus en plus nombreux et de pires en pires, surtout quand ils sont masqués de patriotisme alimentaire ou de civisme profiteur. #
Tant de Barbares ne seront mis en échec qu'au moyen d'un redoublement de précautions naturelles, et défensives, d'un puissant développement de conscience et d'amitié nationale. Un trinôme résume les cinquante ans de ma vie politique : #
Armons, armons, ARMONS, en vue de préserver nos fraternités-nées de peuple historique. #
Or, c'est précisément une arme de défense nationale et sociale qui nous est offerte par la loi du dialecte à l'école. Les M. R. P. ne l'ont certainement pas fait exprès ; il n'en faut pas moins l'accepter de leurs mains poisseuses et sanglantes, si l'on veut que vivent, survivent et revivent certaines parties trop mourantes de notre magnifique pays. #

Georges Duhamel (1884–1966) est plutôt à ranger parmi les adversaires politiques de Charles Maurras. Si celui-ci l'appelle son « ancien collègue » c'est sans doute en raison de leur passé commun d'académiciens. (n. d. é.) [Retour]
Cette mention n'existe que sur la seconde édition. La première ne contient d'ailleurs que cinq poèmes ; quatre ont été repris dans la seconde, avec six nouveaux. Aucun de ces onze poèmes n'étant en liaison directe avec le texte de la lettre à Georges Duhamel, nous ne les publions pas ici. Les illustrations reprennent celles des deux éditions des Jarres de Biot illustrées par Tavy Notton. (n. d. é.) [Retour]
La première édition porte le pluriel celles. (n. d. é.) [Retour]
Le véritable terme est « étouffé » et non « étranglé ». Henri-Auguste Barbier (1805–1882) publia son premier recueil de poèmes, Iambes, en 1831. Musset le met en scène dans une pochade de 1833, Le Songe du Reviewer ou Buloz consterné. Buloz, depuis peu directeur de la Revue des deux mondes, y fait un cauchemar, dans lequel chacun de ses rédacteurs lui fait faux-bond pour le prochain numéro :
(…) George Sand est abbesse
Dans un pays lointain ;
Fontaney sert la messe
À Saint-Thomas-d'Aquin ;
Fournier aux inodores
Présente le papier,
Et quatre métaphores
Ont étouffé Barbier (…)(n. d. é.) [Retour]
Joseph Paul-Boncour (1873–1972) fit une très longue carrière politique, dans la mouvance socialiste. Il fut président du Conseil pendant quelques semaines, à cheval sur 1932 et 1933. Les Mémoires dont parle Maurras ont été publiés en trois tomes, chez Plon, en 1945–1946. (n. d. é.) [Retour]
Référence, courante sous la plume de Maurras, à la pièce d'Aristophane Les Oiseaux. Voir par exemple la note 77 à notre édition de L'Idée de la décentralisation, ou la note 19 de la troisième partie des Trois Aspects du président Wilson. (n. d. é.) [Retour]
Summer Maine. [Retour]
Rouchon Guignes : Histoire de Provence. [Retour]
Tiré du second tercet du Lauda Sion Salvatorem de saint Thomas d'Aquin :
Quantum potes, tantum aude,
Quia major omni laude,
Nec laudare sufficis.De multiples traductions en ont été données :
Tout ce que tu peux faire, tu dois oser le faire,
car Il est au-dessus de toutes tes louanges,
et tu ne pourras jamais assez Le louer.(n. d. é.) [Retour]
Leurs idées ont été recueillies à cette époque dans le petit livre d'un poète journaliste, Charles de Saint-Cyr : Ce qu'il faudra que soit la France de la Victoire (1917). [Retour]
Singulièrement prophétique à cet égard, son Rocher de Sisyphe, inséré dans Les Îles d'Or, date du 1er septembre 1871. [Retour]
Doctrine antimilitariste professée par Gustave Hervé (1871–1944) avant la Grande Guerre, prônant le recours à la grève générale et à l'insurrection en cas de mobilisation, ce qui séduisit Jaurès et Briand. Voir également la note 4 à notre édition de La Monarchie fédérale, et la note 8 de « La Politique » du 11 septembre 1921. [Retour]
Les Grecs avaient la Patrie et la Matrie. Chateaubriand a relevé le second terme dans notre sens provincial. Il a été repris systématiquement en Provence par M. de Berluc-Perussis, en félibrige A. de Gagnaud, l'érudit historien ami de Mistral. [Retour]
Voir L'Étang de Berre. [Retour]
Athanase de Charette (1832–1911), de son nom complet Charles-Marie Athanase de Charette de la Contrie, s'illustra notamment à partir de 1860 comme commandant du corps des Zouaves Pontificaux, qu'il engage après la prise Rome dans la guerre contre les Prussiens, sous le nom de corps des Volontaires de l'Ouest. (n. d. é.) [Retour]
Le 2 décembre 1870, après la défaite de l'Armée de la Loire à Loigny, le corps des Volontaires de l'Ouest résiste aux Prussiens à Patay, mais l'ennemi parviendra à investir Orléans le surlendemain. (n. d. é.) [Retour]
Paul Lafargue (1842–1911) et non La Fargue, théoricien révolutionnaire, gendre de Karl Marx. On lui attribue généralement cette formule de « grues métaphysique » pour désigner les notions de Justice, de Liberté, de Patrie, qui « font le trottoir dans les discours académiques et parlementaires, les programmes électoraux et les réclames mercantiliques », comme il l'explique en note dans Le déterminisme économique de Karl Marx, publié en 1909. L'expression est également parfois attribuée à Karl Marx lui-même, ou à Blanqui. [Retour]
Nous devons à l'Étranger l'esprit du De Monarchia dantesque, la politique de Saint Thomas, le livre expressif et confus de Burke (dont je n'ai jamais pu voir la fin), une page sublime de Poe, l'œuvre de l'école indianiste, Summer Maine et Lyell, le lyrisme fameux de Carlyle, quelque théologien espagnol, pas un Allemand (toute l'école hégelienne nous contredisant à angle droit), l'Autrichien Vogelsag, le Russe Pobiedonoseff, il faut convenir que c'est tout. [Retour]
Ce néologisme est de l'Action Française de 1899. [Retour]
L'Enfant d'Agrigente, par le père A.-J. Festugière. [Retour]
Voir la note 3 à notre édition du texte sur Les Humanités classiques paru en 1929. (n. d. é.) [Retour]
Je ne formule aucune hypothèse. Cette maxime aurait été énoncée pour la première fois par Isaac Newton, dans une lettre adressée à Robert Hooke, au plus fort de leur controverse sur la paternité de la découverte du principe de la gravitation universelle. Elle a en tous cas été sacralisée par la suite comme résumant la démarche d'esprit de Newton. Dans la première édition de Jarres de Biot, le texte imprimé est Hypotheses aud fin go, et dans la seconde Hypotheses Hand fingo. Seul Hypotheses haud fingo, variante de la citation attribuée à Newton, eût été correct. Nous avons rectifié. Ces errances typographiques ont au moins l'avantage de prouver que Maurras n'a pas eu accès aux épreuves pour les corriger, et que la ou les personnes chargées de cette tâche n'ont guère fait preuve de zèle, ni de culture. (n. d. é.) [Retour]
Joseph Lhermite (1844–1920), dit Frère Savinien, fut entre autres Majoral du Félibrige en 1886. (n. d. é.) [Retour]
C'est à dire, par anticipation, après le cinquantenaire de la mort de Frédéric Mistral. La correspondance complète de Mistral a effectivement été publiée, un peu plus tard, en 1969. (n. d. é.) [Retour]
En sa séance du 17 mars 1933, un rapport de la société savante locale a constaté que Mistral « semble s'acclimater, depuis quelques temps, à Orléans », soit en l'un des lieux où le français a la réputation d'être le mieux parlé. Le 26 juin 1938, dans cette même capitale d'outre-Loire, un nombreux concours de jeunesse étudiante, ayant notamment à sa tête un ancien élève de l'École d'Athènes, l'excellent critique Robert Lejeune, accueillait l'auteur de Mare E Lono par les sept couplets et le refrain de la Coupo Santo, tous chantés de bout en bout dans leur langue mistralienne. [Retour]
Paul Dresse de Lébioles (1901–1987), écrivain liégeois, fut entre autres auteur d'ouvrages sur Charles Maurras et Léon Daudet. (n. d. é.) [Retour]
De son nom francisé Pierre Goudelin (1580–1649), poète toulousain de langue occitane. (n. d. é.) [Retour]
Ici Maurras écrit trop vite ; il faut bien entendu lire grand-oncle. (n. d. é.) [Retour]
On se demande : Si Mistral avait vécu sous Louis XIV, les cérémonies chantées de Molière comporteraient-elles tant d'italien et d'espagnol ? [Retour]
La première édition porte le décompte fautif « Barrès avait alors quatorze ans, Léon Daudet, dix-neuf. » L'événement devait se dérouler en 1877, et Léon Daudet avait effectivement dix ans. (n. d. é.) [Retour]
Sans exception pour le Lorrain Barrès qui, lors de l'incubation de ses Déracinés, avait pour secrétaire le Provençal Frédéric Amouretti, un des hommes qui ont le plus puissamment réfléchi et systématisé la pensée de Mistral. [Retour]

