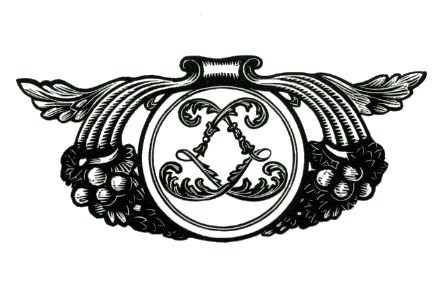C'était au milieu de la Fronde, le jour où la reine-mère et son cardinal s'occupaient de faire mener le grand Condé à Vincennes. #
… Le petit roi, qui avait douze ans, se doutant de quelque chose, rôdait, tournait, allait des jupes à la robe, attentif, curieux, inquiet… Que se passait-il ? On lui cachait quelque chose. #
— Allez ! Allez ! lui répétait Anne d'Autriche. #
J'ai toujours aimé l'historiette. Elle prendra un sens plus vif et pourra paraître révélatrice si l'on se souvient de lignes écrites soixante-cinq ans plus tard dans le testament où furent prévus les « Conseils de la Régence » : #
Aussitôt que le roi aura dix ans accomplis, il pourra y assister comme il voudra, non pour ordonner et décider, mais pour entendre et prendre les premières connaissances des affaires. #
« Dix ans accomplis », stipulait le vieux roi. Les rois de France étaient majeurs à treize. L'aïeul ne pouvait viser le droit, mais il songeait au fait : l'intérêt, le désir, la secrète ambition d'un petit prince qui grandissait. Il en prêtait les obscures agitations au futur Louis XV. C'étaient les siennes. Elles lui revenaient dans leur verdeur et leur violence. D'autres enfants jouent au soldat, font des chapelles, seront guerriers ou clercs. Celui-ci, obsédé du démon politique, n'y jouait même pas, et c'est en toute gravité qu'il repensait plus tard à ce qui avait causé une si sérieuse impatience à ses années de minorité. #
« J'étais roi, né pour l'être… », disent des confidences de son impérieuse jeunesse. Ses tuteurs, la reine, Mazarin, l'avaient bien servi, ils avaient gardé et sauvé son royaume ? Il leur en était reconnaissant, les aimait peut-être, leur rendait en tout cas tous les offices de l'affection : sur le point délicat, sur la plus dure épreuve du cœur, le cardinal, oncle de Marie Mancini, avait su élever l'État et l'intérêt du trône au-dessus de tout. Louis dut s'en rendre compte, et cela explique le ton de certaines paroles dont bénéficie Mazarin. Mais il n'en aspirait pas moins à la seule indépendance qui compte : au commandement. S'il respectait le premier ministre, l'idée du Ministère lui était odieuse. Il respira quand il en fut délivré : « Si vous m'en croyez, mon fils et tous mes successeurs après vous, le nom sera pour jamais aboli en France, rien n'étant plus indigne que de voir d'un côté toute la fonction, de l'autre le seul titre de roi. » #
De ce moment, la royauté n'est plus un titre, c'est une action, il n'y a plus de place pour un maire du palais. L'activité du nouveau roi égale et passe tout ce qu'ont pu tenter les meilleurs fondés de pouvoir de la monarchie. #
Pour la honte éternelle de ceux qui imputent à la royauté des sentiments d'étroite jouissance privée, Goethe disait du prince qu'il avait servi : #
— Ce maître, quand j'y pense vraiment, qu'a-t-il été de tout temps, sinon un serviteur ? Le serviteur d'une grande cause : le bien de son peuple ! S'il faut donc à toute force que je sois le serviteur des princes, au moins ma consolation est-elle d'avoir été le serviteur d'un homme qui était lui même serviteur du bien général. #
Ainsi, le roitelet de Weimar est montré homme du devoir dans l'exercice régulier de sa magistrature. #
Le cas de Louis XIV est un peu différent. Ce qui fut ou qui put être vertu en lui participe du caractère d'une passion avouée, et vivace, et pleine d'honneur. #
Entendons-le conter comme il a travaillé quand il en eut la liberté, dans les dix années qui ont suivi la mort de Mazarin pour rappeler tout ensemble la persévérance de son effort et le doute que l'on faisait sur la durée de ce beau zèle. Les uns pensaient qu'un bon serviteur finirait par s'emparer de l'oreille et de l'œil du maître. D'autres ajournaient tout jugement à l'issue de l'expérience. #
Mais lui : #
Le temps a fait voir ce qu'il en fallait croire, et c'est ici la dixième année que je marche, comme il me semble, assez constamment dans la même route, ne relâchant rien de mon application, informé de tout, écoutant mes moindres sujets ; sachant à toute heure le nombre et la qualité de mes troupes, et l'état de mes places ; donnant incessamment mes ordres pour tous leurs besoins ; traitant immédiatement avec les ministres étrangers ; recevant et lisant les dépêches ; faisant moi-même une partie des réponses et donnant à mes secrétaires la substance des autres ; réglant la recette et la dépense de mon État ; me faisant rendre compte directement par ceux que je mets dans les emplois importants ; tenant mes affaires aussi secrètes qu'aucun autre l'ait fait avant moi ; distribuant les grâces par mon propre choix et retenant, si je ne me trompe, ceux qui me servent, quoique comblés de bienfaits pour eux-mêmes et pour les leurs, dans une modestie fort éloignée de l'élévation et du pouvoir des premiers ministres. #
Ce gouvernement personnel signifiait les extrêmes vigueurs d'une intelligence et d'une volonté, il y fallait le gouvernement de soi-même. #
Car, si l'action royale appuie naturellement sur des ministres, des courtisans, des sujets, la pointe la plus vive en doit être retournée et appliquée sur le monde secret, trouble, tumultueux que l'homme porte en lui. La vie intérieure du roi venait de loin. Les années de minorité ont servi à le creuser, à le modeler, à lui donner le sentiment de ce qu'il devait être. À quarante-et-un ans, ses maximes continuent de refléter une pensée en travail continuel, poursuivant et fouillant tous les moindres replis qui pouvaient donner un asile à la paresse, à la distraction ou à l'indulgence. Un soin particulier, une application universelle, aboutissait à l'examen de conscience, pour le contrôle et la contrainte de soi. Je voudrais bien savoir dans quelle Salente 1 démocratique, aristocratique ou bourgeoise un citoyen-roi ou un seigneur-prince put jamais se complaire à multiplier ces duretés contre son cœur : #
Il faut se garder contre soi-même, prendre garde à son inclination et être toujours en garde contre son naturel. Le métier de roi est grand, noble, délicieux quand on se sent digne de bien s'acquitter de toutes les choses auxquelles il engage ; mais il n'est pas exempt de peines, de fatigues, d'inquiétudes. L'incertitude désespère parfois, et quand on a passé un temps raisonnable à examiner une affaire, il faut se déterminer à prendre le parti qu'on croit le meilleur. #
Voilà le sacrifice essentiel. Il consiste à résoudre enfin et à se détacher de l'étude, de la réflexion, de la délibération, pour arrêter une décision ; c'est donc le renoncement aux oscillations si douces, mais stériles, de la pensée. Le choix seul permet d'agir, si pénible qu'il soit de s'y résigner ou de s'y contraindre ! #
Son espèce de plainte obscure laisse bien voir que pour ce grand esprit il n'existait pas de grâce d'État infaillible, le risque d'erreurs à courir était toujours senti et présent, mais quoi ! l'application, la bonne volonté, le travail (encore !) doivent aider contre la surprise ou la malchance. En dépit des mauvais destins, le tenace labeur royal paie, comme tout labeur. #
Et alors… oh ! alors, lisons ceci : #
Quand on a l'État en vue, on travaille pour soi ; le bien de l'un fait la gloire de l'autre. Quand le premier est heureux, élevé et puissant (l'État), celui qui en est cause en est glorieux et, par conséquent, doit plus goûter que ses sujets, par rapport à lui et à eux, tout ce qu'il y a d'agréable dans la vie. #
Cependant l'esprit politique est en garde. Par une méfiance digne d'Ulysse, on ne s'endort pas dans les agréments du pouvoir ; se rappelant la condition d'homme, on ajoute vite : #
Quand on s'est mépris, il faut réparer la faute le plus vite qu'il est possible, et que nulle considération l'empêche, pas même la bonté. #
Ce trait aigu avoue une âme : — D'abord l'œuvre, d'abord l'État ; tout y est soumis, et, le beau premier, lui-même, travailleur que rien n'arrête dans ce qu'il doit à sa tâche, pas même une apparence de dureté. #
Nous sommes loin de Télémaque ! Et même du bon duc Charles-Auguste de Weimar. #
Étant et devant être « le plus grand roi du monde », comme le voulait Mme de Sévigné, le roi de France écoute d'autres conseils que l'impératif absolu des moralistes. Sa voix intérieure n'est pas immorale, mais n'omet pas de lui chanter les conditions du devoir qu'il a consenti : — Si tu veux ceci : la prospérité de tes peuples, la dignité de ta puissance, la gloire de ton règne, il faut aussi te plier à vouloir cela : cet effort. #
Et, jour par jour, heure par heure, Louis XIV a voulu et fait cet effort. Non en moine, non en ascète, ni en exécutant d'un théorème de doctrine. Se mouvant dans le cadre de sa foi religieuse, de ses traditions de famille, de ses goûts personnels, il se livre ardemment, sciemment aux arts de l'action, à sa poésie enivrante. #
Quelle action ? Celle qui a prise sur la matière humaine pour la sauver, la préserver, l'améliorer — l'action que veut l'état de roi. #
Cela est clair et ordonné. Cela se suit. Mais il ne faut pas en conclure que ce soit affaire de raison pure ou simple obéissance à la raison pratique. On a beaucoup abusé de ces mots pour Louis XIV, pour son siècle. Aussi les comprend-on assez mal. Il nous faut voir que leurs mobiles les plus élevés n'en excluent pas de plus humbles, qui sont fort complexes : corporels autant et plus que spirituels. #
Dans le vrai sens du terme, le rationnel est quelque chose de mathématique et de juridique, de légal et de régulier, qui, donné en partage à toutes les personnes humaines, ne peut ni monter, ni baisser, ni flotter, ni varier comme les valeurs individuelles. Or, s'il y a des maximes universelles pour faire des comptes justes, s'il y a des principes éternels pour conseiller des actes moraux, il n'existe pas de recette pour régler, à coup sûr et heureusement, la conduite des intérêts publics ou privés. Savez-vous ce qu'en disait lui-même ce roi « si raisonnable » ? — Cela s'apprend, cela ne s'enseigne pas. Si c'était raison pure, cela s'enseignerait. Non, ce n'est pas affaire de raison. Ni, moins encore, de fantaisie, de passion ou de sentiment. Cela dépend d'une faculté singulière, qui est mixte, tenant du corps, tenant de l'âme, éclairée par en haut des rayonnements de l'esprit, nourrie des résidus les plus subtils et les plus volatils de l'expérience charnelle, se perdant et se retrouvant, sans cesse, au jour le jour, dans le va-et-vient des images, chargées et colorées des peines et des joies de la vie. Cette faculté mystérieuse s'appelle le jugement. C'est, par excellence, le don des chefs, des maîtres et des rois. Il leur est inné. #
Par une symétrie secrète, le pouvoir judiciaire est la pièce essentielle de la royauté : ainsi le jugement fait le point central de ce qu'il y a de plus vif dans la personne, l'âme, l'esprit d'un chef. Qu'il s'agisse de la connaissance et du choix des personnes ou de l'option entre les vues, desseins, idées, plans et programmes, ce nom de « jugement » revient sans cesse dans les commentaires que Louis XIV donne de son règne et de son action. Si l'on en pénètre bien le motif, on délivrera son portrait de toutes les vaines réminiscences cartésiennes ou fictions scolastiques dont on l'a barbouillé. Louis Bertrand 2 a dit avec une vérité souveraine que le grand roi incarnait toutes les idées de son siècle, la somme de ce qu'ont voulu et pensé alors les élites françaises. Mais cela ne signifie rien qui ressemble au moindre parti pris d'incarner un système. Sa foi catholique était forte et simple comme sa conscience de prince chrétien, responsable devant Dieu seul, et soumis à toutes les rigueurs de son commandement. Dans ce cadre fort étendu, où il s'en remettait de la théologie aux théologiens, il se tenait pour un juge indépendant (ou absolu, ab-solutus) qui n'était lui-même tenu qu'à remplir ses devoirs d'enquête, d'étude, de réflexion, de méditation. Là donc, toutes ses idées sont concrètes : qu'est ceci ? que veut celui-ci ? Politiques, juridiques, domestiques, morales, elles vont au-devant des hommes et des choses pour s'imprégner de leur nature et savoir ce que, répartiteur et ordonnateur, il peut et doit en tirer. Certains cas sont typiques. D'autres sont cas d'espèce. Les uns et les autres doivent être appréciés. Cela n'a rien de commun avec une application machinale de principes ou de textes. Point de gaufrier rigide à plaquer sur une molle et humide argile. Toute pâte humaine est résistante, elle comporte des degrés et des modes contraires. Ce qu'il lui faut est quelque chose qui soit humain. Disons : la main royale, fine, forte, ferme, capable de prendre la mesure des êtres et des événements et d'y rencontrer à tâtons le point sensible, sur lequel elle pourra peser, agir, imprimer une direction. #
Le secret, s'il existe, est là. Rien ne sert de le connaître à qui ne le possède pas. Mais on peut s'en consoler si l'on comprend bien que la judiciaire du chef fait le nerf de son action, le principe de son bonheur. #
Pour les formules toutes faites, le roi les connaît assez bien pour s'emparer de celles qui peuvent convenir. Sans même en adopter aucune ou en en inventant de neuves, c'est au réel qu'il pense et qu'il soumet d'abord sa pensée. Le marquis de Roux 3 a fait un beau livre de la manière dont le roi s'est conduit envers les provinces conquises. Manière très diverse. Un but, invarié, national et royal, la construction d'une France forte. Pour y aller, tous les chemins ! Encore faut-il apprécier le plus court, le plus doux, le mieux approprié à ce qui est voulu et visé. C'est devant le fait et sur le terrain que l'on se prononce. Parfois, des serviteurs zélés accourent apportant à leur maître des modèles d'action régulièrement conçus, engrenés, enchaînés. Que voilà des schémas théoriques ! Mais ils vivent surtout dans le ciel évidé de leur abstraction. Louis qui voit et lit tout écarte d'un revers de main tout ce qui se recommande d'impératifs rigoureux. Sans qu'il en tire une doctrine, ni une méthode, il veut le flexible, le vivant, le modelable et surtout le souple. C'est le terme auquel revient toujours l'historien. Le marquis de Roux nous montre comment l'assimilation, l'unification a varié du Nord au Midi. Les opiniâtres flamands, les narquois et remuants Alsaciens font respecter en partie les mœurs, coutumes, lois privées auxquelles ils sont attachés. L'administration royale aborde, tente, n'insiste pas. Ailleurs, comme en Roussillon, les populations vont d'elles-mêmes au-devant des désirs du centre. Alors on stimule autant que l'on peut ce penchant. #
Je me rappelais, en lisant ces pages lumineuses, que des provinces plus anciennement réunies ont bien subi l'épreuve du même rayonnement attractif. Le Soleil fixe au milieu des planètes, disait l'astronomie du temps ! Est-ce autrement que les beaux hôtels d'Aix-en-Provence furent construits au goût versaillais ? Les harmonies logiques de l'esprit français y rencontrèrent cet esprit latin qu'elles ne possédaient qu'à demi. On peut se demander ce qu'eût inspiré au grand roi une renaissance provençale comme celle dont Mistral fut le conducteur. D'abord, de l'humeur à coup sûr ! Puis, devant l'énergie d'un tel mouvement, de la curiosité. Devant sa beauté bienfaisante, de la sympathie. Et, d'un regard plus appuyé, peut-être aussi qu'en présence de toutes les vertus morales, domestiques, sociales et politiques dont un livre comme Mireille 4 était nourri et gonflé, le roi eût écouté, compris, exaucé le vœu qu'éleva Lamartine et qui ne fut écouté ni de Napoléon III, ni des républicains successeurs : sa royale souplesse l'eût induit à faire la grande édition populaire du Poème, à la distribuer par tout le royaume, ce qui lui eût été royalement rendu au centuple, nul grand poète n'ayant jamais été en reste sur un véritable bienfait ! #
Laissons ce rêve extrême et, si l'on veut, paradoxal. Il sert à concevoir un Louis XIV aussi différent que possible de certains théorèmes vivants que dévidèrent, d'après Rousseau, des hommes comme Robespierre ou Napoléon. Si forte que fût leur nature, elle était l'esclave d'un dogme. Ici, tout exprime une libre adaptation personnelle à des objets bien aperçus. #
Science alors ? — Pas tout à fait, répond le roi : #
Il ne faut pas vous imaginer, mon fils, que les affaires d'État soient comme quelques endroits obscurs et épineux des sciences qui vous auront peut-être fatigué, où l'esprit tâche à s'élever avec effort au-dessus de sa portée, le plus souvent pour ne rien faire, et dont l'inutilité, du moins apparente, nous rebute autant que la difficulté. La fonction des rois consiste à laisser agir le bon sens qui agit toujours naturellement et sans peine. Ce qui nous occupe est quelquefois moins difficile que ce qui nous amuserait seulement. L'utilité suit toujours… #
L'utilité pour elle-même ? L'utilité pour la gloire. Cela permet d'exclure tout stoïcisme. Ce grand homme ne se fût point arrêté aux aridités d'un devoir qu'on remplit pour le remplir. Chrétien, il entendait que ses mérites fussent récompensés dans l'autre monde. Roi, son royaume de ce monde devait rendre à la mesure de ses efforts. Son application ardente ne finissait qu'aux points que la faiblesse humaine cernait. #
Ni stoïque, ni ascète, ni disposé aux sacrifices supérieurs d'aucun martyre, c'était un grand vivant. Ses passions le tiraient en tous sens. Il aimait tout, le jeu, l'amour, la danse, la musique, la ville, la campagne, enfin tout, sans parler de la poésie, de l'éloquence et des autres arts comme celui de peindre ou de bâtir. Il en a suivi et subi les penchants. Avec quelle fureur ! Dans quelle frénésie que toute la chronique de la jeune cour manifeste ! Le cortège des femmes ! L'éclosion des chefs-d'œuvre ! La suite fastueuse et la gerbe de feu des plus belles amours ! Certes, la morale, la foi élevèrent, à leur heure, plus d'un barrage. Mais un autre terme régulateur apparaît aussi, moins ferme, plus mouvant et toujours présent : c'est le goût. Sur le plan du plaisir, le goût rend les mêmes services que le jugement à la vie pratique. Il sort des mêmes fonds secrets de la vie personnelle, il trahit l'être et le définit : c'est le frein spontané et irraisonné, l'instinct mystérieux qui protège la nature contre elle-même, permet de mesurer et de distribuer sa grandeur. #
Goût, jugement, organes essentiels de l'homme-roi, nous n'aurons pas l'enfantillage de les appeler infaillibles. On fait toujours des fautes de goût et des fautes de jugement. Le gynécée versaillais eût put connaître plus de réserve, les bâtards auraient pu et dû se passer de légitimation, et l'on aurait pu leur épargner le précaire héritage politique dont le Parlement dut les priver. Telle ou telle grande querelle religieuse eût pu être épargnée à Port-Royal, aux calvinistes, au pape lui-même. Mais tant d'activités successives et simultanées devaient affronter le risque vital. Les erreurs n'éprouvèrent pas une pensée vide, un cœur amorti. #
L'homme-roi n'a cessé de vivre, de marcher, d'entreprendre ; le front haut comme l'âme, il abordait les difficultés réunies de l'Ennemi contemporain et du ténébreux avenir. Jeu terrible, il est matériellement impossible d'y gagner à tout coup ! Mais si l'on convient, une fois pour toutes, que le positif compte seul et que l'on s'y tienne, on est ébloui. Et non pas de l'action, ni de la pensée, ni même de leurs fruits répandus dans toutes ces œuvres de l'homme-roi et projetés fort loin dans le temps, mais de la grandeur immatérielle inhérente à leur style. #
Cela peut se sentir par la simple différence entre la plus sincère emphase jacobine ou napoléonienne et les sept lignes de la fameuse lettre au duc de Savoie : #
Monsieur, puisque la religion, l'honneur, l'alliance et votre propre signature ne sont rien entre nous, j'envoie mon cousin, le duc de Vendôme, à la tête de mes armées, pour vous expliquer mes intentions. Il ne vous donnera que vingt-quatre heures pour vous déterminer. #
Propriété. Justesse. Choix. Cela est beau sans doute. Comme pour tout ce qui s'est fait sous le grand règne plus beau encore est ce dépouillement simple, ce rejet naturel de ce qui ne concourt pas au sublime. #
Un tel style portait tout droit vers les hauteurs. Encore fallait-il le défendre, dans la mesure du possible, contre les puissances d'affaiblissement. #
Et le juge se juxtapose à l'amant quand il parle des erreurs magnifiques de sa jeunesse. Oui, il a eu des favorites. Il s'est efforcé de ne pas manquer de justice envers elles, comme envers qui que ce soit. Son exemple « n'est pas bon à suivre, mais peut servir », En des pages incomparables, le roi dit dans quelle mesure il s'est abandonné, mais aussi surveillé, tenu et gardé. #
Deux précautions ont été toujours pratiquées, et il les maxime : #
La première, que le temps que nous donnons à notre amour ne soit jamais pris au préjudice de nos affaires, parce que notre premier objet doit toujours être la conservation de notre gloire et de notre autorité, lesquelles ne peuvent absolument se maintenir que par un travail assidu, car, quelque transporté que nous puissions être, nous devons, pour le propre intérêt de notre passion, considérer qu'en diminuant de crédit dans le public, nous diminuons aussi d'estime auprès de la personne même pour laquelle nous serions relâchés. #
Voici les Belles intéressées elles-mêmes à l'œuvre du Roi. Leurs couleurs, portées en écharpe, obligent à l'honneur et (plus difficilement) au devoir d'État. #
Ce qui suit est beaucoup plus délicat. Cette psychologie de la femme peut paraître sombre. Mesdames, patientez : #
La seconde considération, qui est la plus délicate et la plus difficile à conserver et à pratiquer, c'est qu'en abandonnant notre cœur, il faut demeurer maître absolu de notre esprit, que la beauté qui fait nos plaisirs n'ait jamais part à nos affaires, et que ce soit deux choses absolument séparées. #
Vous savez ce que je vous ai dit en diverses occasions contre le crédit des favoris, celui d'une maîtresse est bien plus dangereux. #
On attaque le cœur d'un prince comme une place. Le premier soin est de s'emparer de tous les postes par où on y peut approcher. Une femme adroite s'attache d'abord à éloigner tout ce qui n'est pas dans ses intérêts ; elle donne du soupçon des uns et du dégoût des autres, afin qu'elle seule et ses amis soient favorablement écoutés, et si nous ne sommes en garde contre cet usage, il faut, pour la contenter, elle seule, mécontenter tout le reste du monde. #
Dès lors que vous donnez à une femme la liberté de vous parler de choses importantes, il est impossible qu'elle ne vous fasse faillir. #
La tendresse que nous avons pour elles, nous faisant goûter les plus mauvaises raisons, nous fait tomber insensiblement du côté où elles penchent, et la faiblesse qu'elles ont naturellement leur faisant souvent préférer des intérêts de bagatelles aux plus solides considérations, leur fait presque toujours prendre le mauvais parti. #
Elles sont éloquentes dans leurs expressions, pressantes dans leurs prières, opiniâtres dans leurs sentiments, et tout cela n'est souvent fondé que sur une aversion qu'elles auront pour quelqu'un, sur le dessein d'en avancer un autre ou sur une promesse qu'elles auront faite légèrement. #
Le secret ne peut être chez elles dans aucune sécurité, car, si elles manquent de lumière, elles peuvent, par simplicité, découvrir ce qu'il fallait le plus cacher, et si elles ont de l'esprit, elles ne manquent jamais d'intrigues et de liaisons secrètes. #
Elles ont toujours quelques conseils particuliers pour leur élévation ou pour leur conversation, elles ne manquent point d'y étaler tout ce qu'elles savent autant de fois qu'elles en croient tirer quelques raisonnements pour leurs intérêts. #
Donc, même au lit, disons le crûment, s'imposent la réserve, la discrétion, le silence, « chose difficile », dit-il lui-même. Il n'y manque jamais. #
Du temps de Fontanges, de La Vallière, de Montespan, nulle des plus brillantes n'est entrée dans l'État. #
Or, cette précaution n'était pas un système. Elle l'était si peu que le jour où lui fut révélé un esprit féminin sans légèreté, ni faiblesse, libre d'attache particulière, sans autre intérêt que le sien, si ferme enfin qu'il l'appela « votre Solidité », Louis XIV fit de Mme de Maintenon la confidente et la collaboratrice de tout ce qu'il y eut de plus royal dans sa vie. Ce qui n'empêcha ni la tendresse, ni le plaisir, comme en témoigne la douce galanterie de quelques billets que le grand public ne peut lire sans agrément dans l'heureux choix des Lettres de Louis XIV que nous devons à Pierre Gaxotte 5. #
Ainsi, sous le roi perce l'homme. #
Ainsi devant cette révélation du roi humain, ou bien plutôt de l'homme royal, fond, s'efface ou se dilue le mécanique, l'emprunté d'une imagerie hostile et menteuse. La passion de cet homme aura été de tendre et de bander tous ses ressorts pour se soumettre aux plus hautes règles de son État, et réussir à être ce qu'il voulait être : cet arbitre intelligent, consciencieux, paternel, responsable, qui doit se prononcer, tout seul, dans les hautes matières que ni la coutume ni la loi ne règlent jamais. #
C'était une tâche d'artiste, passionné pour son art et se complaisant dans son œuvre. On en trouve le signe à chaque ligne des mémoires qu'il a dictés. Nous nous y sommes référés longuement parce qu'ils y font leur preuve, et sans réplique. On y voit les volontés. les intentions, les scrupules, les règlements de vie d'un homme qui eût pu se moquer de toutes ces choses. Direz-vous que c'était grimace ? Vous sera-t-il suspect d'insincérité ? Retournons-nous. Quittons les écrits, voyons l'œuvre. Ce qu'il a dit ou qu'il a écrit, il l'a fait. #
Nous l'avons vu rejeter la rigueur des plans trop généraux, comme peu pratiques. S'il n'a pas eu de politique de libertés municipales et provinciales, s'il a conservé les États de l'Artois et prorogé ceux de Franche-Conté, c'est en vue d'un même résultat, et il l'a atteint : ses acquisitions ont été moralement conquises et séduites par les avantages que leur offraient les jours de prospérité glorieuse. Les nouvelles provinces lui restent fidèles dans les jours de malheur. #
Donc, il avait bien manœuvré, quelque compliquée qu'eût été la manœuvre conseillée par son jugement. C'est tout le contraire de la méthode des jacobins et de l'Empereur à qui le mythe rhénan et l'appât des Flandres ont imposé pendant vingt-trois ans une guerre malheureuse, sans autre fruit que des ruines pleines de sang. Le grand roi a usé plus d'une fois du privilège de pouvoir s'arrêter, heureux de composer à temps. Il composa pour Philippe V, il consentit que son petit fils ne régnât point à Paris et à Madrid, il lui fit céder l'Italie : le reste fut sauvé. Une juste appréciation des forces en jeu se vérifiait. #
Louis XIV nous tient par là : le succès, et qui dure. C'est ce que nos démocrates ont peine à concevoir parce qu'ils sont de grands innocents. Sans prise sur hier, ils ne pensent pas à demain. La liaison du temps leur échappe, ils n'en voient que les variations incoordonnées. #
L'un d'eux, l'autre jour, se croyait bien malin d'écrire que le « roi-soleil » était bien « éloigné de nos mémoires si l'on se réfère à des fins pratiques », Ce patois voulait dire que trois siècles font trois cents ans, et qu'un homme situé comme Bonaparte à moitié du chemin est naturellement plus près de nos affaires, de nos intérêts et de nos besoins. Le grand Empereur pourrait être encore un peu « actuel ». Non le Grand Roi. Or, c'est tout le contraire. L'Empereur ne nous est présent que par toutes sortes de maux dont nous portons les plaies saignantes ou les cicatrices mal fermées : je ne parle pas seulement de Trafalgar, de Leipzig ou de Waterloo, mais de son principe des nationalités qui a érigé près de nous cette monstrueuse et dévorante Allemagne, mais de sa spécialité de grand militaire qui vicia notre armistice ; notre traité de 1919 est sorti de là. #
Toutes les diminutions qui nous grèvent viennent de l'Empereur, et les accroissements qu'il avait cru nous apporter sont perdus depuis longtemps sans retour. Mais le Roi nous a donné l'Alsace et nous avons l'Alsace ; le Roussillon et nous avons le Roussillon ; les Flandres et nous avons les Flandres ; l'Artois, la Franche-Comté, nous les avons : ces points d'accroissement étaient si bien choisis qu'en peu de temps ils ne firent qu'un avec l'être de la nation. Ces conquêtes étaient durables, ces extensions viables et les directions dans lesquelles sa politique s'était avancée sans aboutir encore étaient aussi les bonnes : le règne bourbonien en Espagne a duré aussi, il s'est étendu à l'Italie, à Naples, à Parme, et il a fallu l'étonnante sottise de nos révolutions et de nos empires pour sacrifier un état de choses dont les débris nous rendaient encore service à Madrid il y a vingt ans !… Si l'auteur du testament de Sainte-Hélène se montre absolument ignorant du mal certain que sa dogmatique nous destinait, on peut lire en revanche dans le testament de Louis XIV des recommandations à son arrière-petit-fils qui sont ainsi conçues : #
Que le sang et l'amitié vous unissent toujours avec le roi d'Espagne, sans qu'aucune raison d'intérêt ou de politique mal entendue vous en sépare jamais ; c'est là le seul moyen de conserver la paix et la balance de l'Europe. #
C'est, définie par avance, la politique de salut public. Tout ce qui nous manque. Tout ce qu'il nous faudrait. Tout ce qui donne au souvenir royal la force du regret, du désir et de l'espérance. Le moindre regard sur notre situation, avec les retours comparatifs qu'elle entraîne, tend à nous rapprocher politiquement de l'esprit et du cœur du grand roi. #
Cela est subjectif ? Peut-être. Et voici qui peut le paraître aussi : la langue que nous parlons, quand nous ne parlons pas trop mal, est celle des poètes et des écrivains du règne. Nous ne pouvons nous détacher des modes d'expression, de sentiment, de jugement qui sont propres à Racine et à La Fontaine. Par une rencontre plus singulière encore, les termes de sa langue politique n'ont pas bougé. Patrie, État, Empire conservent l'acception courante que leur donnait Bossuet dans son discours de réception à l'Académie française. Cependant, de profondes révolutions se sont accomplies ; la vie sociale, la vie civile se sont transformées, la vie de famille elle-même a subi de profondes altérations, le paysan, l'artisan, l'ouvrier, le bourgeois, l'homme de loi, croient avoir de la peine à se reconnaître dans leurs aînés d'il y a trois cents ans. Eh bien ? malgré cette coupure, les colonnes du vocabulaire civil n'ont pas bougé. Dans sa lettre au maréchal de Villars après Denain, le roi dit : « La nation, la valeur de la nations… » Le plus contesté des termes en cours est gravé où il le faut, de la pointe de diamant qui servit de plume à Louis. #
Nous rêvons ? — Non, nous ne rêvons pas. On se tromperait gravement en consentant à l'injustice et à l'ignorance, un rabais quelconque sur cette gloire. Il n'y a point de rêve à prendre conscience de l'identité profonde de la nomenclature des idées politiques françaises aujourd'hui, et en 1670 ou 1680. Il n'y a point de rêve, il y a calcul légitime et calcul exact dans notre aspiration à une politique Louis quatorzienne et Louis bourbonienne, devant la crise de notre temps, car les alarmes d'aujourd'hui ressemblent à celles d'hier, elles sont sur la Méditerranée et le Rhin. #
Mais, si l'on veut sentir, voir et palper quelque chose qui ne puisse être comparé en rien à un rêve, et qui atteste pourtant quels soucis d'avenir et de notre avenir inquiétaient encore la vieille tête de Louis mourant, il faut retourner à son Testament, ce Testament que des Robins cassèrent, que des Grimauds ridiculisèrent, sur lequel on ne veut plus retenir que l'infâme barbouillage d'un Saint-Simon, il faut lire en ce testament une page émouvante qui tient aujourd'hui debout comme son grand objet. #
Entre les différents établissements que nous avons faits dans le cours de notre règne, il n'y en a point qui soit plus utile à l'État que celui de l'Hôtel royal des Invalides. Il est bien juste que les soldats, qui, par les blessures qu'ils auront reçues à la guerre ou par leur long service et leur âge, sont hors d'état de travailler et gagner leur vie, aient une subsistance assurée pour le reste de leurs jours. Plusieurs officiers qui sont dénués des biens de la fortune y trouvent aussi une retraite honorable. Toutes sortes de motifs doivent engager le dauphin et tous les rois nos successeurs à soutenir cet établissement, et lui accorder une protection particulière ; nous les y exhortons autant qu'il est en notre pouvoir. #
Pouvoir qui n'a pas été éteint par la mort. #
Les Invalides ont duré. #
La fondation que nous avons faite d'une maison à Saint-Cyr pour l'éducation de deux cent cinquante demoiselles donnera perpétuellement, à l'avenir aux rois, nos successeurs, un moyen de faire des grâces à plusieurs familles de la noblesse du royaume qui, se trouvant chargées d'enfants, avec peu de bien, auraient le regret de ne pouvoir pas fournir à la dépense nécessaire pour leur donner une éducation convenable à leur naissance. Nous voulons que si de notre vivant, les cinquante mille livres de revenu en fonds de terre que nous avons données pour la fondation ne sont pas entièrement remplies, il soit fait des acquisitions, le plus promptement qu'il se pourra après notre décès, pour fournir à ce qui s'en manquera et que les autres sommes que nous avons assignées à cette maison sur nos domaines et recettes générales, tant pour augmentation de fondation que pour doter les demoiselles qui sortent à l'âge de vingt ans, soient régulièrement payées ; en sorte qu'en nul cas, ni sous quelque prétexte que ce soient, notre fondation ne puisse être diminuée et qu'il ne soit donné aucune atteinte à l'union qui a été faite de la mense 5 abbatiale de l'abbaye de Saint-Denis. #
Saint-Cyr s'est transformé, mais la maison d'éducation pour filles d'officiers, a duré et s'est même étendue et accrue ; ce nom de Saint-Denis ne permet pas de l'oublier. #
Mais, les deux établissements que le roi léguait ainsi à toute sa descendance se fussent-ils évanouis avec lui, Versailles même, son incomparable Versailles se fût-il abîmé dans quelque vil remous de nos sottes révolutions, il nous faudrait encore admirer, honorer dans ce coin de la pensée testamentaire de l'homme-roi, la manifeste, l'éclatante et la radieuse obsession des temps qu'il ne devait point voir, des sujets qu'il ne devait point avoir et des victimes de malheurs qu'il voulait prévoir et tenait encore à pourvoir et à soulager. #
On l'a cru et dit égoïste. Un tel suprême usage des prévoyances et des largesses de la Puissance nous montre l'altruisme même. Goethe l'a dit : c'est la fonction générique de l'homme-roi. #
Charles Maurras
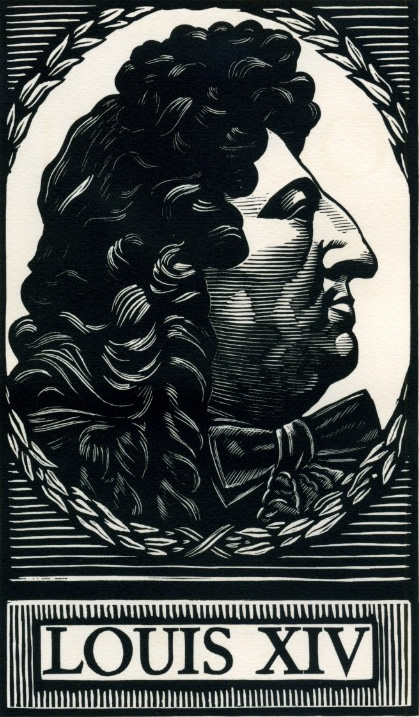
République utopique du Télémaque de Fénelon. (Comme celle-ci les notes suivantes sont des notes des éditeurs.) [Retour]
Louis Bertrand, 1866-1941, professeur de lettres, écrivain, élu à l'Académie française en 1925. [Retour]
Marie de Roux, 1878-1943, avocat, historien et journaliste. Il était l'avocat et l'un des collaborateurs réguliers de l'Action française. [Retour]
L'ouvrage de Frédéric Mistral, 1859. [Retour]
Pierre Gaxotte, 1895-1982, historien et journaliste, il dirigea Candide avant guerre et collabora à l'Action française. [Retour]
Terme désignant un revenu ecclésiastique. [Retour]