- I •
- II •
- III •
- IV •
- IV •
- Notes des Serviteurs •
- Évangile et démocratie
Les chefs combattent pour la victoire ; les soldats pour les chefs.
TACITE 1.
C'est de manquer d'énergie et de ne savoir où s'intéresser que souffre le jeune homme moderne.
Maurice BARRÈS 2
À MON CHER MAÎTRE ANATOLE FRANCE.

I
1. Criton descendait chez les morts. Il souriait de la lamentation des pleureuses que les brises attiques lui portaient par lambeaux : « Hélas ! pauvre Criton ! Tu perds ta femme, tes enfants ! Tu perds la douce Athènes. Tes centaines d'esclaves ne te serviront plus de rien. Qui aura soin de toi ? » Devenu une ombre subtile, il souriait de ces propos et s'enfuyait légèrement ; car n'est-il pas vrai que le sage emporte avec soi tout son bien ? #
2. Plus pâle que la Lune, Mercure se levait sur les collines empyrées. Son vol guidait vers l'occident une foule d'ombres en larmes. En vain secouait-il les boutons laiteux du moly 3 qui dissout les enchantements ; toutes les âmes étaient pleines du sortilège de la vie. De quelque planète sauvage qu'on les eût délivrées, le regret les chargeait et les retardait. Mais un vent de curiosité secondait les pas de Criton. Il aurait égalé le fils de Jupiter si sa sandale, tout à coup, ne se fût détachée. Elle roula dans un fossé, sur le bord du chemin céleste. Il fallut que Criton courût en boitant la quérir et s'agenouillât dans la cendre 4 pour rétablir les bandelettes autour de la cheville. Cela le mit en grand retard. Et, comme il se hâtait, Mercure lui montra quelles taches de boue pendaient à son manteau. Il dut les secouer lui-même et ses pas furent moins légers. #
3. Il songeait, en effet, qu'un enfant acheté à Thèbes l'accompagnait naguère, ayant soin des étoffes, des courroies, des sandales ; ce gracieux serviteur était à présent mort pour lui. Cette idée l'attrista ; ce qui le fit sourire de nouveau : #
« Les vivants m'appellent un mort. Ainsi sont-ils morts à mes yeux. » #
Cette méditation lui apparut riche de sens. Il désira la commenter sur ses tablettes. #
« Ça, dit-il, qu'on recueille les phrases que je dicterai. » #
4. Mais Criton éclata de rire. Parmi les ombres taciturnes, il avait parlé seul comme on fait dans les rêveries. Il s'était vu en ce moment environné des secrétaires qui excellaient à conserver les finesses de sa pensée. L'un, natif de Sicile, distinguait les rêves du maître aux replis de son front. L'autre ramenait sur sa langue les mots ailés et délicats, s'ils venaient à la fuir. Privé de ces auxiliaires, l'Athénien gémit. #
« Par Diane ! il serait sage d'immoler aux mânes du maître ses esclaves les plus utiles. Quelle disgrâce insupportable de descendre seul aux enfers ! » #
5. Mercure se tournant : #
« Mâne, dit-il, ne te plains point. Tu fus d'un siècle fortuné. Mais, si le grammairien t'instruisit des lettres 5, lis les promesses que contiennent les tables du Destin… #
Les murailles du monde venaient d'être franchies. Sur leur façade flamboyante le doigt de Mercure montrait des lettres sacrées. Rien ne se fait dans l'univers qui n'y soit figuré d'avance. Criton lut en courant : #
Un christ hébreu viendra au monde, rachètera l'esclave et, déposant le fort du trône, placera les premiers plus bas que les derniers, pour que sa gloire soit chantée dans la vie éternelle. #
6. « Criton » pour les Grecs signifie un esprit juste et un sens droit. C'est pourquoi il fut affligé de cette prédiction. Il entrevit l'âge de fer. Il aperçut des temps où tout homme, maître de soi, réduit à sa seule vertu, glisserait sur la terre seul et muet parmi des ombres. Sa raison indignée l'abandonna quelques instants. Il alla aux imprécations comme un barbare pris de vin. Mais presque aussitôt il rougit de ces mouvements. #
7. « Hélas ! soupira-t-il, cela n'aurait jamais été 6 si j'avais eu auprès de moi mon petit bouffon d'Éthiopie. Par des quolibets et des coups je dispersais sur lui l'impatience de mon humeur. Il dansait et je le battais. Je le blessais parfois. Sa grimace apaisait mes fibres. Ainsi se purgeaient mes passions. Ce bel enfant me rendait digne des mythes de Platon et des poèmes de Ménandre. Hélas ! sans ce ministre de ma tranquillité me voici devenu mon souffre-douleur. Chose horrible à songer ! mes colères me sont fâcheuses. N'ayant que moi autour de moi, je me prodigue des soufflets comme un personnage de comédie… » #
8. On était arrivé à l'onde du Styx. Elle murmurait tristement. Criton jeta les yeux sur cette glace de ténèbres. Il s'y aperçut bien, mais eut peine à se reconnaître. Et quelle Athénienne eût reconnu dans ce reflet le céleste Criton, délice et honneur de la ville ? En peu d'heures l'inquiétude, la fièvre, le souci avaient troublé ses traits ; son teint devenu rouge sombre commençait à être étoilé des pustules légères qui témoignent d'âcres humeurs. Yeux contractés, sourcils crispés, les deux coins de la bouche baissés amèrement, il se trouvait horrible et n'osait plus un mouvement. Mais il se regardait, se lamentant de ne pouvoir être englouti comme Narcisse en ce miroir digne de lui. #
9. Deux fois le vieux Caron lui avait réclamé l'obole. Comme il ne bougeait pas, le nocher lui donna de son aviron dans les reins. Il reçut de nouvelles plaies pour sa noble lenteur à sortir de la barque. #
« Cela est triste, dit Criton, et cela est trop dur ! J'ai perdu ma beauté et la souplesse de mes membres. Il me reste un peu d'élégance : il me faut en souffrir aussi ! » #
Heureusement, il se trouva que Minos avait l'âme bonne. Ce dieu le fit conduire sans retard aux Champs-Élysées. #
II
10. Aussi loin que couraient ses yeux, il vit s'étendre une campagne tapissée des fleurs qu'il aimait. Le jour naissait du sein des brises. Il s'échappait aussi de la cime des plantes. Le visage des bienheureux était pétri d'une lumière et les cercles qu'ils dessinaient sur des collines de gazon avaient des lignes harmonieuses ainsi que d'un beau corps distribué en cent personnes. #
11. Et Criton vit ce qu'il aimait plus que toutes les fleurs ; dans un ciel admirable, que l'éclat du soleil eût souillé comme un noir nuage, les neuf Muses, les trois Charites chantaient aux pieds de Jupiter. Leurs voix, leurs mouvements, répandaient la sérénité. Il suffisait de relever les yeux et le sens jusqu'à elles. Mais Criton était las. Son corps, ses vêtements ne cessaient point de lui peser. #
« J'aurai le temps, dit-il, d'écouter ces belles déesses. Prenons quelque repos. » #
Il souhaita de se baigner. Dans un bouquet de myrtes et de lauriers-roses en fleurs, cinq ou six jeunes fleuves élevaient leurs cornes dorées et leurs couronnes d'épis mûrs. Ils jouaient sur l'onde tremblante, épanouie, qui respirait les puretés originelles. Il se glissa de leur côté et prit soin de se dévêtir. #
12. Mais il avait compté sans les agrafes et les nœuds qui abondaient par sa tunique et tout son vêtement. Ayant rompu plus d'une étoffe précieuse, il se découragea. Il se coucha sous un peuplier où voltigeaient des flammes pures, musicales comme le vent. Cette harmonie le balançait. Une demi-félicité lui vint. Mais, en songeant qu'il était seul, il se retenait de la prendre ; il n'osait y ouvrir son cœur dans la crainte de le blesser, car il n'avait personne en qui se pût répandre l'excès de son plaisir. Il s'assoupit ainsi. Des années infinies ne le tirèrent point du rêve agité et des siècles coururent tandis que l'asphodèle lui tissait des colliers et des bracelets. Sa chevelure s'impliquait de lierre et de volubilis. #
13. Une voix l'éveilla : « Ô Criton, mon seigneur ! » #
Avant qu'il se fût retourné, le bon Androclès paraissait, menant une troupe joyeuse. Androclès aux palais d'Athènes régissait les biens de Criton. Étant le meilleur des esclaves, il commandait aux autres. Ceux-ci venaient de le rejoindre comme leur chère destinée. #
Tous riaient et pleuraient. Tous chantaient, agitaient les bras et s'étreignaient les uns les autres. #
« Amis, le maître est retrouvé. » #
14. Vers les étangs, les fleuves et les mers qui brillaient aux bouts de la prairie divine, partaient des messagers pour ramener les serviteurs qui erraient en cherchant les traces 7 du seigneur enfui. Et tous accouraient hors d'haleine. La beauté des ombres heureuses avait failli laisser leurs fronts, tant leur erreur infructueuse les avait affligés. Criton reconnut un berger corinthien qu'il avait mis en croix contre la justice. #
« Tu ne m'en veux pas ? » lui dit-il. Mais l'esclave fondit en larmes : #
« Seigneur, il te fallait que je souffrisse jusqu'à la mort. Et je ne m'y refusai point. Bien ou mal, je m'en acquittai. Mais toi, pourquoi nous laissais-tu ? Ma douleur commença quand je ne sus que faire ni de qui prendre les souhaits. » #
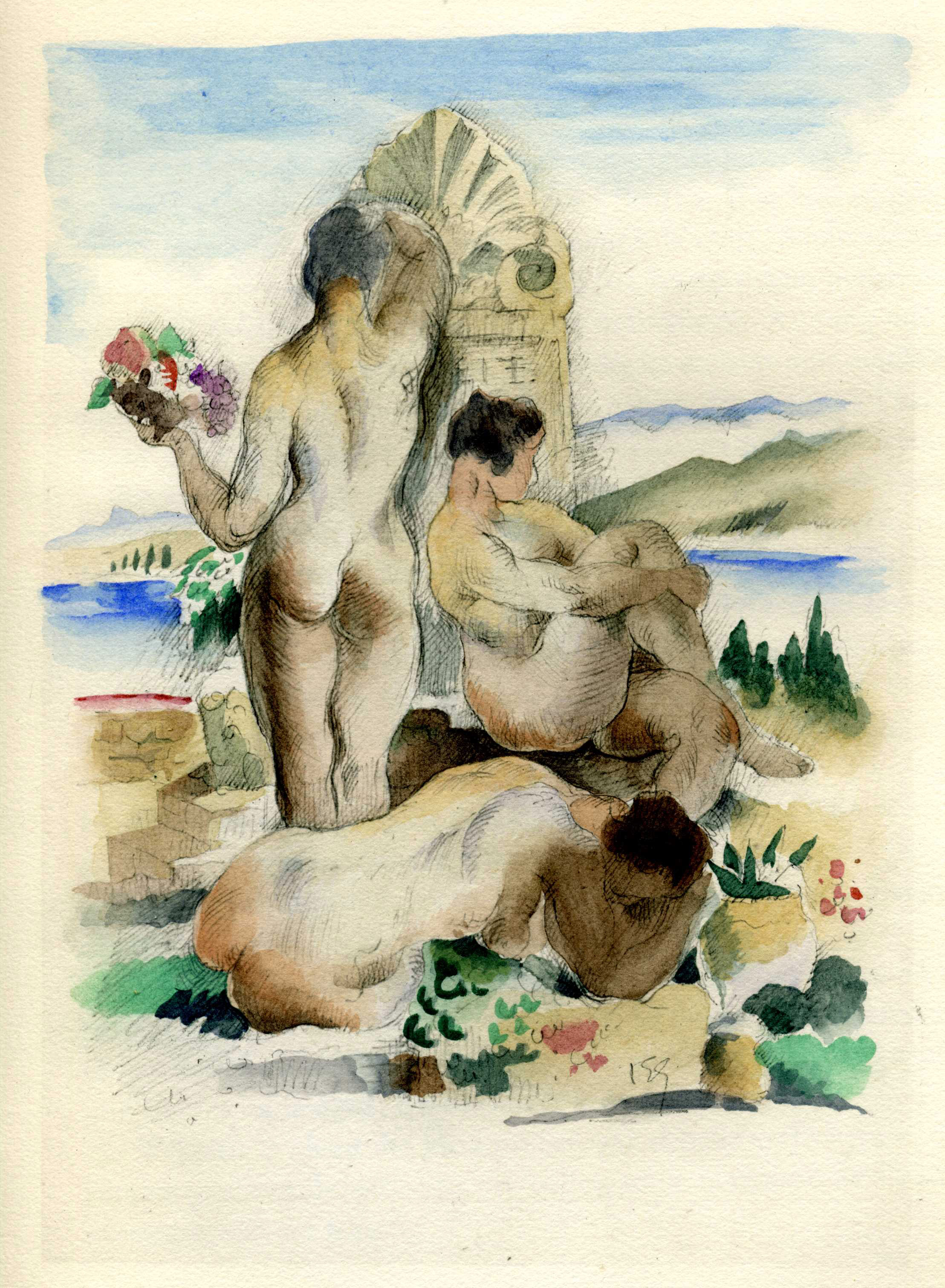
15. Tous disaient des choses semblables ou leur visage l'exprimait. Peu à peu, la satisfaction rappelait sur leurs joues les beautés anciennes. Criton se fit délier des chaînes 8 fleuries. Il se leva et, gravissant un mamelon, s'assit commodément à la cime. Androclès se tint près de lui avec les secrétaires. Plus bas, les musiciens munis de sistres, de théorbes, de lyres et d'autres instruments. Au rang inférieur, pareils au fondement d'une pyramide, les esclaves sans nombre qui ont soin des jardins, des vivres, des habits. Sans nuire à l'harmonie qui s'établissait de la sorte, ces derniers serviteurs montaient et descendaient selon leurs divers ministères. Ils apportaient l'eau d'émeraude, la transmettaient, lavaient les membres du seigneur, où des éponges odorantes étaient ensuite promenées, offraient sur des plateaux les fruits d'Hespérie, les coupes d'huile vierge et les carafes de nectar. Sous des chapelets de violettes, les danseurs ondulaient, les bouffons tendaient leur échine, et Criton, du bout de l'orteil, daignait y imprimer des gourmades distraites ; une pleine félicité les couronnait alors. De tant de serviteurs, il n'en était pas un qui n'eût les yeux fixés sur la prunelle de Criton. Mais le front de Criton était dressé en ce moment dans le voisinage des astres et son regard plongeait où la vue des esclaves ne pouvait pénétrer, vers la couronne des étoiles, des belles muses et des dieux. #
16. « Selon les rangs, les conditions, les dignités dont tu nous pares, Criton, nous regardons vers toi et, se formant à ton modèle en qui le ciel est réfléchi, chacun de nous atteint le genre de beauté que Jupiter lui désigna, ô demi-dieu, près de la tienne. » #
Tel était le chant des musiques et, par sa belle architecture, du rythme gracieux des attitudes mutuelles, toute la maison de Criton accompagnait ces voix. #
III
17. La présence du maître fit même qu'Androclès discourut avec l'abondance d'un sage. #
« Plus d'une fois, seigneur, il nous vint pendant notre vie des désirs d'affranchissement. Insensés, qui croyions que la liberté tient 9 à l'absence du maître ! Ta douce autorité nous apparaissait un fardeau. Cependant tu nous employais, toi, l'aimé des muses ; tu le daignais ! Tu guidais nos pensées suivant les formes de la tienne par où le monde s'épurait. Si nous vivions à ton profit, tu te vouais toi-même aux grands dieux qui portent des voiles. Nos pieds, nos mains et nos épaules te servaient d'escabeaux ; mais quand les célestes faveurs descendaient t'inonder, une rosée mystérieuse imbibait notre front et tous s'enivraient de ta joie. #
18. « Hélas! toi disparu, ces fontaines se desséchèrent. Nous ne connûmes plus de religion ni d'art. Car lequel d'entre nous eût touché sans mourir ces divinités fortes, éternelles et belles qui sont maîtresses d'harmonie et principes de vie ? Nous sentîmes que notre cœur tombait à notre charge. Sur la rive du Styx, Caron me frappa durement ; car tu n'étais point là pour me faire comprendre qu'il était temps de m'embarquer. Devant Minos, plusieurs s'accusèrent l'un l'autre pour se défendre : “ Allez ! dit le juge des Mânes, ayant servi Criton, vous échapperez au Cocyte. Mais cessez de vous prodiguer un aussi triste déshonneur. ” Ainsi, Criton, tu nous sauvas ; ainsi, sans toi, nous fussions 10 tous couverts de ridicule et remplis de méchanceté. #
19. « Et, Criton, nous souffrîmes tant que les Champs-Élysées ne nous surent point consoler. Nous mourions d'ennui, ô Criton ! Nos doigts, tu le vois, sont habiles à cent travaux singuliers. Hélas ! auquel nous appliquer ? tu nous manquais pour nous le dire. Nous chantions à notre âme : Petite âme, que nous veux-tu ?… L'éclat des cieux qui te nourrissent l'accablait et l'éblouissait. Elle se mirait en souci à la berge de fleuves. Et son ombre s'y allongeait, exténuée, pâle, légère. Suivant d'innombrables désirs, elle se dissipait par flocons dans les airs. Nous nous dissipions avec elle. Quelquefois, nous nous poursuivions, mais c'était bien en vain ; chacun errait de son côté, se dissolvait soi-même. Tous les efforts pour nous refaire ouvraient des blessures nouvelles dans notre cœur qui s'épandait et s'effaçait, à l'image des nues et des brouillards évanescents qui s'élèvent de notre terre. #
20. — Mais, demanda Criton, que ne remettiez-vous un sceptre aux mains du plus habile ? #
— Criton, nous l'essayâmes, il faut en convenir. Ils m'acclamèrent comme chef, afin de se trouver heureux. N'étais-je point, au ciel d'Athènes, le plus favorisé de toi ? Je ne sais plus si je parvins à leur bégayer un souhait ; je sais qu'ils se gardèrent bien de l'exécuter. Comment l'auraient-ils pu ? Va, les âmes des hommes n'ont pas été tirées de la même origine. Les filles de l'argile ne s'élèveront point au rang de celles que les dieux ont conçues dans les lits de pourpre. #
21. « Mais, ô cher maître, le visage de la fortune sourit dans ta venue. Dis, ne nous quitte plus. Car nous avons besoin d'un père, d'une mère et d'un fidèle ami. Tout de toi nous sera léger, les injures, les coups. Car cela fait partie de notre condition, et les pires maux appliqués aux places convenables deviennent les présents du ciel. Il n'est point de bonheur pareil à celui de remplir le message que Jupiter inscrivit, en lettres divines, sur les épaules de chacun. » #
22. Criton avec moins de paroles raconta ses malheurs. Son visage brillait d'un enchantement délicieux. Il baisa Androclès qui transmit la caresse aux deux esclaves les plus proches. Ceux-ci la rendirent à d'autres. Elle passa de rang en rang. Et Criton se complut à regarder sur le versant de la prairie heureuse, tressé à l'infini, son doux baiser multiplié. #
IV
23. Ces transports n'avaient point cessé que Criton vit venir à lui un jeune homme d'une beauté resplendissante. Une coupe de lys était ouverte dans sa main. #
« Vous me connaissez bien, dit-il ; je suis Mercure. Voici la coupe du Léthé. Âmes choisies, nulle de vous ne nourrirait-elle en secret le vœu de revoir la patrie ? Je vois bien que vous vous donnez au rire élyséen. Pourtant, réfléchissez si vous n'avez aucun regret. Je puis vous rendre votre terre, la vie d'autrefois, le soleil. » #
24. À ce discours du Psychagogue 11, les serviteurs buvaient avec plus d'espérance le feu des regards de Criton ; car ils ne savaient que répondre. Et Criton s'enflammait d'une beauté supérieure ; car il se souvenait des douces murailles d'Athènes. Il baissa les paupières pour ne point s'enivrer d'espérances déraisonnables. Puis, il les releva vers le groupe des belles Muses qui, là-haut, poursuivaient le cantique du monde, à la table incorruptible de Jupiter : #
« Hélas ! dit-il, les fleurs d'Attique ont une odeur impérissable… Pourtant, Mercure, réponds-moi : notre ville d'Athènes est-elle encore la plus belle qui blanchisse la mer Égée ? Quels sont les orateurs pour se lever dans l'Assemblée ? Quels sont les sages ? Le théâtre offre-t-il des poètes égaux à nos anciens ? S'il en est autrement, dis-le sans prendre de détour, car je ne voudrais pas revivre à la légère. #
25. — Criton, tu parles sagement. Apprends qu'Athènes existe encore. Elle fleurit ; c'est un lumineux champ de ruines. #
— Quoi ! Mercure, elle, ruinée ? #
— Elle est dévastée sans retour. » L'Athénien devint pâle. Mais il reprit : #
« Cela n'est rien, Hermès. Je la saurai bien rebâtir. #
— Sache aussi qu'un monarque de sang barbare y tient sa cour ; elle est peu policée. #
— Thrace ou Scythe, il sera chassé par delà le blanc Tanaïs ! #
26. — Mais, Criton, n'y recherche plus le chœur de tes poètes. Ils sont bien morts. Leurs chants ne sont plus entendus que par des hommes disgracieux qui s'estiment habiles parce qu'ils portent sur les yeux des cercles de cristal. Veux-tu revenir à Athènes ? Les Béotiens y font leur camp. Depuis longtemps, Pallas émigra de notre cité… » #
Criton avait mûri un plan pour replonger le peuple des Barbares au fond des forêts d'Hercynie : #
« Oui, sans doute. Mercure, il faut que je revive. La ville infortunée a besoin de ses citoyens. Et ceux-ci feront comme moi. » #
Il montrait les esclaves. Quelques-uns étendaient la main vers le lys où brillait le Léthé coloré de miel. Criton les arrêta : #
27. « Pardonne-moi, doux Psychagogue, d'oser solliciter une parole de plus. En descendant vers l'onde noire, il y a de longs siècles, c'est toi qui me fis déchiffrer des inscriptions funestes. Ce christ hébreu dont elles parlent est-il venu ? #
— Il est venu, Criton. #
— A-t-il chassé les forts du trône, ainsi qu'il se le promettait ? #
— Il l'a fait, dit Mercure. » #
Mais les échos élyséens répétèrent en gémissant : #
« Il l'a fait ! Il l'a fait ! #
— Il amis les premiers au-dessous des derniers ? Il a rendu Cléon l'égal du fils de Sophronisque 12 ? #
— Mon Criton, ces rêveries s'accomplissent. #
— Et cela réussit ? #
— Tout arrive, Criton. » #
28. Le sage Criton soupira. Il comprenait peu que l'absurde eût ainsi triomphé. #
« Hélas ! Mercure, reprit-il, je sais aussi que les esclaves, au nom du même Christ 13, doivent un jour être affranchis. Est-il temps de s'y opposer ? #
— Voilà près de trois cent soixante-treize olympiades 14 que l'Hébreu criait sur sa croix : cela est consommé. Oui, depuis ce moment, les esclaves ont reçu le gouvernement de leur âme. Ils ne sentent plus d'autres jougs que ceux de vivre et de mourir. Ils disposent de tout leur cœur. La servitude est abolie, chères ombres ! #
Tous les serviteurs aussitôt accoururent en frémissant : « Ô Hermès 15, où nous conduis-tu ? » #
Mercure crut bien répondre : #
« À la liberté, mes amis. » #
29. Mais le vieil Androclès se prosterna devant Criton dont il embrassa les genoux 16. #
« Cher maître, garde-toi de commencer notre infortune. Songe aux malheurs que nous souffrîmes avant que d'être ici rejoints ! #
« On souffre sur la terre comme nous souffrions loin de toi. Je distingue assez bien comment, sans précepte, sans chef, les anciens esclaves s'y doivent consumer d'un ennui sans merci. Il leur faudrait quelqu'un à servir et à saluer. Ils ont des conquérants, de temps à autre, qui les broient ; pour l'ordinaire, de faux maîtres au cœur pétri comme le leur. Et ces oppressions ne leur profitent guère, car jamais ils ne les acceptent. Jamais ils n'obéissent, sinon contre leur vœu. #
« Même, il leur pèse de durer en leurs propres résolutions ; car ils redoutent d'être esclaves et c'est l'être, en quelque façon, que d'obéir à soi, d'exécuter d'anciens projets, d'être fidèle à de vieux rêves. Ils se sont affranchis jusque de la constance, et l'univers entier les subjugue chaque matin. #
30. « Cet état, que nous connaissons, ne permet rien qui soit durable. Parle, toi, Trismégiste 17, qui sais exactement les événements des trois mondes, étant grand voyageur. N'est-il pas vrai que désormais toute œuvre est vide et vaine ? Aucun peuple nouveau a-t-il réussi seulement un édifice comme le Parthénon ? une Aphrodite cnidienne ? un autre Œdipe-roi ? un corps de lois qui se compare à celui de Solon ? #
— Je ne le vois pas, dit Mercure. #
— Hé ! lequel d'entre eux l'aurait pu ? Là-haut, les anciens maîtres mènent une vie d'infortune. Tu leur étais pareil, Criton, quand tu errais au bord du Styx, songeant aux musiques du ciel et obligé de renouer toi-même tes chaussures. Ils s'enveloppent de pensées et quelque matelot les bat en leur réclamant une obole. Mercure, suis-je dans l'erreur ? #
— Tu dis merveilleusement vrai, Androclès, répondit le dieu 18. #
— Mais ces peines d'aristocrates sont près d'être lavées de la face du monde. Les feux sacrés s'éteignent et l'art inutile se meurt. À la vérité, la nature agonise elle aussi. Oh ! cela n'est point de vieillesse. Mais son beau sein est encombré. Jadis, Criton, nos mariages étaient réglés par tes souhaits qui dessinaient un monde élégant comme ton esprit. Jamais les serviteurs ne poussaient la fécondité au delà des vœux de l'État. Chaque pays portait le nombre d'habitants qu'il pouvait nourrir, vêtir et honorer. Cette modération a bien cessé d'être en usage ! #
31. « Car, devenues maîtresses d'elles, les femmes ont souri à tous, ouvert à tous l'urne féconde que tu réservais aux meilleurs. Encore si le désir eût seul régné sur leurs caprices ! Le Désir les eût faites assurément plus difficiles ; car un éphèbe désirable étonne Jupiter. Mais ceux qui délivraient les âmes les compliquaient aussi. Ils déchaînaient dans l'univers un second désir tout contraire, qui, au lieu d'exalter vers les types de la Beauté, incline aux choses laides, mutilées et humiliées. Cette pitié dénaturée a dégradé l'Amour. Il s'est nommé la Charité ; chacun s'est cru digne de lui. Les sots, les faibles, les infirmes ont reçu sa rosée. De nuit en nuit, s'est étendue la semence de ce fléau. Elle conquiert la terre. Elle remplit les solitudes. En quelque contrée que ce soit, on ne peut marcher un seul jour sans rencontrer cet être au visage flétri, au geste médiocre, mû du simple désir de prolonger sa vie honteuse ; il parle, ô Criton. C'est un homme. Mais voudrais-tu lui ressembler ? #
— Il faut avouer, dit Mercure, que la peinture est vraie. Et les choses sont bien comme l'esclave les devine. #
— Je ne devine point. Mercure, mais je raisonne. Mais, toi, Criton, je te supplie. Dis, ne remontons point vers les déclassés faméliques. Ne nous noyons pas dans la foule. Ici, nous adhérons à toi comme les vallons aux montagnes. Le plus humble de nous n'est point étranger à l'éclat de ta chevelure dorée, de ta taille divine ; il soutient l'une et tresse l'autre. Nous sommes membres d'un beau corps que tu excelles à conduire, étant sa tête et sa pensée. Il nous semble, à certaines heures, qu'un dieu nous exhale de toi. #
32. Tous les serviteurs applaudirent. Criton, indécis, soupirait. #
« Androclès a raison », dit Mercure. Et, tranchant le débat, il prit son vol avec la coupe où personne n'avait touché. #
Notes des Serviteurs
Note de l'édition de 1895, reprise dans l'édition de 1921 sous la lettre A :
Je croyais l'idée de ce mythe si purement conforme aux sentiments « socialistes » et « archistes » de notre race qu'on ne la pût nourrir ailleurs. Mais voici, me dit-on, qu'elle est professée en Allemagne par un étrange écrivain de race slave 19 appelé Nietzsche. C'est à peine si j'ai feuilleté ce qu'on nous a donné de Nietzsche. Il me souvient cependant d'avoir noté dans son Cas Wagner, publié en 1888, mais traduit chez nous seulement en 1893, de curieuses rencontres sur la philosophie de l'art avec les thèses esthétiques qu'il m'est arrivé à moi-même de soutenir en 1891 au moment de la fondation de l’École romane, d'accord avec mes amis MM. Jean Moréas, Raymond de la Tailhède, Ernest Raynaud et Maurice du Plessys. #
J'avais écrit Les Serviteurs à l'automne de 1891 ; et ils parurent dans la Revue bleue du 30 avril suivant. — Est-il possible, me dit-on, que vous ne connaissiez pas Nietzsche ! — Mais c'était la première fois que j'entendais ce nom. Ce Nietzsche est un Sarmate ingénieux, éloquent et assez subtil. Quoique d'esprit bizarre, il n'a pu lire sans profit notre Platon. Cependant l'effroyable désordre de sa pensée finit par le conduire à un anarchisme orgueilleux. Sa naissance l'y destinait. Fidèle à cette barbarie, il est même devenu fou. J'ai tenté, au contraire, les triomphes de la raison. #
S'il me fallait invoquer ici d'autres modèles que ceux que j'ai reçus de mes maîtres français ou grecs et latins, je me référerais à ces lignes si belles de l'auteur 20 du Colloque entre Monos et Una : « En dépit de la voix haute et salutaire des lois de gradation qui pénètrent si vivement toutes choses sur la terre et dans le ciel, des efforts insensés furent faits pour établir une démocratie universelle… » #
Note de 1921 sous la lettre B :
[Voir la note 18 du présent document.]#
Note de 1921 sous la lettre C :
Le lecteur qui voudra connaître les explications publiées sur ce conte, dont le sens et les intentions avaient été défigurés pour les besoins d'une polémique dirigée contre son auteur, les trouvera aux pages 75 et suivantes 21 de son livre L'Action française et la Religion catholique. #
Évangile et démocratie
Explications 22 sur le conte des Serviteurs, dont le sens et les intentions avaient été défigurés pour les besoins d'une polémique dirigée contre son auteur, publiées en 1913 aux pages 75 et suivantes de son livre L'Action française et la Religion catholique. #
Sous l'influence des idées et des intérêts que je combattais, ma défense de l'Église eut plus tard à s'exalter jusqu'à la passion, mais elle n'avait pas toujours offert ce caractère 23. #
À l'origine, en des temps intellectuellement fort troublés, mais politiquement assez calmes, elle garda l'aspect d'une réserve simple mais formelle, jetée en passant, au milieu des ébats d'une plume profane, comme pour stipuler que l'auteur savait ce qu'il tenait à respecter, ce qu'il était bien résolu à ne profaner en aucun cas. C'est de cette façon que doivent être lus certains écrits de ma jeunesse, tel est l'unique sens équitable à leur supposer. #
Mes diffamateurs disposent et ordonnent cette lecture d'après leur hypothèse d'une épouvantable duplicité. On fera mieux d'essayer la clef que j'en donne et qui pourrait se définir comme un dédoublement de l'imagination historique et religieuse. Je crois devoir appeler ici toute l'attention du lecteur ; dans cette représentation des faits de l'histoire sacrée, il y avait d'une part ce qui appartenait au catholicisme, d'autre part ce qui ne lui appartenait pas. #
Tous les dieux, toutes les croyances, tous les livres sacrés, toutes les annales religieuses de tous les peuples étant livrés en jouet plutôt qu'en pâture au caprice parfois ironique de la pensée, il subsistait pourtant un point sur lequel je prenais garde de faire exception à ces jeux et de déclarer que les mêmes personnages, les mêmes choses, les mêmes noms devenaient intangibles dans la mesure où ils étaient reliés au Catholicisme. À l'époque dont je parle, il y eut, je ne dirai pas pour certaines intelligences, mais pour certaines imaginations, pour la mienne, comme deux Jésus, deux Évangiles, deux Écritures, deux Histoires du Christianisme selon que ces différents termes étaient conçus dans l'Église ou hors de l'Église. 24#
— Mais dira-t-on, lequel des deux était conçu comme vrai et comme réel ? #
— La question se posait à peine pour des esprits sans foi qui ne cherchaient plus du tout dans l'histoire des témoignages, mais de simples images en vue d'illustrer des idées 25. #
Ainsi, d'un côté, se tenait devant mes yeux le Christ de la conception protestante, révolutionnaire et moderne, « le bizarre Jésus romantique et saint-simonien » suggéré par l'interprétation individualiste qui nous environnait alors, et correspondant à la thèse individualiste elle-même. D'un autre côté, et plus près, et paré d'une gloire à laquelle je me montrais profondément sensible, ne voulant « connaître » que lui, le Jésus « de notre tradition catholique », le crucifié couronné du catholicisme de Dante, #
O sommo Giove
Che fosti in terra per noi crucifisso 26… #
Toutes les invectives qu'il m'arrivait d'écrire contre le premier me semblaient lumineusement compensées par l'hommage rendu au bienfait séculaire, à la majesté du second, et nulle pensée d'outrager la réalité religieuse du catholicisme ne pouvait même entrer dans ce courant d'idées, démunies certes de piété, mais toujours assistées d'un sentiment de vénération, qui me faisait mettre le catholicisme à l'écart et à l'abri de tout mouvement agressif. #
J'entends fort bien que toutes ces précautions n'empêchaient pas la confusion de se produire, en fait, entre les deux images évoquées par moi tour à tour. Mais cette confusion, elle se faisait aussi sans moi, et d'un autre côté ! À parler net, le Jésus de la Réforme et de la Révolution semblait alors, dans la pensée de bien des catholiques, gagner, empiéter sur la haute image traditionnelle. C'est contre cette éclipse qu'un instinct de catholique né m'a toujours soulevé avec une colère croissante et d'autant plus vive que, par suite de circonstances personnelles, nées de la direction de mes études et de mes réflexions, je pouvais me flatter de voir avec les yeux du corps ce retour ennemi, mais oblique et furtif, cette morsure doucereuse de la nuit protestante sur la lumière du ciel romain. #
Silencieux et large, comparable à une tentative d'envelopper pour recouvrir, plutôt que pour percer et pour traverser, ce mouvement dont l'anarchie était le cœur mais qui, on l'a vu, élevait sa tête dans les plus hautes régions de l’État, se réclamait en termes exprès du christianisme. Il se disait chrétien, sous une forme ravalée avec Tolstoï, sous l'aspect de l'orgueil et de l'arrogance avec Ibsen, en empruntant mille autres traits, tantôt épais, tantôt subtils du « christianisme intérieur » ou de « la primitive Église », avec Paul Desjardins et le vicomte de Vogué. Il y eut une apologie néo-chrétienne du scientifisme universitaire régnant, il y en eut une autre, non moins néo-chrétienne, de l'ignorance crasse et de la plus abjecte inertie, celle qui suggérait d'abominables contre-sens sur le beati pauperes spiritu, couramment traduits par l'éloge de la sottise. Dans l'ordre des mœurs, il fut aussi professé, sur les mêmes autorités suprêmes, que tout était permis et que l'œuvre n'importait pas, pourvu que le sentiment y fût. #
Nouveautés ? Non pas même pour le siècle, cela est bien connu ! Ceux qui avaient grandi, comme c'était mon cas, au milieu des « classiques » du XIXe siècle, classiques du libéralisme et classiques du romantisme, songeaient avec impatience que la même assimilation du Christ de l’Évangile (ou même du Christ de l’Église) au Christ de l'anarchie anime toute l'œuvre de Victor Hugo après la Révolution de Juillet. Elle agite et affole le second Lamennais, précipite la décadence de Lamartine et rend Michelet furieux. Un Béranger lui-même en est tout pénétré. Mais, vers 1890, par l'apport des doctrines du monde scandinave et anglo-saxon d'Europe ou d'Amérique, tout conflue de ce côté-là ; pendant dix ans entiers la curiosité des auteurs, l'intérêt des lecteurs, même catholiques, se prononce dans le même sens. La faveur a baissé pour toute la décade suivante, elle baisse encore ; le néo-christianisme est rentré dans ses chapelles, situées aux pôles extrêmes du pays politique et moral. Ne supposons pas qu'il soit mort. Il est toujours puissant chez les vrais révolutionnaires. Un fidèle enfant de 89, comme Gustave Hervé, a fait dernièrement une déclaration géminée : 1o de haine au catholicisme ; 2o d'estime et d'amour au christianisme. Mais on en citerait des cas moins excentriques, d'après lesquels ou peut concevoir l'ancienne vigueur de l'épidémie d'il y a vingt ans. En voici un, très frappant, cité par M. l'abbé Descoqs qui fait une analyse pénétrante de toute cette affaire dans le livre qu'il a bien voulu consacrer à mon œuvre 27. #
Page 90, note 1, M. l'abbé Descoqs recueille le commentaire de M. Victor Giraud sur ce propos de Jean Monneron, le héros du célèbre roman de Paul Bourget 28 : #
— J'ai beaucoup lu les Évangiles, et si j'en traduis l'enseignement, je le résumerai par ces trois traits : discipline, hiérarchie, charité. #
M. Giraud répond : #
« Charité, oui, sans doute. Discipline, hiérarchie, est-ce si sûr ? L’Évangile interprété par l'Église, peut-être. Mais l’Évangile tout seul, je doute un peu. » #
Et M. Victor Giraud, alléguant l'autorité d'un « illustre exemple contemporain », qui est celui de Tolstoï, juge que « la pensée individuelle, placée sans intermédiaire en face de l’Évangile tout seul », on peut assez naturellement tirer « l'anarchisme moral ». #
Autre exemple : M. Émile Ollivier, qui garda toute sa vie les manières d'un homme d'ordre et qui s'est dit catholique jusqu'à la fin, a pu écrire dans la préface de son livre L’Église et l’État au concile du Vatican : « Entre la Révolution et l’Église, il y a des passions, des malentendus et pas de dissentiment fondamental. Dans son essence, la Révolution n'est pas satanique, comme l'a affirmé J. de Maistre, elle est la réalisation sociale et politique de l'idée évangélique. 29 » #
Ainsi le fils de Démosthène Ollivier, saluant la refloraison des idées de 48, pensait que ce n'est plus seulement l’Évangile, c'est l’Église elle-même qui apparaît consubstantielle à la Révolution. #
Un autre néo-chrétien, pour qui les choses ont mal tourné, Marc Sangnier, fit un pas de plus en ce sens, et c'est dans Rome même, devant un auditoire de cardinaux et de prélats, qu'il a incorporé à la Révolution les paroles de la Vierge du Magnificat : #
Et vous avez trouvé, Vierge royale, oublieuse des anciens privilèges de votre race, tandis que votre âme émit magnifiée par la vision égalitaire de l'universelle rédemption, ces paroles sublimes qui, à tout jamais, feront tressaillir l'humanité régénérée et dont la hardiesse effraie le réformateur le plus audacieux : Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. #
Ô Vierge forte, Vierge prudente, que d'autres se scandalisent des mots qui sont tombés de vos lèvres inspirées ! Nous, nous les répétons avec amour et nous les redisons aux pauvres ignorants de vos leçons divines qui s'essayent à balbutier devant les foules trompées des phrases mortes qu'ils ont dérobées à l’Évangile de votre Fils, alors qu'ils ont renié sa foi, mauvais bergers, indignes pasteurs de peuples qui veulent que les moissons germent sans les semences, que la démocratie naisse sans le Christ 30. #
Quand l'été dernier, un disciple de Marc Sangnier répondait 31 à des catholiques d'Action française 32 que « ce ne sont pas les abbés démocrates qui ont composé le Magnificat », il oubliait les interprétations subversives que leur propre chef en avait tirées. Mais celui-ci avait commis la faute de ne pas imiter ces abbés démocrates qui avaient prudemment gardé leur glose pour la France. Les docteurs romains qui l'avaient entendu et jugé ne tardèrent pas à rendre l'arrêt, explicite arrêt foudroyant, dans la Lettre pontificale Notre charge apostolique 33 du 25 août 1910, où les sillonistes et autres démocrates chrétiens sont qualifiés en ces termes : #
Pour justifier leurs rêves sociaux, ils en appellent à l’Évangile, interprété à leur manière, et, ce qui est plus grave encore, à un Christ défiguré et diminué. #
Léon XIII, continuait la Lettre, a déjà flétri « une certaine démocratie qui va jusqu'à ce degré de perversité que d'attribuer dans la société la souveraineté au peuple et à poursuivre la suppression et le nivellement des classes. » Ceux qui n'y ont pas pris garde vont donc au rebours de la doctrine catholique, « vers un idéal condamné ». Ils veulent « inféoder la religion à un parti politique ». #
Le souffle de la Révolution a passé par là… Leur idéal étant apparenté à celui de la Révolution, ils ne craignent pas de faire entre l’Évangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires qui n'ont pas l'excuse d'avoir échappé à quelque improvisation tumultueuse. #
L'école de Sangnier n'est qu'un fruit d'arrière-saison. Mais, par son langage, on peut juger de ce qui était dit et écrit dans l'aigre et farouche printemps de la démocratie chrétienne. Franchement, si des catholiques croyants et pratiquants s'égaraient jusque-là, comment la confusion inverse aurait-elle été épargnée à des Français fidèles à l'ordre, mais sans foi religieuse ? #
Quand on souligne ce que j'écrivais de mon coin sur « le venin du Magnificat », on oublie que je remarquais aussitôt que l’Église le chante sur des modes qui ne laissent pas naître la mauvaise pensée, hormis dans les esprits délibérément corrompus dont Marc Sangnier et Émile Ollivier sont les types. J'avais pris garde de noter l'impression physique, sensorielle que m'avait donnée de tout temps le graphique musical de la liturgie. Dans chaque cœur bien fait, à toute tentative d'interprétation révolutionnaire répond suffisamment l'éclat sacré du chant royal. C'est pourquoi la pointe de mon épigramme tournait contre tout autre que l’Église. Au surplus, les lecteurs qui rechercheraient mon sentiment sur la doctrine catholique de l'exaltation des plus humbles savent fort bien où la trouver. Ils prennent la préface du Dilemme de Marc Sangnier (1906), devenue la conclusion de La Politique religieuse (1912) et s'avisent que j'ai écrit : #
« Dieu est tout amour », disait-on. Que serait devenu le monde si, retournant les termes de ce principe, on eût tiré de là que « tout amour est Dieu » ? Bien des âmes que la tendresse de l’Évangile touche, inclinent à la flatteuse erreur de ce panthéisme qui, égalisant tous les actes, confondant tous les êtres, légitime et avilit tout. Si elle eût triomphé, un peu de temps aurait suffi pour détruire l'épargne des plus belles générations de l'humanité. Mais elle a été combattue par l'enseignement et l'éducation que donnait l'Église : — Tout amour n'est pas Dieu, tout amour est « DE DIEU ». Les croyants durent formuler, sous peine de retranchement, cette distinction vénérable, qui sauve encore l'Occident de ceux que Macaulay appelle « barbares d'en bas ». #
Aux plus beaux mouvements de l'âme, l'Église répéta comme un dogme de foi : « Vous n'êtes pas des dieux ». À la plus belle âme elle-même : « Vous n'êtes pas un Dieu non plus ». En rappelant le membre à la notion du corps, la partie à l'idée et à l'observance du tout, les avis de l'Église éloignèrent l'individu de l'autel qu'un fol amour-propre lui proposait tout bas de s'édifier à lui-même ; ils lui représentèrent combien d'êtres et d'hommes, existant près de lui, méritaient d'être considérés avec lui : — N'étant pas seul au monde, tu ne fais pas la loi du monde, ni seulement ta propre loi. #
Ce sage et dur rappel à la vue des choses réelles ne fut tant écouté que parce qu'il venait de l'Église même. La meilleure amie de chaque homme, la bienfaitrice commune du genre humain, sans cesse inclinée sur les âmes pour les cultiver, les polir et les perfectionner, pouvait leur interdire de se choisir pour centre de tout. #
Ainsi elle leur montrait le point dangereux de tous les progrès obtenus ou désirés par elle. L'apothéose de l'individu abstrait se trouvait ainsi réprouvée par l'institution la plus secourable à tout individu vivant. L'individualisme était exclu au nom du plus large amour des personnes, et ceux-là mêmes qu'entre tous les hommes elle appelait, avec une dilection profonde, les humbles, recevaient d'elle un traitement de privilège, à la condition très précise de ne point tirer de leur humilité un orgueil, ni de la sujétion le principe de la révolte. #
Il faut ajouter qu'il ne me souvient pas d'une seule les impertinences relevées aujourd'hui qui n'aient eu pour destinataire nominatif un juif à la Bernard Lazare ou quelque protestant à la Gabriel Monod. #
Je n'avais qu'un désir, c'était d'atteindre l'individualisme. Et, le prenant de front, je voulais tenter de montrer que cette doctrine superficielle, fondée sur une vue incomplète de l'homme, ne manque rien tant que son but, à savoir le bonheur de l'individu. Oui, l'homme est égoïste, âpre, avide, mais, ne cessais-je de me dire, l'homme ne peut pratiquement rien satisfaire de cet égoïsme, qu'il s'agisse de libido sciendi ou de libido sentiendi ou de libido dominandi, sans la vie de société, et comment pourrait-il vivre de cette vie sans y déployer quelques-uns des sentiments de sympathie, d'amitié, de fidélité qui sont en lui, comme leurs contraires ? L'homme prend plaisir à désobéir, à fronder, à se révolter, mais aussi à se lier, à s'attacher et à se donner. L'homme est envieux, mais il est dévoué, il est personnel, mais il est généreux, et le bon ordre social consiste à tirer le meilleur ou le moins mauvais parti possible de tant de contradictions ! Or, de tous les partis concevables, le moins bon, le pire de tous, est celui qui ferait un acte de foi dans la vertu propre à ce Chaos et dans sa bonne orientation spontanée. On le fait quand on suppose que l'homme est bon. On le fait quand on s'abandonne aux doctrines du pur amour. On le fait quand on croit que le but de la vie est de libérer les instincts ou quand en enseigne que, pour être heureux, il suffit de faire disparaître le frein, l'obstacle, la difficulté ou l'autorité, qui sont parfois de grands éléments de bonheur. Décréter l'égalité des bons germes et des mauvais germes, en proclamer le libre essor général, c'est le moyen certain de faire servir le désordre originel à un désordre artificiel pire encore ; cette anarchie faite de main d'homme donne la victoire et l'empire aux éléments mauvais qui peut-être ne l'emportaient tout d'abord qu'assez faiblement sur les bons, étouffés ou sacrifiés. #
De telles réflexions que je roulais sans cesse étaient propres à me montrer ce qu'a méconnu Brunetière : la liaison de l'individualisme et de la démocratie, et, pratiquement, leur identité. Si l'individu n'est pas Dieu, les plus fortes raisons de croire qu'il est Roi s'évanouissent. Mais plus je voyais et mieux je touchais la nature pernicieuse de ces deux idées fausses et vaines, plus il fallait bien m'avouer qu'il importait moins d'en établir l'absurdité que de la rendre sensible. C'est pourquoi j'écrivais des espèces de fables pour donner à mes vérités l'attrait persuasif qui vient du relief et de la couleur d'une vie menteuse ; dans la même pensée, je les salais et les poivrais de tous les paradoxes à froid ou à chaud qui pouvaient me passer dans l'âme. Il s'agissait non de montrer une vérité dans le ciel, mais de secouer le dormeur pour le détacher de la boue. Ce fut la disposition dans laquelle j'écrivis mon conte des Serviteurs, à qui nos ennemis ont fait une gloire posthume. Ce récit de quelques pages est essentiellement une apologie satirique de cette subordination des hommes entre eux que je représentais non comme une peine, mais d'abord comme un besoin, le besoin primordial du grand nombre des âmes incapables de se donner une direction, et ensuite comme leur satisfaction et leur joie, joie expliquée par nos passions élémentaires et justifiée par l'immense réciprocité des services qui soutiennent notre univers. #
Comme il convenait dans une historiette où chaque trait était poussé jusqu'à sa limite logique, je me gardais bien de dire service ni même servitude. Je disais, parbleu, esclavage. Mais quel esclavage ! Un esclavage réciproque, un esclavage dont le lien, vraiment féodal, s'il enchaînait l'esclave au maître, n'enchaînait pas moins le maître à l'esclave. Un esclavage qui les unit l'un l'autre comme les membres au corps, « comme les vallons aux montagnes ». Un esclavage dont j'ai dû aller chercher le commentaire et l'illustration jusque dans cette Histoire d'une servante, de Lamartine, dont un autre que moi pourrait prétendre et soutenir que c'est l'un de nos plus beaux livres chrétiens. #
Que mon allégorie, au surplus, fût païenne, il n'est pas besoin de me le rappeler. Nous nous occupons de savoir si elle était d'un paganisme offensif et belligérant par rapport à l'Église. #
Le maître des esclaves, l'Athénien Criton, descendu aux Enfers, y trouve tout de suite les charges, les ennuis, les périls de la liberté individuelle, du fait de son isolement ; exténué des soins de la vie et de tous les soucis que maudissent les philosophes, il se sent, par là-même, frustré des heureux avantages dont l'environnaient la fortune et la société. Ses esclaves surtout lui font terriblement défaut. Mais lorsque ceux-ci, à leur tour, sont descendus vers l'onde noire, ils souffrent de son absence plus que lui de la leur, si bien que l'affranchissement leur crée aussi des maux insupportables jusqu'au jour où ils le retrouvent enfin. Rompu de tristesse, il s'était endormi sur la pâle prairie. La vraie vie recommence aussitôt qu'il revoit les hommes dont il a la charge et qui s'applaudissent de retrouver son autorité. C'est pourquoi lorsque Hermès leur propose à tous de revivre, les esclaves et leur porte-parole Androclès refusent les premiers de remonter la lumière d'un siècle, où, leur dit-on, est prêché un abominable évangile de liberté et d'égalité. #
— Grand Hermès, où nous conduis-tu ? #
Mercure crut bien de répondre : #
— À la liberté, mes amis ! #
Mais le vieil Androclès se prosterna devant Criton. Il baisa ses genoux : #
— Cher maître, garde-toi de commencer notre infortune. Songe aux malheurs que nous souffrîmes avant que d'être ici rejoints ! #
« On souffre sur la terre comme nous souffrions loin de toi. Je distingue assez bien comment, sans précepte, sans chef, les anciens esclaves s'y doivent consumer d'un ennui sans merci. Il leur faudrait quelqu'un à servir et à saluer. Ils ont des conquérants, de temps à autre, qui les broient ; pour l'ordinaire, de faux maîtres au cœur pétri comme le leur. Et ces oppressions ne leur profitent guère, car jamais ils ne les acceptent… #
On me permettra de faire observer que ces derniers mots montrent suffisamment de quelle servitude intérieure et volontaire je m'étais fait le défenseur. #
Androclès continue : #
Jamais ils n'obéissent, sinon contre leur vœu. Même, il leur pèse de durer en leurs propres résolutions ; car ils redoutent d'être esclaves et c'est l'être, en quelque façon, que d'obéir à soi, d'exécuter d'anciens projets, d'être fidèle à de vieux rêves. Ils se sont affranchis jusque de la constance, et l'univers entier les subjugue chaque matin. #
Cet état, que nous connaissons, ne permet rien qui soit durable. Parle, toi, Trismégiste, qui sais exactement les événements des trois mondes, étant grand voyageur. N'est-il pas vrai que désormais toute œuvre est vide et vaine ? Aucun peuple nouveau a-t-il réussi seulement un édifice comme le Parthénon ? une Aphrodite cnidienne ? un autre Œdipe-roi ? un corps de lois qui se compare à celui de Solon ? #
— Je ne le vois pas, dit Mercure. #
— Hé ! lequel d'entre eux l'aurait pu ? Là-haut, les anciens maîtres mènent une vie d'infortune. Tu leur étais pareil, Criton, quand tu errais au bord du Styx, songeant aux musiques du ciel et obligé de renouer toi-même tes chaussures. Ils s'enveloppent de pensées et quelque matelot les bat en leur réclamant une obole. #
« Mercure, suis-je dans l'erreur ? #
— Tu dis merveilleusement vrai, Androclès, répondit le dieu. #
Les Serviteurs parurent pour la première fois dans la Revue bleue du 30 avril 1892. Au point précis où se terminait la citation que je viens de donner, j'avais placé une note, de crainte que le public, s'égarant sur ma vraie pensée, ne m'attribuât un esprit d'hostilité contre toute la civilisation catholique et l'histoire moderne. Quoique oubliée depuis, cette note subsiste, imprimée page 570 du recueil littéraire précité dans lequel chacun peut la retrouver. Si l'on doutait de ce que j'ai voulu désigner et nettement visé dans ces pages, la pièce que voici serait décisive : #
Ici, le Psychagogue manque de bonne foi et le dieu des voleurs se montre aussi le dieu des sophistes. Mercure aurait dû ajouter (car le bon Androclès n'en pouvait rien prévoir) que la besogne des esclaves fut, durant plus de mille années, accomplie grâce à la servitude volontaire des ordres religieux aidés par la chevalerie, par des confréries d'ouvriers et d'artistes habilement organisées pour la prospérité de tous. L'harmonie de cet univers ne courut vraiment de danger que depuis deux ou trois cents ans. #
Ces « deux ou trois cents ans » comptés ne peuvent désigner que la Réforme ou la Révolution 34. #
La note explicative à laquelle je ne songeais plus a été retrouvée il y a peu de temps, sur l'indication du marquis de Roux, président de la section poitevine d'Action française. Ce document formel apporte une déposition dont je tiens à faire un hommage à tant d'amis catholiques dont la pensée délibérée m'a fait un si noble crédit ! Sans connaître ces lignes, ils les ont supposées et généreusement suppléées. M. l'abbé Descoqs les ignore, je crois ; mais il a raisonné comme s'il les eût possédées. De même, le Révérend Père Dom Besse, M. le chanoine Lecigne, M. l'abbé Appert et le prêtre qui a signé Jean Viergeot, tant de pages, trop bienveillantes ! Beaucoup sont dans le même cas. Tous se sont rendu compte que le « Christ hébreu » mêlé à l'apologie des Serviteurs était pour moi celui qu'invoquent les huguenots et les jacobins, comme le verset du Magnificat que j'avais isolé était précisément celui qu'isolèrent avant les abbés démocrates, les Frères moraves ou les Puritains de Cromwell. #
Quand, deux ans et demi après la publication de la Revue bleue, je recueillis Les Serviteurs dans mon livre du Chemin de Paradis, je fis la double et grave erreur de supprimer la note décisive qu'on vient de lire et de croire qu'elle était suffisamment remplacée par la page de la préface où j'avais opposé au « bizarre Jésus romantique et saint-simonien le Jésus de notre tradition catholique », car la pensée réelle y disparaît sous une profusion de pointes d'épines enchevêtrées. L'erreur ne m'était pas encore sensible il y a une douzaine d'années, quand ma parabole contre-révolutionnaire et anti-huguenote fut insérée dans la revue d'Action française 35. La mauvaise foi de nos ennemis aura toujours servi à me faire voir la méprise. C'est une des raisons qui, depuis, m'ont tenu un peu éloigné d'un petit livre où vivaient cependant les fraîcheurs et les violences d'une pensée qui était alors beaucoup plus jeune que son âge. Quelques jeunes gens qui, pendant ces dernières saisons, m'ont demandé de mettre ma signature sur leur exemplaire de cet ouvrage, se sont vu refuser un présent si modeste ; ils savent maintenant pourquoi. Je ne rééditerai pas ce Chemin de Paradis sans parer aux malentendus dont on vient de voir qu'il n'est qu'à demi responsable. #
Charles MaurrasLa Germanie : « Principes pro victoria pugnant, comites pro principe ». (n. d. é.) [Retour]
Le Culte du Moi, Sous l'œil des barbares. (n. d. é.) [Retour]
Déjà dans l'Odyssée, Hermès en offre en antidote à Ulysse pour rompre les charmes de Circé. On l'identifie au perce-neige. (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « s'agenouillât sur la route ». Notre texte est, comme pour tous les textes du Chemin de Paradis, celui de 1921. Nous signalons les écarts avec celui de 1895, date de parution du recueil. Le conte a d'abord été publié en 1892 dans la Revue bleue, il est repris en 1927 dans une édition d'art illustrée par Goor. (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « si les grammairiens t'ont bien instruit aux lettres ». (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « cela n'eût point été ». (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « qui erraient encore aux traces ». (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « fit délier ses chaînes. » (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « nous croyions que la liberté tenait ». (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « nous fûmes ». (n. d. é.) [Retour]
Psychagogue : magicien capable d'entrer en contact avec les morts, et plus particulièrement de les conduire aux Enfers. Le surnom d'Hermès Psychagogue apparaît au début du chant XXIV de l'Odyssée. (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « Sophonisbe ». Sophronisque était le père de Socrate, et Cléon était un général athénien connu pour sa vulgarité et son manque d'éducation. Mettre Cléon à l'égal de Socrate est évidemment ce que Maurras a voulu exprimer dans la bouche de Criton. Le nom de Sophonisbe, qui était une reine de Carthage qui se donna la mort pour ne pas être livrée à Scipion, et dont la vie fut de plus de deux siècles postérieure à celle de Cléon, n'a pu apparaître dans l'édition de 1895 qu'à la suite d'une confusion typographique qui n'a pas été rectifiée à temps. (n. d. é.) [Retour]
Le nom Christ apparaît ici, pour la première fois dans le texte, avec une majuscule. (n. d. é.) [Retour]
Ces 373 olympiades font 1492 ans. Maurras situe donc la scène vers 1520, c'est-à-dire au moment de la naissance de la Réforme luthérienne, laquelle vient en quelque sorte parachever le commandement émancipateur du Magnificat. (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « Grand Hermès ». (n. d. é.) [Retour]
En 1895 : « il baisa ses genoux ». (n. d. é.) [Retour]
Trismégiste (trois fois très grand) est un surnom attribué à un philosophe égyptien, sans doute mythique, auquel on attribue la naissance de l'alchimie. Maurras joue de la confusion, fréquente dans l'abondante littérature occultiste de l'époque, entre le dieu Hermès et le personnage d'Hermès Trismégiste. (n. d. é.) [Retour]
La première fois que ce conte fut imprimé, il portait, après ces mots, la note suivante : « Ici, le Psychagogue manque de bonne foi et le dieu des voleurs se montre aussi le dieu des sophistes. Mercure aurait dû ajouter (car le bon Androclès n'en pouvait rien prévoir) que la besogne des esclaves fut, durant plus de mille années, accomplie grâce à la servitude volontaire des ordres religieux aidés par la chevalerie, par des confréries d'ouvriers et d'artistes habilement organisées pour la prospérité de tous. L'harmonie de cet univers ne courut vraiment de danger que depuis deux ou trois cents ans. » [Revue bleue du 30 avril 1892.] [Retour]
En 1895 : « écrivain slave ». (n. d. é.) [Retour]
Il s'agit d'Edgar Poe. Cette citation a souvent été reprise par Maurras ; voir en particulier Trois Idées politiques. (n. d. é.) [Retour]
Il s'agit du chapitre V « Évangile et démocratie » de L'Action française et la Religion catholique, publié en 1913. Ce chapitre n'a pas été repris en 1921 dans l'édition de La Démocratie religieuse. Nous le donnons ci-après. (n. d. é.) [Retour]
Ce liminaire reprend en les adaptant à la marge les termes de la note additive C de l'édition de 1921 du Chemin de Paradis. (n. d. é.) [Retour]
Cette phrase marque une transition avec le chapitre précédent de L'Action française et la Religion catholique qui s'intitule « L'incroyant et le bienfait du catholicisme » et qui, contrairement au présent chapitre, a été repris dans La Démocratie religieuse et figure donc dans l'édition que nous en avons donnée. (n. d. é.) [Retour]
C'est avec ce paragraphe que commence la reprise de ce texte dans l'édition De Boccard du Chemin de Paradis. Elle y est précédée par les deux paragraphes introductifs suivants :
L'appendice que l'on va lire est très différent du livre auquel il fait suite. Mais, si vive que soit la disparate de l'accent et de la couleur, l'auteur du Chemin de Paradis tient à placer auprès de pages vieilles d'un quart de siècle quelques feuillets de son exposé de 1913, L'Action française et la Religion catholique, qu'il juge nécessaires à l'exacte intelligence de son conte des Serviteurs. Ces explications auraient pu éclairci également quelques termes de l'ancienne préface de 1894 s'il n'eût préféré supprimer de l'édition nouvelle ces termes qui lui semblent aujourd'hui offensants pour la conscience catholique dont il a toujours professé et conseillé le respect.
Il est de fait, et la preuve va en être donnée, que Les Serviteurs visent et touchent quelque chose qui n'est pas le catholicisme et qui en est même tout le contraire. Je n'avais donc pas à les supprimer, mais à en préciser le sens en faisant mieux connaître l'état d'esprit d'un catholique ayant cessé de croire et plongé dans une atmosphère intellectuelle et morale où ce qui dominait était la pensée de Genève et de Jérusalem. Les Serviteurs ont exprimé sa réaction contre le messianisme révolutionnaire d'un monde juif et protestant alors en voie de conquérir obscurément Paris et la France. Dans le jeu littéraire auquel il se livrait, l'auteur distinguait avec soin « ce qui appartenait au catholicisme » et « ce qui ne lui appartenait pas ». Comment ? Voici les grandes lignes de la direction suivie et tenue. Il ne s'agit pas de savoir si elle a été valable, mais ce qu'elle a été.
(n.d.é.) [Retour]
J'ai recueilli dans ma Politique religieuse un article qui date du 15 décembre 1900 et intitulé « la difficulté religieuse ». On y lit que « toute épithète vive, même adressée à la plus vénérable des idées, à la plus sacrée des personnes, n'est pas nécessairement un blasphème ou un sacrilège dans la pensée de son auteur ». C'était l'ébauche de l'exposé donné ci-dessus. [Retour]
« Ô souverain Jupiter, qui fus sur terre crucifié pour nous » – cf. Préface du Chemin de Paradis. [Retour]
À travers l'œuvre de Charles Maurras, par le R. P. Pedro Descoqs, chez Gabriel Beauchesne, 3e édition (1913). [Retour]
Jean Monneron est le héros principal du roman de Paul Bourget L’Étape, paru en 1902. (n. d. é.) [Retour]
Cité par M. le chanoine Lecigne, L'Univers du 31 août 1913. [Retour]
Discours prononcé devant l'assemblée générale du Congrès marial de Rome, le 2 décembre 1904. [Retour]
Démocratie du 3 août 1913. [Retour]
Dans La Nouvelle Bourgogne. [Retour]
Le texte complet de cette lettre apostolique, ainsi que les références aux déclarations antérieures de Léon XIII qu'elle contient,figurent en annexe de notre édition (format .pdf) de La Démocratie religieuse. (n. d. é.) [Retour]
La Revue bleue n'est pas et n'a jamais été un organe catholique, bien au contraire. Mon acte de déférence envers le catholicisme y était donc aussi spontané que gratuit. C'était au protestantisme universitaire que je montrai facia feroce. [Retour]
Pourtant, dès cette époque, notre aversion pour les malentendus nous faisait accrocher un écriteau à la place où je m'étais flatté de la chimère que mes idées avaient pu « mériter le titre de catholique ». L'écriteau disait : « Ceci est l'illusion de la vingt-cinquième année. La catholicisme est un dogme. Il ne prête ni au mélange, ni à la fantaisie... Les sentiments exposés ci-dessus ne sont qu'amis du catholicisme ; ils en sont les amis très fermes. » (Revue L'Action française du 1er avril 1901.) [Retour]
