Au vicomte de Léautaud.
Pourtant, l'on se montrait quelque auguste décombre,
Quelque jeu de soleil échauffant un pin sombre,
Par places le rayon comme un poudreux essaim,
Lumière du Lorrain et cadre du Poussin…
Sainte-Beuve.
Le Faux Printemps
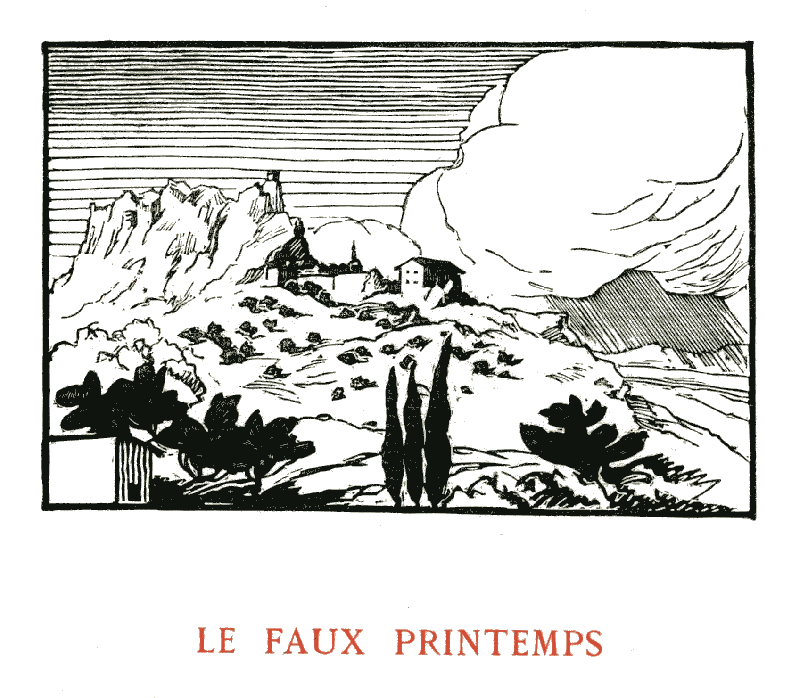
Nous avons traversé la France couverte de neige. Le petit jour qui s'est levé au midi de Vienne nous présente le même paysage glacé ; mes yeux faits à considérer ces campagnes par des matinées de soleil cherchent inutilement à les reconnaître. Des murailles fameuses autrefois saluées au passage d'un nom ami fuyaient sans souvenir, comme des étrangères. Seuls, accablés de neige, les plans horizontaux donnaient quelque vie au regard. #
À la frontière de Provence cette neige se dissipa. Dans un air coloré de longues franges roses, flottèrent, du levant au couchant, des flottilles de nuages de toute forme. Mais ces nuages s'empourprèrent ; sous leurs plis redoublés se manifesta le soleil. #
La lumière jaillit bientôt, dora les écailles du Rhône et courut multipliée comme un feu subtil entre les verges noires des petits arbres qui se succédaient dans la plaine. Ces lumières du ciel sont peut-être le souverain bien. Elles apportent le courage et l'égalité à notre âme et ramènent à leur proportion les maux que centuplait chaque folle imagination de la nuit. Ô consolatrices de l'homme ! J'avais le corps, l'esprit trop malades pour les nommer ; mais elles me sourirent en se distribuant sur toutes les choses. Les vieux murs ravivés s'échauffaient sous la flamme agile. Les teintes naturelles y refleurissaient à vue d’œil. #
Nous avions dépassé ces coteaux du Valentinois que baigne la Drôme, d'aquèa Valentinès que Droumo arroso, comme chante Mistral. Avenues de platanes et de mûriers, jardins déserts encore, maisons caduques et nouvelles adossées à la roche ou construites en plein champ, les petites villes prospères du Comtat se mirent à défiler dans cette splendeur. L'air dépouillé comme la terre nous laissa voir du haut en bas de leur structure les gloires romaines d'Orange. Ce fut un peu plus loin que la voie reprit sa tristesse. Introduits en Provence par une espèce de portique composé des nuances les plus délicates du ciel, ce portique franchi nous laissait retomber sous la loi de l'hiver. Point de neige, mais ces larges gouttes d'eau glaciale qui sont de la neige fondue, et toute la campagne pénétrée d'une demi-brume d'où sortaient çà et là des créneaux, des clochers, des tours. #
Je serais retombé dans l'état de langueur qui m'avait chassé de Paris si, en suivant le fil du Rhône, sous la mélancolie de l'espace supérieur, les formes des collines ne m'eussent révélé le mérite essentiel de leur composition. À la faveur de ce gris matin de février, elles m'ont fait comprendre qu'elles n'ont pas besoin des revêtements du soleil. Oui, ce pays vaut par lui-même. Les petites hauteurs qui environnent le monastère de Frigolet, le thym modeste qui les borde et les oliviers nains alignés en pâles bosquets témoignaient d'intentions exquises, et parfaitement réussies. #
J'imaginais qu'il faisait peut-être un froid vif et n'osais me risquer à la croisée de la voiture. Quand il fallut descendre en avant de Marseille, la bienveillance universelle me saisit, comme par la main. Dans l'air calme la pluie tombait légère sans répandre cette humidité pénétrante qui autre part menace de dissoudre l'âme et la chair. La pluie cessa ; l'air aussitôt devint sec et brillant. Il brillait non du lustre que laisse parfois une averse, mais, véritablement, de sa lucidité. Si le ciel restait floconneux, ces flocons se bombaient à des hauteurs divines et formaient une voûte qu'approfondissait le regard. #
Entre tant de remarques faites pour enchanter un transfuge et un exilé, le hasard du chemin me présenta un vieil amandier couvert de crevasses, que l'habitude de plier sous le même vent avait allongé sur le sol. Deux semaines plus tôt, on l'aurait pris pour quelque bûche monstrueuse réservée sur le bord du talus par les paysans. Mais à peine l'écorce noire était-elle visible sous la profusion éclatante des fleurs qui en avaient jailli. Non seulement la pointe des tigelles, mais une infinité de tétines imperceptibles échappées de l'écorce crevaient en nuage de fleurs. Entre le bois inerte et cette fleur aérienne, pas une feuille. Il m'en ressouvint, ma Provence allait ouvrir ses semaines de faux printemps. #
De toutes nos saisons, c'est assurément la plus belle. « Chaude, pure, dorée », trois mots d'un ancien hymne que je lui composai dans mon adolescence, me revenaient sur un rythme persécuteur. Mais, à quinze ans, tout enthousiasme exagère. À dire vrai, la pluie et le soleil se disputent ces jours charmants. Et, cette année, le soleil n'est pas assez pur pour sécher la terre amollie. Là-dessus, les paysans invoquent le mistral. Et le mistral accourt. Un fleuve aride passe sur la campagne, en boit toute l'humeur, durcit et maçonne la terre. Déjà le blé nouveau montre sa pousse d'un vert tendre et se met à trembler avec une inquiète douceur. Dans les arbres, le haut des vergettes se tend comme un mamelon trop gonflé. Des formes indécises en travail évident ponctuent la longueur des ramilles. #
Ce qui bourgeonne ainsi, malgré le mistral de février, brûle facilement six semaines plus tard. Notre Mars s'applique à mériter les noms redoutables que lui ont décernés les pères latins. À peu près certains de la ruine, les paysans se défendent d'un désespoir prématuré et tout en se donnant à des précautions infinies : #
« C'est la saison, assurent-ils, il faut que la sève travaille. » #
Peut-être convient-il de suivre comme eux la nature. Parmi tant de sagesse émanée de ces bons rustiques, la bourrasque a beau faire, les joncs et les roseaux plier eux-mêmes en tournoyant. Des abîmes de l'air à toutes les racines végétales de l'être, le ciel renouvelé impose sa jeune vigueur. La croissance de la lumière, une tiédeur manifeste de jour en jour, les fleurs de toute sorte qu'elle fait s'exhaler avec un soupir de plaisir, le souffle retenu mais sensible de tant d'autres fleurs latentes encore ont bouleversé la face et l'intimité des vivants. Hier n'est plus et tout s'efface de ce qui n'est point l'avenir. #

Ce matin, un pêcher en train de défaire sa fleur m'a tenu sans haleine et dans une espèce d'angoisse. Je ne trouvai à comparer à cet effort mystérieux que le bas-relief des divinités d'Éleusis. Mais, comme je priais ces Mères ineffables et le tendre jeune homme élu pour le signe sacré, les visibles déesses apparurent dans le ciel clair. Je les reconnaissais, la plus âgée à son sceptre trois fois fleuri, sa fille à la torche éternelle, préparant l'une et l'autre nos mortelles félicités. #
« N'en doutons plus, dis-je à mon ami : il approche. #
— Qui ? #
— Le véritable Printemps ! » #
Un vendredi à Avignon
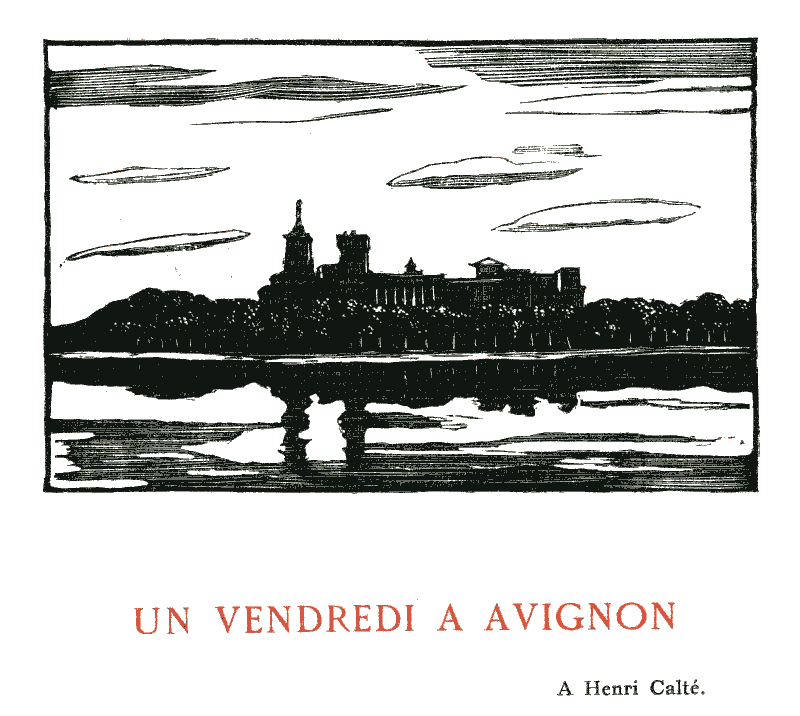
On conte qu'Alfred de Musset, quand il toucha à la vieillesse et à la mort, conçut un beau désir qui fut satisfait. Les conservateurs du Louvre lui permirent de visiter leurs salles au milieu de la nuit, accompagné des gardiens qui portaient devant lui des lampes. Musset avait senti qu'il y a trop de visiteurs dans les musées. S'étant mis à l'abri de ses contemporaines, il put communiquer dans la nuit solitaire avec Raphaël et Vinci. #
J'ai souvent envié au poète la liberté de sa promenade. Mais il me semble en avoir connu quelque chose dans la visite que je fis un jour à Avignon, ville qui vaut bien des musées. C'était un vendredi. Les rues étaient désertes, et les boutiques qui les bordent demi-closes. On avançait presque tout seul. De loin en loin, un ouvrier, ou quelque rangée de soldats. Mais on n'apercevait aucune Avignonnaise. Et toute la ville en avait changé d'aspect. #
Je tenais Avignon pour la ville du sentiment, un peu dupe du va-et-vient lascif qu'y entretiennent quelques centaines de jeunes femmes dont la beauté ressemble aux premières minutes du matin et du soir en ce que ces heures présentent de rapide et de passionné. Elles ont la peau d'une transparence céleste, le teint nacré des blondes, le cheveu brun, l'œil vif des Parisiennes et leur pied léger ; mais elles y ajoutent je ne sais quoi qui fait songer en même temps aux anges et aux bêtes des bois. On les sent princesses et fées, faunesses et dames de cour. Et, par tant de mérites, elles détournent de connaître comme il le faudrait leur patrie. Elles étendent au-devant un voile délicieux d'une vie si tentante qu'elle reste maîtresse de toutes les curiosités. Ici est le naufrage des archéologues, des critiques et des historiens. #
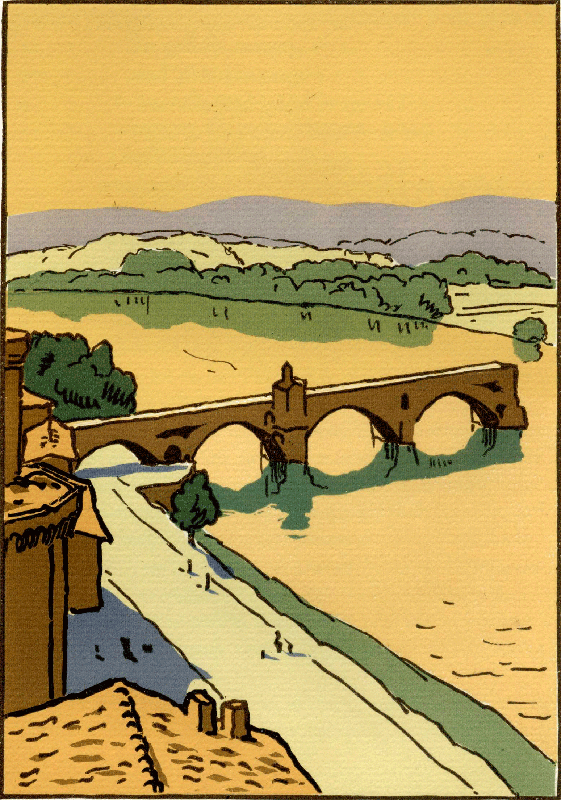
Il débarque parfois aux portes d'Avignon des voyageurs bien possédés de ces beaux et graves métiers. À peine ont-ils passé l'octroi, qu'ils se transforment, leur cortège ne compte plus que des amants. Ils ont vu de la route quel magnifique autel gothique couronne la roche des Doms et quelle solide dentelle ceint tout le corps de la cité ; parvenus au cœur d'Avignon, c'est d'une certaine nuance de châtain clair qu'ils ont l'âme prise. #
Heureusement, le vendredi, ce sortilège se dissipe, car les doux objets qui l'exercent ont disparu. En mémoire de la Passion et de la mort de Notre-Seigneur, les Avignonnaises se cloîtrent, comme le faisaient leurs grand'mères, à pareil jour. Fidèlement plus que pieusement peut-être. Mais dévotes ou non, qu'on prie ou qu'on se damne sous les voûtes de leurs logis profonds et sombres, elles ne sortent pas. Pas une, sinon vieille et laide ou de vie scandaleuse, ne se montrerait dans la rue. Les portes de chêne ouvragé ne se desserrent point. On peut sonder les lourdes grilles des fenêtres recourbées, pansues et fleuries, on n'apercevra pas beaucoup de ces visages dont le ton frais, la noble ligne, la fine, harmonieuse et suave pâleur vous eussent poursuivi la veille à chaque coin de rue. Vendredi, Avignon est libre de la fièvre qu'y sèment de jeunes démons. Ils se sont envolés sur un signe de croix des vieilles maisons papalines. La pierre se révèle. Depuis dix ans que je fréquente et que j'aime Avignon, c'est la première fois qu'il m'arrive de la bien voir. #
On peut donner d'abord un furtif regret aux païennes recluses. Mais quelles délices ensuite ! Avignon brille à son soleil. La merveille se sent aimée pour elle-même. Du pont Saint-Benezet, qui s'avance à pas mesurés jusqu'au milieu du Rhône, à la roche des Doms, d'où se distinguent, dit Mistral, « toutes les rivières du Comtat, toutes les villes qui hérissent la riche terre du Venaissin », du marché de la place Pie à l'église Saint-Agricol, on chemine, comme Musset à travers les salles du Louvre, entre deux rangées de lumineux et solides témoins du passé. Ce passé se ranime. J'ai retrouvé l'étonnement de ma dix-septième année, quand, arrivé dans Avignon au tomber d'une nuit d'automne, se révéla soudain, à l'angle d'une rue obscure, la ciselure délicate d'un vieux palais et avec elle toute la réalité de l'Histoire, pour attester que notre monde a connu des âges meilleurs. #
Cette sensation de la fin de l'adolescence me revenait accrue par de longues années de rêve. Rien ne m'en arrachait, la séduction d'aucun désir, ni un pas trop coquet, ni les parfums d'une insidieuse jeunesse. Mais j'éprouvais l'envie de me traîner sur le pavé et de poursuivre à genoux le pèlerinage pour réaliser la figure de l'indignité de nos jours. Le passé généreux revivait jusque dans les restes de l'austère tradition catholique qui tenait sous la grille un peuple de filles d'amour. Et combien ces petites filles sont difficiles à tenir, les prophètes de Memmi me le juraient du haut de leurs fresques pontificales, en hochant leurs yeux fins et leur grêle barbe de boucs. #
Il ne m'était jamais arrivé de pousser du côté du Rhône au delà de l'île de la Barthelasse ; j'ai marché cette fois jusqu'au bout du pont, atteint la rive droite et, prenant possession de la terre languedocienne, visité Villeneuve, de loin reconnaissable à cette tour carrée dont le pied baigne dans le fleuve et dont les quatre faces font autant de miroirs aux flammes du Rhône et du ciel. Les maisons, d'une vétusté ou d'une ruine également éloquentes, montrent de solennelles fenêtres à larges baies, des arceaux en suspens et mainte ferrure brisée. #
L'enceinte ébréchée du vieux fort de Saint-André couronne la colline, au versant de laquelle se développe un grand village construit avec ce qui reste d'une Chartreuse. L'olivier, le figuier percent au milieu des quartiers de pierre blanche. Les bassins et des puits couverts, encore intacts, tranchent sur les cases pouilleuses, d'où se lèvent aussi quelques troupes de beaux enfants. Il me vient en mémoire une strophe éclatante du pauvre Aubanel : #
Vieux Barroux, ton château décline,
Par l'homme et le temps accablé,
Mais le soleil verse à tes brunes
La beauté… #
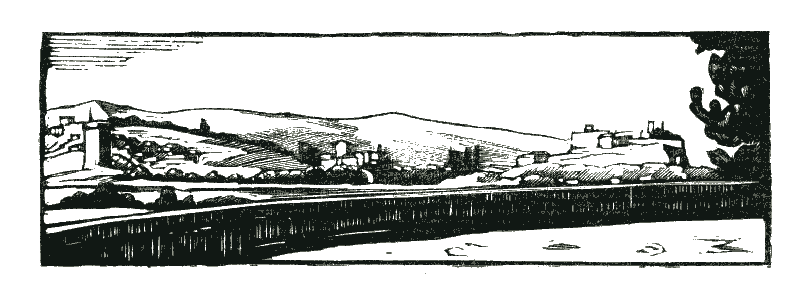
Aux portes d'Avignon, où je rentre, le soir descend, l'heure charmante dont le soleil va disparaître sous la nappe rose et verdoyante du fleuve. S'il n'était vendredi, ces rues, ces places seraient pleines. Tout rirait de plaisir. Une lueur papillotante, faite de robes claires et de clairs visages levés, courrait de toutes parts en petites vagues brillantes. Je ne trouve partout qu'une religieuse tristesse. Avignon se compose un air plus sévère, plus morne et plus conventuel encore que tantôt. La pensée rentre en elle-même. C'est à peine si l'œil prend garde aux bandes d'écarlate, de vermeil et d'orange que le ciel développe, avant de s'amortir, sur une pyramide d'églises, de toits et de tours. #
Hier, Avignon formait un temple sous le vocable de la jeunesse et de l'amour. C'est aujourd'hui la cathédrale illuminée où flotte un nuage d'encens. #
Les Collines battues du vent
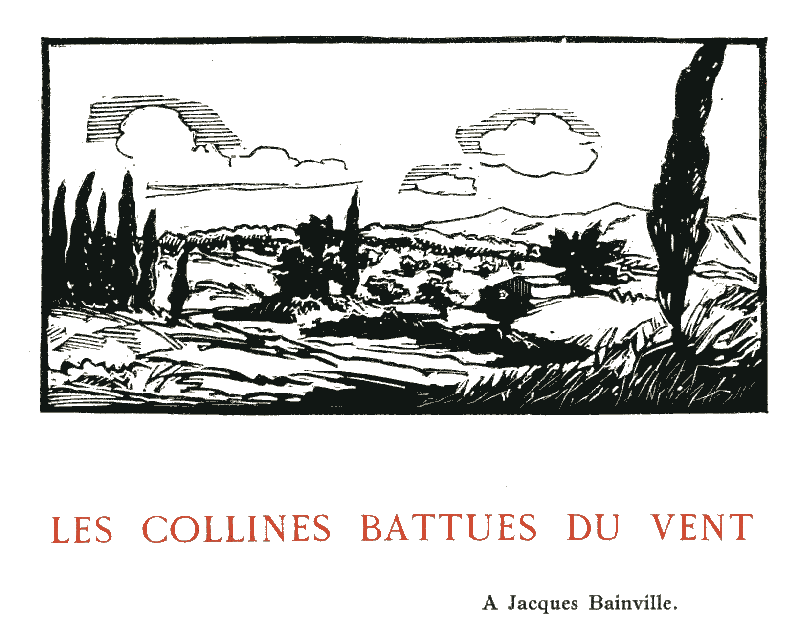
À Jacques Bainville.
Passé Arles, commencent de grands pays muets, peu différents de ceux qu'aima le funèbre Vigny. Cependant cette plate et marécageuse campagne, dure plaine où, dit un poète, les derniers enfants de la terre essuyèrent les coups des puissances du ciel, ne conseille à l'esprit aucune détresse. Son silence a le caractère de la destinée accomplie. Rien ne change, tout est fixé. Entre le ciel de saphir bleu et la lointaine mer d'opale, on y semble à couvert de vicissitudes et de labeur. #
Mais, après Miramas, sur la limite des arrondissements d'Arles et d'Aix, la nappe des terrains se plisse et s'ondule, les choses recommencent de souffrir et de sangloter à l'envi des choses humaines. Sur les tertres lépreux apparaissent des lots de pauvre terre jaune que parsèment des cailloux blancs. De tous côtés, le roc affleure, déchirant l'étoffe subtile du terreau. Le mistral et le vent d'ouest s'y déchaînent en liberté, au milieu de peuplades d'amandiers frêles et chétifs, tordus en des formes plaintives et levant leurs bras noirs sur la terre empourprée comme s'ils imploraient une vengeance et un pardon. Mais le ciel ne s'arrête pas de les flageller. Aucun mot ne peut dire le désespoir de ces arbrisseaux misérables, sous les coups du vent éternel. Je le perçus à l'heure du coucher du soleil, quand la voix du mistral se fait déchirante et cruelle. Ce n'est d'un bout à l'autre de cette plaine abandonnée qu'un geste et qu'un cri de pitié. #
L'étang de Berre est entouré d'un demi-cirque de collines qui se plient en arc byzantin et qui s'ouvrent vers le couchant pour lui frayer une communication à la mer. Ces collines sont d'une grande sévérité. Tout le haut de leur corps est nu. Depuis de très longs âges, les ondées d'hiver et d'automne ne cessent de précipiter la terre meuble qui donnait à la pierre sa toison et son vêtement. Maintenant le squelette du sol est visible partout. Tout ce plateau élance, du linceul végétal attaché encore à son flanc, des têtes rases et brillantes comme les ossements d'un héros déterré. Cette surface nue enduite d'une couleur livide ou sanglante, je ne sais rien d'aussi lugubre ! Sur les pentes s'agrippent des touffes de kermès et de ces chênes nains dont la verdure sombre ne cède point à la lumière, mais fait une tache éternelle par les plus beaux soleils d'été. Les arbustes enracinés dans le calcaire ne plient pas non plus sous le vent. Raidissant leurs baguettes, ils se contentent de gémir en égratignant le mistral. Musique aiguë, mais incessante, à laquelle s'ajoute le ton grave du pin. #
Le train s'arrête au cœur de cette terre d'affliction. C'est là que je descends, à la petite gare que l'administration a nommée le Pas-des-Lanciers. Le nom provençal de ce lieu est lou pas de l'ancié, c'est-à-dire, selon les uns, pas de l'angoisse, selon d'autres, du défilé. Peut-être, après tout, que nos pères avaient voulu signifier l'âme tragique d'une solitude battue du vent. Mais leur sentiment s'est perdu, et leur mot s'est défiguré. #
Les cartographes ont massacré la Provence, les ethnographes ne l'ont pas beaucoup mieux traitée. Je voudrais y conduire les esprits simples à qui tout le paysage du midi semble fait de pure allégresse et qui placent au nord le refuge définitif des cœurs tristes et repliés. Il me serait facile de leur montrer ici les tristesses de la lumière à l'heure de son agonie. La sensation s'accroît des reflets de la nappe d'eau qui étend, au milieu d'une terre maigre et dorée, ses pâles successions de nuances demi-mourantes. Sur la plage éloignée de Vitrolles et de Berre, les salins réfléchissent au fond de leurs carreaux la pulsation régulière du crépuscule. Aussitôt le soleil disparu sous les nuées fauves, un souffle d'extinction accourt en gémissant sur le monde décomposé et l'on dirait qu'eux-mêmes, les sages oliviers, aient sur leurs troncs inébranlables, cédé à la voix du chagrin qui s'exhale de tout. Leurs cimes claires sont touchées du frémissement et palpitent ensemble dans le nocturne effroi qui tourmente plus loin la plume des roseaux et l'écharpe des tamaris. #
Ah ! malgré la joie du retour, quoique je me redise le beau sonnet de Joachim sur l'agrément d'un long voyage et d'une rentrée au jour dit, et bien que, moi aussi, je voie tournoyer au couchant quantité de petites fumées qui me sont chères, il m'arrive de cet air vif, de ce vent furieux, de ces champs misérables, que la vigne, rampante et malade, n'égaye plus, un serrement de cœur étrange. Non, ce n'est point de sérénité ni de paix que se trame la vie sur ces collines, au bord de ces eaux passionnées. J'ai bien peur qu'il n'y passe tout autant de souffles amers que j'en ai senti autre part. L'impression est si forte qu'à voix basse, comme un Ancien, je prie le vent furieux d'épargner, ce soir, ma colline. #
L'Étang de Marthe et les Hauteurs d'Aristarchê
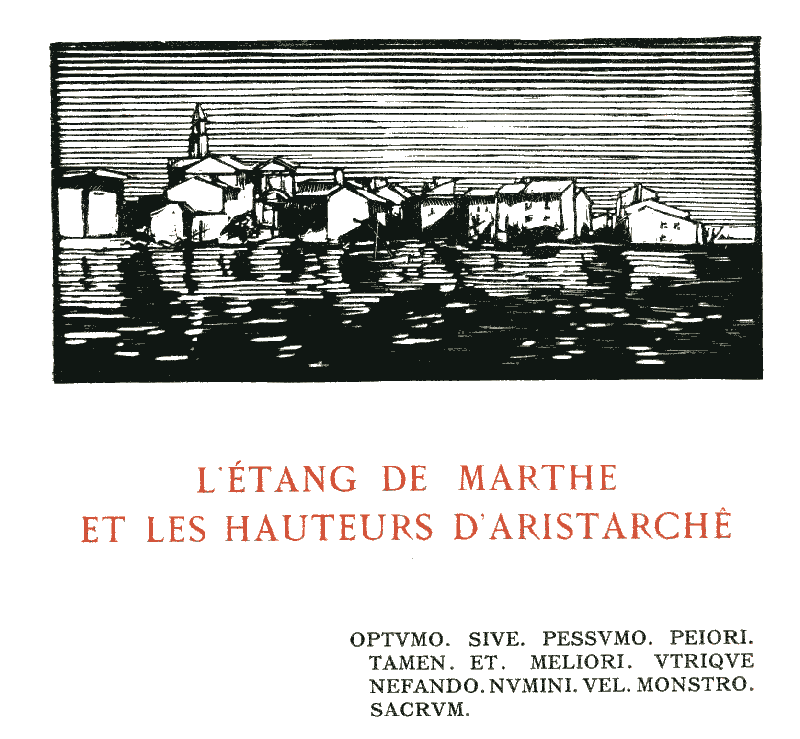
Ma petite ville est assise sur les confins de deux pays presque contraires, et cependant elle est l'ouvrage de l'un et de l'autre. Par Arles, par Marseille, elle tient à la plus ancienne histoire de l'Occident ; par la Basse Camargue à des terres sans nom, à peine tirées de l'abîme. #
I
Vers le soleil couchant, sur un bandeau grisâtre qu'on aperçoit de la fine pointe de nos collines, travaille le Rhône divin. Il accumule grain à grain les îlots sablonneux à sa barre d'écume blanche, et les terres, gagnant ainsi d'un siècle à l'autre, ont repoussé la mer. Du temps de Constantin, la mer baignait encore le pied des remparts arlésiens. Elle est donc refoulée de plus de douze lieues dans la direction du sud-est. Il y a six cents ans, la tour Saint-Louis marquait l'embouchure ; cette tour se trouve maintenant en pleine campagne. Entre elle et le rivage s'étend un immense pays. Chaque année, le limon maçonné et consolidé allonge une pointe nouvelle au-dessus d'un fleuve de fange. Ainsi naissent autour de la première épave, dépourvus de toute fondation de rocher, les pâtés de vase liquide qui émergent avec lenteur. #

Aucune origine n'est belle. La beauté véritable est au terme des choses. Élevées de quelques lignes au-dessus de l'eau et creusées de larges cuvettes où l'infiltration de la mer se mélange à celle du fleuve, ces îles ont peut-être une sorte de charme triste. La terre est grise, crevassée, la flaque du milieu y luit malignement comme une prunelle fiévreuse. Sur la rive frémit parfois un tamaris aux flexibles tigelles roses, qu'un maître vent plie et balance, rebrousse et fait tourner sans que l'arbrisseau solitaire élève un murmure de plainte, si vague et si légère est sa vie ! Plus près du sol, rampent les soudes et les salicornes humides, grasses touffes qui servent de pâture aux chevaux et aux taureaux sauvages, quand ils descendent jusqu'ici, dans la belle saison. Des chasseurs, des gardiens, des pâtres accompagnent au désert le libre bétail. Mais, à l'hiver, tous s'enfuient devant la tempête. Elle est reine de ces parages, quelquefois assez forte pour rompre les dunes et remmêler les îles, les étangs, le fleuve et la mer. #
Sable mou, petits arbres maritimes, herbage salin, rompu et couché par le vent, ô l'inqualifiable et mélancolique étendue ! Cela n'ondule presque pas. Tout ce vaste lieu vide est occupé des voix contraires de l'immensité déchirée, accrues du son gémissant des vagues voisines. Saturés de sel et de miasmes, de fièvre lourde et de liberté surhumaine, la lande née d'hier nous apprend tout ce qui se peut enseigner de la Mort, car elle nous confronte, en métamorphose secrète, avec le va-et-vient continu de ses éléments. Ce sont des nouveau-nés, et déjà moribonds. Rien de fixe, tout naît et tout périt sans cesse. Nulle vie vraie ne se dégage qu'après dix mille efforts manqués. Une incertitude infinie. Des débris coquilliers demi-engagés dans le sable aux vols de goélands qui ne font que tourner en cercle inutile, des galets blancs pris et rendus, repris encore, aux ibis migrateurs dont la rose dépouille flotte avec le soleil sur le plat moiré des étangs, il n'y a rien qui n'avertisse le sage promeneur des menaces de son destin. #
Il est tout seul avec lui-même. Il y est sans amis, ou les amis qu'il a disparaissant de toutes les sphères du souvenir, réduit au pauvre centre de son individu, il se répète, à chaque pas qu'il fait, pour seules paroles : « Moi et moi, nous mourrons. Moi celui qui me parle, moi, celui qui m'écoute, nous allons mourir tout entiers. » Les choses provisoires, instables, fugitives qu'il a devant les yeux imposent en lui leur chaos. Il voit, il sent, il expérimente ses propres ruines. Et, dissolu, dans l'antique force de ce beau terme, reconnaissant que sa fertile illusion s'est brisée, il ne découvre aucun objet d'assez humain, d'assez flatteur, d'assez spécieux, d'assez faux pour lui cacher la douceur sacrée de l'abîme. Le néant et la mort ont soulevé pour lui leur voile, et il les voit enfin tout nus. #

Celui qui ne meurt point de cette vue en tire une nourriture très forte. Il ne craint plus le mal, il ne le connaît même plus. Le paysage pisithanate procure à celui qui le subit et s'y conserva la force nécessaire pour vaincre toute vie et, conséquemment, pour la vivre. Comme Ulysse et Enée, il est descendu aux enfers. Son cœur mortifié s'est endurci et peut rejoindre au commun cercle les actions mesurées et systématiques des hommes. #
III

Que le fleuve poursuive ses travaux d'atterrissement et continue ses pilotis contre la mer, et le jour peut être prédit où les boues de Basse Camargue auront poussé leur nappe grise jusqu'au pied de nos claires falaises de Carro 1 et du cap Couronne, aujourd'hui battues par un flot vivant. Le golfe de Fos deviendra un étang fermé. On reverra de ce côté ce que nous voyons vers Saint-Mître, une plate étendue de matière palustre, humide encore ou très gercée, interrompue soudain par un mur de calcaire qu'échauffe et dore le soleil. Ces bas et torpides terrains font témoignage d'un premier état submergé, d'où sortaient seulement les chaînons de collines blanches. Au surplus, de petits étangs achèvent çà et là d'exhaler une eau pauvre et muette. D'étroites chaussées, faites de main d'homme, quadrillent ceux qu'on exploite en marais salants. #
Je connais un vallon qui donne l'image de l'ancienne configuration du pays. C'est une cuvette fort plane, spacieuse et désolée. On n'y peut faire un pas sans entendre céder la brillante croûte saline ; mais, presque en son milieu, la jetée qui s'avance entre un double marécage à peine épuisé, porte une file de puissants et noueux tamaris ; ils traînent leur feuillée avec une si grave expression d'affaissement et de deuil qu'on dirait quelque procession de royales veuves en larmes, agenouillées près du corps mort. Leur fantôme mouvant conserve le murmure de la petite mer qui rendit son âme à leurs pieds. #
Cependant, du haut des éminences environnantes, collines et coteaux taillés d'un ciseau ferme et pur, on ne peut se défendre de quelque mouvement de pitié dédaigneuse pour ces extractions de marais, race triste, languissante et inférieure. Sur les degrés où ils se tiennent, l'olivier, le laurier, le figuier, le cyprès, le chêne et le pin respirent un éther salubre et leur racine pousse au roc fondamental. Çà et là, au-dessus des arbres, une crête chauve apparaît. Courbée avec mollesse ou taillée droit comme une table, elle porte sur son cristal incandescent la limpide flamme du ciel… Bien que tout soit fait de limon, il y a pourtant fange et fange ; ces quartiers de rochers montrent un meilleur ordre que la poussière du désert, et leur coulée antique prit en se condensant des figures supérieures. #
Quand l'homme sera devenu assez savant et assez sage pour se rebâtir un Olympe, quelque mythe rendra sensible à la raison 2 l'excellente structure, l'heureuse fonction des hauteurs. L'homme pieux louera alors la vertu des principes ou des élémentaux qui, au lieu de briguer tous à la fois la même portion de soleil et d'air, reçurent le système d'une inégalité infinie ; car, en se soumettant de la sorte les uns aux autres, ils permirent à l'ordre et à la beauté de fleurir. La plupart de ces atomes pères du monde vivent ensevelis, au ventre des roches obscures, sans se flatter d'aucun espoir qu'aucun mouvement naturel les pousse jamais au dehors, avant une multitude de siècles. D'autres, heureux, seront éternellement caressés des feux de la Nuit et du Jour. Le bonheur de ceux-ci, l'infortune des autres, conditions nécessaires à la qualité de chacun ! Le monde entier serait moins bon s'il comportait un moins grand nombre d'hosties mystérieuses amenées en sacrifice à sa perfection. Hostie ou non, chacun de nous, lorsqu'il est sage et qu'il voit que rien n'est, si ce n'est dans l'ordre commun, rend grâces de la forme qu'a vêtue son sort, quel qu'il soit ; il ne plaint que les disgraciés turbulents dont le sort est sans forme et que leur destinée entraîne à l'écoulement infini. #

Le genre humain est le principal bénéficiaire de la divine économie qui distribua les hauts lieux. De quelque façon qu'il se nomme, le génie qui tailla et qui mesura leur stature, disposa leurs précipices et leurs gradins, sera loué des hommes pour avoir façonné un socle à leur pensée. Personne n'eût pensé dans le tourbillon d'une matière qui se décompose à vue d'œil. Il y faut la solidité, la durée, la constance. Par cet esprit sublime, au lieu d'errer dans la solitude, nous nous groupâmes ; au lieu de songer à la mort, toutes les industries de la vie nous sollicitèrent ; quittant le vain caprice, l'inquiétude et ses ferments corrupteurs, notre activité fit son œuvre et, Prométhée aidant, un autre monde, le nouveau monde de l'homme, brisa et recréa les formes de l'ancien. #
III
Quelques historiens provençaux veulent que ma petite ville ne soit née qu'au XIIIe siècle ; d'autres la signalent au commencement du XIIe. Je dirai hardiment qu'elle est tout au moins du XIe, puisque l'année 1040 y vit naître ce Gérard Tenque, fondateur des moines hospitaliers de Saint-Jean qui devinrent les chevaliers de Rhodes et de Malte. #
Quelle que soit la date de la ville fondée, toute la région supérieure du pays fut certainement occupée par les peuples antiques, dont la trace est écrite sur les monticules rocheux qui lèvent leur échine dans notre région des marais au pourtour de l'étang de Berre et qui meurent enfin au bord de cette mer, après des courbes et des détours multipliés. La plus sauvage et la moins fréquentée de ces presqu'îles forme un entablement décharné où sont les débris de trois ou quatre centres d'habitats successifs, imposés presque l'un sur l'autre. Le dernier date de la fin du moyen âge ; le premier, d'une antiquité mal évaluée. Des appareils de blocs rectangulaires dessinent des fondations de remparts, des bases de tours ; la science indécise murmure là-dessus des noms puniques, ligures et pélasgiques. Non loin, plusieurs centaines de tombeaux, creusés dans une pierre assez tendre, indiquent par la variété de leurs dimensions le séjour prolongé d'une peuplade, avec ses enfants et ses femmes. Violées maintenant, les tombes pleines d'eau de pluie servent d'abreuvoirs aux troupeaux ou portent des corbeilles de menthe sauvage et de thym. #

IV
Une pièce mieux définie, plus élégante et d'un passé presque sans brume, faillit donner à ce rivage un très beau nom. #
C'est un petit tableau de marbre trouvé en 1801 par un chirurgien du pays dans une île qui s'est longtemps appelée l'île Marseillès. Il représente une prêtresse qui, chargée d'une statuette, se prépare à monter dans un navire. Un jeune homme portant pour tout habit le capuchon des gens de mer, s'avance dans la barque au-devant de la passagère. Ce curieux groupe 3 acquiert tout son sens par un texte, d'ailleurs bien connu, de Strabon. #
Le géographe dit que les Phocéens, quand ils s'éloignèrent de leur patrie, reçurent un oracle leur enjoignant d'aller prendre un guide désigné par la Diane d'Éphèse. Ils poussèrent donc à Éphèse, s'enquérir du guide inconnu. Mais l'une des plus illustres dames d'Éphèse, Aristarchê (nom bienheureux pour cette fondatrice de colonie), venait précisément d'avoir un songe, dans lequel Diane lui avait ordonné de suivre en mer des étrangers après s'être munie de l'image honorée sur ses autels. Aristarchê n'objecta rien, mais obéit. Les Phocéens charmés lui firent grand accueil et, plus tard, une fois fixés à Marseille, quand ils eurent bâti à Diane un temple magnifique, Aristarchê en fut constituée la grande prêtresse et comblée de tous les honneurs. Chaque colonie de Marseille eut, dit Strabon, son Ephesium ou temple de Diane, pareil à celui de la métropole. Diane y tenait le premier rang et son image était placée et honorée, suivant le rite éphésien. #
Il est trop évident que le marbre trouvé au Martigue fournit un abrégé délicat de cette anecdote. Voici le rivage d'Éphèse, voici Aristarchê, comme elle finit d'obéir. Elle s'embarque. Le pied droit pose sur la terre et la quitte, le gauche appuie déjà sur le bas de la planche qui monte du sol au vaisseau... Heure sacrée, Aristarchê vient de commencer son émigration. Au-dessous, se recourbe et serpente le flot de la mer vagabonde. Nu-tête, de très beaux cheveux ondes glissant en chignon sur la nuque, les plis du manteau à la brise, elle-même emportée par son mouvement, elle semble esquisser toutefois un recul léger. C'est qu'elle a sur l'épaule la déesse éphésienne de la ville future et que, trop obligeant ou mal instruit du rite, l'homme qui la reçoit veut lui enlever cette charge. De quel geste elle la défend ! #
La statue a la forme des xoana, mais c'est un xoanon embelli, poli et dégagé, nullement la grossière idole primitive. Si elle affecte une rigide forme oblongue, un peu égyptienne, la cause n'en est point un défaut de science, mais souci d'observer un certain canon religieux. L'hiératisme a stimulé la recherche de l'élégance. Rien de mieux fait, ni qui soit indiqué plus fidèlement que cette gaine lisse dans laquelle les pieds divins sont emmaillotés. Un pan de voile est ramené en carré sur le haut du front à peu près comme dans la coiffure de nos madones. Chaque détail de barbarie, étant ici la chose sainte, y est mis en valeur de toutes les forces de l'art. #
En même temps qu'elle repousse les offices du Phocéen, Aristarchê, d'un souple effort, raffermit la déesse sur son épaule. Si elle a quitté la patrie, on ne la verra point négliger le dieu paternel. Aucun autre qu'Aristarchê n'en transmettra le culte à la terre étrangère ; mais elle le fera dans les circonstances et selon le cérémonial convenus. #
Si nous voulons entendre battre le cœur de l'homme antique, l'occasion nous en est proposée dans ce petit marbre. Depuis le sol éphésien, paré d'un arbre sans feuillage, jusqu'à l'élégante nef de Phocée, ce qui passe, ce qui franchit le feston de la mer sur cette planche oblique, c'est autre chose qu'une sainte femme exaltée, c'est le corps, c'est l'âme vivante de la religion, et dans ce corps, et dans cette âme, une tradition, une politique, une patrie, une intelligence, des mœurs. La ville de demain est comprise dans la déesse. Elle a chargé la délicate Aristarchê. La mer, les vents, le ciel, la destinée n'ont plus qu'à se faire propices ; moyennant quelque sourire des conjonctures, Marseille lèvera des semences mystiques enfermées dans cette poitrine et sous ce beau front. #
V
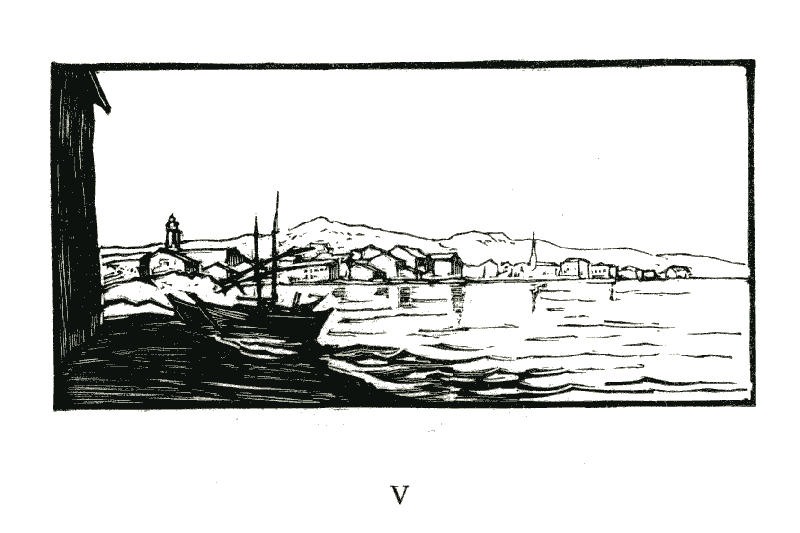
Il faut bien se garder de juger Marseille antique par un coin de la ville moderne, le rendez-vous des levantins, des nègres et des juifs. Il ne faut même pas s'arrêter aux éloges que lui prodigua Rome après qu'elle l'eût occupée, quand elle la priait de lui enseigner la grammaire et les lettres grecques comme une maîtresse d'école. Avant d'être aux Romains, Marseille était comptée entre les plus polies des villes de la Grèce. On donnait en modèle sa constitution aristocratique, la sagesse de ses sénateurs, ou timouques, nommés à vie au nombre de six cents et pris dans les seules familles ayant droit de cité depuis trois générations. On vantait son hospitalité libérale, sa frugalité et sa retenue. Des lois équitables, en petit nombre, exposées à la vue de tous fournissaient une règle aux actes de la vie et ceux mêmes qui voulaient se donner la mort étaient invités à soumettre leur projet aux débats du conseil de ville. Jamais la fantaisie et l'humeur du privé ne furent à ce point tempérées pour le bien de tous. #
Cette remarquable sagesse s'expliquera d'un mot. Elle était athénienne. J'entends qu'elle était venue d'Athènes tout droit. Phocée avait été fondée par un Athénien, Philogène, et Éphèse par Androclès, fils de Codrus, Athénien encore, en même temps que les dix autres colonies athéniennes de l'Ionie : Chio, Priène, Colophon, Lebedos, Myonte, Milet, Érythrée, Teos, Clazomènes et Samos. Smyrne en sortit un peu plus tard. C'est de ces émigrés athéniens de l'Ionicon qu'Homère naquit, s'il naquit. Les Phocéens qu'Aristarchê suivit à Marseille étaient donc deux fois Athéniens, par leur ligne directe et par l'adoption religieuse d'Éphèse. Comme s'ils eussent dû participer de toutes les forces du monde antique, ils s'assurèrent, en passant à la hauteur du Tibre, l'amitié du peuple romain. Ce premier traité fut conclu vers l'an 600 et sous Tarquin. #
Les émigrants avaient aussi passé en Corse, peut-être en d'autres lieux de ces mers d'Hespérie qu'ils connaissaient de longue date, les ayant écumées pour y faire la pêche, le négoce et la course, qui, observe Justin, était alors en grand honneur. Le même Justin semble dire que le premier détachement phocéen, formé de jeunes gens, ne toucha point le sol gaulois à Marseille, mais bien à la bouche du Rhône ; le bon accueil qu'ils y reçurent les aurait décidés à retourner quérir le gros de leurs concitoyens qu'ils avaient dû laisser sur un autre point de la mer. #
Ce texte de Justin a retenu l'attention des archéologues. Ils se sont demandé si la Marseille primitive ou, du moins, le premier établissement phocéen ne fut pas dans cette île Marseillès où le marbre d'Aristarchê a été découvert. Le nom de l'île donne à songer. Sans doute elle n'est pas située à la bouche du Rhône, comme il le faudrait pour vérifier absolument le texte de Justin. Mais les premiers colons phocéens, commettant une erreur qui fut fréquente plus tard, purent se croire au bord du fleuve même, quand ils n'étaient qu'au débouché d'une suite d'étangs traversés de très vifs courants quasi-fluviaux. Ayant débarqué en ce lieu, ils y durent bâtir leurs premiers édifices. #
Soit fille de Marseille, soit peut-être sa sœur aînée, la colonie phocéenne de Marseillès fut, de toute façon, l'un des centres helléniques de la Provence. Le bas-relief d'Aristarchê ne peut avoir été apporté d'autre part. Le docteur Terlier, auteur de la trouvaille, vit la stèle encastrée dans un petit monument qu'il appelle un tombeau. Il dut l'en détacher. Le reste de l'ouvrage a disparu de l'île, que des carriers ont aujourd'hui à peu près nivelée, mais l'existence en est formellement attestée. Si quelque temple avoisina ce tombeau, c'était sans doute un Dianium, chacune des colonies marseillaises ayant le sien, et la tombe à laquelle se rapporte le bas-relief pouvait être d'une prêtresse de Diane, sans doute du même rite qu'Aristarchê. Il serait ambitieux de croire que nous possédions un fragment du tombeau de l'Éphésienne elle-même. Cependant, pourquoi pas ? #
Avec cette Diane d'Éphèse, présent d'Aristarchê, avec l'Apollon delphinien, commun patron de l'Ionien en quelque pays qu'il émigré, la Minerve athénienne devait être adorée ici. Non peut-être la Minerve de Phidias, trop postérieure aux premiers transferts d'Attique en Asie et d'Asie dans les Gaules, mais cette très ancienne image de Minerve, qui figurait la déesse assise et aux genoux de qui la vieille reine Hécube, accompagnée des plus nobles dames de Troie, porta le voile d'or et, dit Homère, les prières qui ne furent pas exaucées. Phocée possédait une des Minerves assises. On en gardait une autre à Chio. Homme de Smyrne ou de Chio, Homère donna aux Troyennes la déesse de sa patrie. Un texte formel nous apprend que Marseille posséda également la statue honorée par Phocée et Chio. La patronne d'Athènes a donc régné sur nos rochers et leur pure corniche connut les pompes dérivées de Panathénées archaïques. Un ciel infiniment moins brutal que celui du reste de la Provence maritime flotte sur ces promontoires bleus et dorés ; la délicatesse de sa lumière ne pouvait manquer d'enchanter des yeux ioniens, soit qu'elle s'éteignît sur les eaux du couchant, au milieu des plus vives nuances de la pourpre, adoucies d'améthyste et d'or, soit que ses premiers feux revinssent couronner de safran et de rose le cône vigoureux où se lève notre soleil. #
VI
Du cône oriental de cette montagne maîtresse nommée plus tard par les Latins la montagne de la Victoire 4, parce que la victoire de Marius ouvrit de là son aile sur la barbarie cimmérienne, le pays entier se compose, exactement comme l'Attique tire toute sa loi du Pentélique protecteur, qui étend son bras sur Athènes. Les coteaux qui descendent de cette Victoire azurée, les collines qui font le cercle à son entour ne sont pas indignes de ce beau chef. La plupart se distinguent par la nervure et l'assemblage, d'une précision excellente. Leurs grands corps allongés déclinant à la mer suivant une courbe très pure m'ont rappelé parfois cette déesse que Phidias avait couchée à l'angle de l'un de ses frontons. Ils encaissent des vallons spacieux, dont quelques-uns sont égayés de vignes, de vergers, de labours et de petits bois. Là nymphes et sylvains menèrent à la danse la jeunesse des environs ; là dut s'épanouir cette fine et puissante conception de la vie qui, faisant la vertu plus vertueuse, l'innocence plus innocente, donnait aux différents plaisirs de l'esprit ou du corps un caractère de pureté ou de perfection. #

Que la prêtresse Aristarchê ou ses élèves aient enseigné ici les arts de la sagesse et de la volupté, j'en ai des preuves plus certaines que le marbre, car elles vivent, elles sont de chair et de sang. Ces beautés naturelles sont issues de l'effort ardent et délicat du régime de la sélection de l'amour. Leur privilège se continue comme de lui-même ; il ne se forma point sans la palestre et les autres jeux qui sont les maîtres de l'élégance physique. Le torse, le buste divin de l'Amazone d'Épidaure à laquelle j'ai fait visite chaque jour de mon mois d'Athènes, je le revois ici, mais inflétri et sans blessure, quand la saison des bains fait accourir la troupe de nos vierges sur le rivage. De tant de beaux corps demi-nus, il en est souvent jusqu'à deux ou trois dont la forme et l'impétueux mouvement ne dépareraient point le splendide coursier de marbre aux pieds brisés que chevauche cette Amazone… « Tu es parfaite 5, arrête ! » Mais aucune ne s'est arrêtée dans sa perfection et, sans être un vieillard, j'en peux nommer plus d'une qui se délie dans l'argile du cimetière. Jamais les dieux ne cessent de dissoudre ni de créer. Mais les générations répètent la formule. Ordre de l'insertion et de l'involution, éternel au même rameau ! #
Aristarchê me paraît présente et comme vivante en divers autres caractères qui ne peuvent venir que d'elle, et, par exemple, un certain amour des tâches bien faites, le goût de l'achevé, du poli, du fini. Qu'il s'agisse d'une enceinte à prendre les thons ou d'un sauvetage très difficile, les pêcheurs du pays, dans la pratique de leur art, aiment, en quelque sorte, l'art. C'est une inclination qui ne fait pas uniquement des artisans habiles. C'est un principe de bonté. Celui qui sut aimer l'emploi coutumier de ses heures ne peine plus comme un esclave que plie la main d'un maître dur. L'activité résulte du jeu même de ses puissances ; elle jaillit d'une nature qui met sa force et sa gaieté à changer la face du monde. Il ne peut être homme nuisible ni mauvais homme. #
Fier du produit, plus qu'intéressé au profit, ce subtil artisan peut avoir des passions, mais il n'aura point de bassesses. Nos prud'hommes disaient en calant leurs filets : « Notre Père, faites nous prendre assez de poisson pour en manger, en donner, en vendre et nous en laisser dérober ! » Le Juif cupide, l'étroit Latin, le Celte paresseux et léger n'auront pas fait cette prière. Elle est grecque, tant par l'épigramme finale que par le beau tour généreux, et fier. Les dieux d'Aristarchê furent des génies bienveillants. #
VII
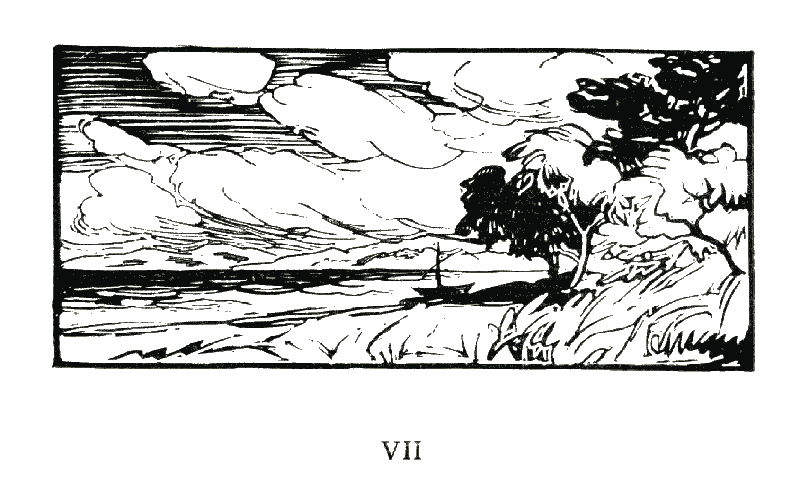
On discute beaucoup des services que Rome rendit au monde. Je reprends qui les nie, mais je blâme qui les célèbre. Rome a propagé l'hellénisme, et avec l'hellénisme, le sémitisme et son convoi de bateleurs, de prophètes, de nécromans, agités et agitateurs sans patrie. Quel manque de discernement chez ses prêteurs et ses proconsuls ! Non seulement ils ne surent point distinguer l'Hellène pur de l'Hellène contaminé, mais ils poussèrent à la contagion de l'Asie. #
Marius était le plus grossier des soldats. Plutarque nous apprend qu'il traînait depuis Rome dans ses camps de Provence une devineresse née en Syrie et du nom de Marthe. À Rome, les débuts de cette Marthe avaient été durs. Le sénat l'avait éconduite. Mais un jour, dans l'amphithéâtre, s'étant flattée de deviner le gladiateur qui vaincrait, son présage se trouva juste. L'événement frappa d'admiration la femme de Marius. Cette Julie était crédule, elle dépêcha Marthe à son démagogue d'époux. Celui-ci, n'ayant aucun préjugé de sénateur, avait probablement tous les autres. Plutarque, qui fait très peu de cas de la prophétesse, se demande si Marius était plus fourbe que superstitieux. Dans les deux cas Marthe convenait. Elle lui plut et fit fortune. On ne la revit dans les camps que portée en litière avec de grands honneurs. Le général romain n'offrait de sacrifice qu'après avoir pris son avis. #
Marthe avait de grands dons, l'impudence, l'entêtement, la solennité de l'affirmation religieuse, et beaucoup de souplesse. Cela est juif. Mais elle avait tiré parti de son séjour parmi les peuples civilisés, qui lui avaient appris des raffinements de costume. Quand Marthe allait au sacrifice, elle portait, selon Plutarque, « une grande mante de pourpre qui s'attachait à sa gorge avec des agrafes, et elle tenait à la main une pique environnée de bandelettes et de couronnes de fleurs ». Ce brillant appareil passait naguère encore pour inscrit sur un roc des Alpilles, aux Baux. On croyait reconnaître sur le bas-relief la figure de Marthe, entre un soldat que l'on appelait Marius et une femme qui correspondait à Julie ; la pique et le manteau joints à la mitre orientale dont la fausse Marthe est coiffée, donnent de l'apparence à cette attribution. Mais on la rejette à présent. Il est admis que Marthe ne nous laissa aucun portrait, ou qu'elle l'inscrivit sur une eau indécise et trompeuse comme elle-même. #
Car cette comédienne (ainsi la dénomme Plutarque) dut plutôt se fixer sur le bord de nos marécages et dans les lieux les plus stagnants de la contrée. Un territoire moins sujet à la confusion primitive aurait moins secondé l'art de cette sorcière. Les auditeurs eussent trouvé sur les rochers de la montagne et dans les figures du ciel des points de repère et d'appui contre la maligne influence. Mais surtout, la barbare aurait risqué de se heurter à la salubre sagesse de l'Ionie. L'esprit des Grecs ne s'était pas encore gâté dans ces parages, habités par Minerve, Apollon et Diane, les plus nobles de tous les dieux. Une religion comme celle d'Aristarchê faisait partie de la politique. C'était le cœur de la cité aussi bien que de la maison. Elle rejetait naturellement les prêtres libres et les prêtresses ambulantes. Le sourire public aurait consommé la justice. Marthe ne s'y exposa point et resta dans le bas pays. #
En un endroit que le navigateur Pythéas aurait comparé au visqueux élément du poumon marin, près d'un étang, entre une eau épaissie de bourbe et le sol toujours détrempé, sur des lits d'une algue confuse et pestilentielle, cette femme syrienne affola tout ce que le pays contenait de rustres et de goujats. Elle les rapprocha des bêtes et ils la portèrent aux nues. Elle prophétisait, donnait le mal, l'ôtait, le rendait, et cette solitude tragique lui servant de vague trépied, le lieu impressionnant, l'opaque fumée du repaire, une fièvre pernicieuse éparse dans l'air alourdi ajoutaient à l'effet des incantations qu'elle psalmodiait du fond de la gorge. Elle agitait le cœur de l'homme. Elle l'isolait, l'égarait. On la salua bienfaitrice. II ne fut question que de Marthe et de son étang. Si cette gloire abjecte dut se désagréger plus vite que ce corps hideux, il en resta les syllabes évocatrices qu'elle avait attachées au mauvais canton du pays. Une suite de dérivations régulières donna du marthicum stagnum, le moderne Marthègue ou Marthigue et Martigue. #
Le véritable étang de Marthe s'est desséché comme la plupart de nos marécages, mais le nom passa et demeura fort longtemps à la nappe méridionale de notre petite mer de Berre. Le peuple apprit et conserva ce nom d'autant plus volontiers qu'une autre étrangère du même nom, venue dans la barque de Lazare et de Maximim, aborda, dit-on, dans nos parages au siècle suivant. #
En ce pays de France que tant d'invasions recouvrirent, peu de terres conservent le souvenir nominatif des premiers civilisateurs. Plus une race est étrangère, mieux son passage est accusé dans la nomenclature des lieux. À l'autre bout du territoire, en Neustrie, les goths Scandinaves n'ont pas introduit dix vocables dans le patois roman de la province, mais celle-ci s'appelle de leur nom Normandie. Ces Normands ont aussi nommé un certain nombre de villes comme Harfleur, Barfleur, Honfleur, Le Havre. Et le nom général de toutes nos provinces, la France, ne désigne pas le caractère gallo-romain qu'elles ont en commun, mais la petite horde franke qui leur a donné quelques rois. #
Qu'ils soient de Sem ou de Japhet, les barbares errants écrivent leur nom sur les murs. Ils laissent ce nom propre en manière de monument. Le gracieux petit marbre que j'ai décrit résume le précieux apport de la Grèce dans ce district. Toutes les briques du pays comme tous les mots du langage sont le souvenir des Romains dont on conserve aussi plus d'un vestige religieux ; un autel à Junon, retourné et creusé au socle et faisant ainsi office de bénitier dans une église de campagne, porte une dédicace latine à la reine des dieux. Pour tout bien, la syrienne Marthe a marqué de son nom les lagunes qu'elle infesta. #

VIII
Les névropathes sont communément stériles. Est-il sûr toutefois que cette Juive l'ait été ? Son mal sacré n'est-il jamais revenu troubler la région ? N'a-t-elle une ombre maléfique, comme Aristarchê donne le rayon bienfaisant ? Et ne faut-il appréhender l'influence de ses prestiges ? Non plus sous la pourpre, les fleurs et la pique empruntées de Rome, mais nue, le poil dressé, cette sorcière ne refait-elle point son sabbat pendant les nuits d'hiver sur une plage mal séparée des étangs ? L'astrologue Nostradamus est venu mourir à peu de distance d'ici. Il a son tombeau à Salon. Le maréchal ferrant qui vint parler à Louis XIV de la part du fantôme de la reine défunte était né sur les mêmes bords. L'obscur génie de Marthe anima peut-être ces rêves. Si l'on faisait son interrogatoire en règle, il faudrait demander à Marthe quelle fut son action sur les trois grandes catastrophes qui, ayant suivi l'arrivée en Gaule des mœurs et des songes syriens, furent plus ou moins les effets de ces nouveautés douloureuses. #

D'abord, quand une troupe de barbares, d'un autre sang que Marthe, aux corps blancs et aux cheveux roux, se montrèrent sur nos lagunes, les guidait-elle de ses yeux et de ses cheveux sombres ? Mena-t-elle le chœur des étranges pythonisses couleur de lune ? Et si, dès le IXe siècle, cette barbare d'Orient avait fait alliance avec les barbares du Nord, n'y a-t-il pas lieu d'estimer que, au seizième, Marthe dut conspirer pour ce réveil de l'esprit juif et l'impur délire biblique que nous appelons ironiquement la Réforme ? Au XVIIIe siècle, n'était-elle point l'âme de la Révolution ? Qu'une folie se fasse, qu'une faute de goût et de sens insulte au soleil, la présence de Marthe doit être retenue et scrutée avec attention. Toute déraison nous vient d'elle, la rupture des hautes traditions de l'esprit, le retour aux états sauvages. Mais l'influence fut petite. Nos Scandinaves furent vite romanisés. C'est de ligueurs déterminés plus que de huguenots que furent remplies nos murailles, et M. Taine cite un curieux document qui démontre que le pays de Marthe ne comptait pas plus de quatorze sans-culottes en pleine Terreur. Sur dix mille habitants, la proportion paraîtra faible. Elle est toujours assez forte pour témoigner des perturbations que causèrent l'âpre folie de l'Orient, et sa religion sensitive, et le goût de l'orage proposé de la sorte aux esprits fatigués. Les grands malaises historiques s'interprètent, pour notre Occident tout entier comme pour l'étroite bourgade, par les chaleurs du même miasme juif et syrien. #
IX
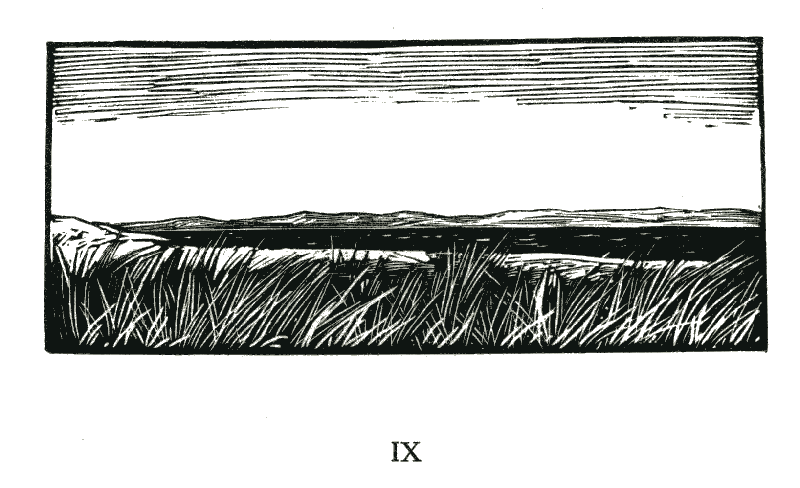
Telle a été l'épreuve. Je ne crois pas qu'elle doive nous inquiéter. La plus ancienne Grèce a connu avant nous cette molle et funeste écume de l'Asie. Elle aurait pu la dissoudre et la rejeter ; son vif esprit jugea préférable de l'employer dans le concept sublime de sa Vénus marine et ainsi de tirer du principe de toutes les tempêtes de l'âme une divinité rayonnante qui les apaise. La lumière qui brille sur le front des héros ne vient que des luttes antiques accrues du sentiment d'un triomphe définitif. La nature des terres grecques se prononçait pour la réussite de ses enfants. Si la nature de notre pays le veut, nous aurons le même bonheur. #
De nos bas-fonds déserts, de ces platitudes fiévreuses où l'enfance du monde se recommence à l'infini, il ne faut pas marcher longtemps pour gagner les hauteurs où l'ordre se construit et se continue ; tout le temps du trajet, le ciel, le vent, les astres sont des guides et des amis : #
« Courage, disent-ils, tes premières folies sont les mères de ta sagesse. Tu veux la vérité, ton erreur en est le chemin ! Ta race antique n'est point lasse, et ton vieux sang n'est pas aigri. Le feu, tant qu'il flamboie, la vie, tant qu'elle brûle, sont la noble substance qui s'épure en se dévorant. Ton esprit qui veut vivre élimine de toi tout ce qui n'est pas le meilleur. #
« Courage, le filet des pêcheurs, tes amis, est redescendu sous l'eau vive. Le pic des charpentiers heurte à coups sourds contre la cale des navires en construction, et les calfats armés de torches de résine secouent ces lueurs dans le soir. Bientôt les jeunes filles aux hanches balancées se seront mises en route pour la fontaine. Au même instant qu'une agonie se résoudra, le soupir de l'amour prophétisera des semences. Tu peux vérifier qu'il n'y a nulle part une chose si humble qui ne soit animée d'un immense vœu de grandir. Va, personne n'en désespère. Rejoins donc ta prêtresse et, auprès d'elle, oublie tout ce qui n'est pas de son chœur. Plein des forces d'en bas, demande à sa lumière un modèle de leur usage. Le corps de l'Éphésienne scintille comme Diane sur le plus voisin des coteaux. Aristarchê t'attend pour t'initier au mystère et le chant de sa lyre te révèle déjà une enceinte de la cité. » #
L'Âme des oliviers
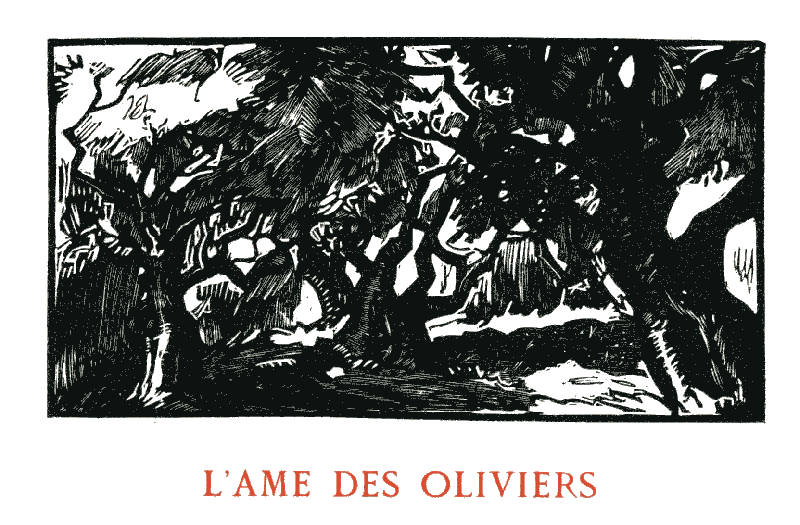
À Lucien Carpechot.
J'ai gravi aujourd'hui le tertre qui domine toute cette contrée. Son sommet, garni d'un ermitage et d'une chapelle, porte de vieux cyprès taillés par la foudre et le vent. À mi-côte s'étend un bois de pins, blond de lumière à ses touffes supérieures ; il traîne dans la nuit ses extrémités retombantes. Enfin, vers le soubassement de la colline est un long verger d'oliviers. Égales pour la gloire, ce sont trois races d'arbres bien inégales en beauté, car l'olivier passe de beaucoup les deux autres. Mais des traits qui leur sont particuliers distinguent les blancs oliviers de ce lieu. #
Supérieurs au type ordinaire de ce bel arbre, ils montraient parmi les ondoiements de leur cime une beauté plus rare, un signe de vigueur et de perfection qu'ils ne font apparaître qu'en des circonstances choisies ; je leur vis le souple bouquet, frêle comme un bourgeon, dense et resserré comme un fruit, que se plaisait à reproduire la sculpture des Athéniens. Le ciseau des Attiques n'a aimé que l'exquis. Il nous conserve encore une fleur même de la fleur. Je me mis à l'étude du chef-d'œuvre de la nature éclos dans le sol maternel. Les purs rameaux me suspendaient amoureusement à leur forme, mais, en me révélant avec largesse ce trésor, les mystérieux petits arbres ajoutaient le conseil de les louer tout bas. Élevant à l'enthousiasme, ils recommandaient la pudeur. #
« Pampres de Bacchus, pourquoi m'étreignez-vous ? Ôtez vos raisins, je suis vierge et ne m'enivre point. » Ainsi, se plaint chez un poète de l'Anthologie l'arbre chaste et sauvage qu'on voulait charger de présents. Comme il eût écarté, lui aussi, la grappe et le pampre, l'olivier provençal me faisait modérer les signes de ma religion. Mais le goût, la pudeur devaient être vaincus par la force d'un souvenir. L'olivier m'apparut, tel que je l'avais vu antérieurement un matin de jeunesse impétueuse et concentrée, épanoui dans le point central de mes songes qu'agitait le frisson de la silhouette argentée… Réminiscence de Platon, de Renan et de France, que je suivais alors tous trois, l'ancienne invocation se répéta presque telle quelle dans ma pensée. #
« Petit arbre nerveux et pâle, lui disais-je, en modifiant à peine le premier texte, vous que néglige le vulgaire et qu'il a bien soin d'insulter ; un rare privilège vous défend, olivier, de flatter l'indigne regard. Je vous refuse tout honneur de la part de ceux qui n'en méritent aucun ; moins ils vous considèrent, plus il vous appartient d'exceller dans votre ordre, délice des cœurs exercés. #
« Vous nouez vos racines au-dessus de la terre, mais vous les enfoncez fort avant dans un sol léger et aride comme l'esprit. Si votre tronc est court, s'il élève peu de rameaux, sous une écorce délicate, le plus frêle est solide et plein de vigueur. De tronc rugueux, de rameaux lisses, lent à croître, long à mourir, ainsi que la sagesse, le dieu qui vous habite a l'âme curieuse. Pour atteindre à la paix, il est ennemi du repos. Comme les sentinelles et les coureurs de nuit, il se maintient par la sensibilité vigilante. Mais chaque pas des heures touche sa verte lyre du frémissement infini, le moindre ébranlement de votre air lui donne la fièvre, et personne ne montre plus de résignation à ce qui n'a point de recours. Ni langoureux abattement, ni vaine révolte ; tous les fléaux ajoutent un éloge à votre vertu et, des pires injures qui lui tombent du ciel, votre automne compose un amer et généreux fruit. #
« Que votre bois, olivier, ait notre cantique, car les premières crosses des pasteurs en sont façonnées. Les rois pères des peuples vous ont pris le sceptre amical. Lorsque Thersite alla prêcher une confusion de pouvoirs qui eût imposé l'anarchie, c'est avec vous qu'Ulysse punit le bavard impudent, c'est à coups d'olivier que lui furent scandées les inestimables doctrines : — Le gouvernement de plusieurs n'est pas bon. Qu'il y ait un seul chef, un roi... À Ithaque, dans sa maison, au centre d'une cour, s'ouvrait le plus beau d'entre vous. Ayant été ployé et débité des mains d'Ulysse, il devint son lit nuptial et l'arbre, dont le tronc et la maîtresse branche n'avaient été ni déplacés, ni retranchés de leurs racines, mais abrités d'une toiture et clos de toute part, connut l'hymen de Pénélope, sa défense innocente et la chasteté de sa foi. #
« Telle étant sa substance, votre feuille, olivier, porte en sa couleur double le signe de la vérité. Son ovale acéré défie le reproche et sa coupure nette ne redoute aucun examen. Toutefois, épaissie en touffes légères qui tremblent, elle se mêle à tous les fantômes de l'air. Des sophismes pressés y confondent leur aile grise, les nuances subtiles y décrivent agilement un mystère discret qui ne peut tenter le profane. L'œil du peuple ne voit qu'un bouquet confus et cendré ; mais, voisins des dieux, les paysans taillent ou courbent chaque plant selon la forme des cratères, et le Sage qui passe une fois ou deux chaque siècle, n'en pourra nier la leçon. #

« Que l'amandier bacchique anime son branchage de grimaces désespérées ; que le cyprès, du flanc d'une métairie solitaire, élève sa colonne blanche et noire contre le jour ; que le pin turbulent se précipite en indiscernables troupeaux : ô nobles oliviers, il ne saurait vous plaire d'interrompre d'aucun dissentiment la courbe déliée des collines de nos pays. Non, vous faites corps avec elle. Ni ennui, ni orgueil ne vous jetteraient au désert, et vous vous aimez trop, car vous vous sentez trop bien vivre, pour vous mêler les uns dans les autres, comme ces pins. Énergies, mais indomptables, ô Patiences, mais redressées, Constances, Industrie, plus que fertiles Inventions, osant tout et tout supportant, mais tout méprisant au besoin, vos mépris n'ont été durables qu'à l'égard du crime inutile, l'Excès. #
« Distant des bas fonds et des crêtes, c'est en chœur, oliviers, qu'il vous intéresse d'aller. Sans vous presser l'un l'autre, sociables rameaux qui communiquez entre vous, vous aimez vous toucher en rendant un son qui ressemble aux discours de la Mer intelligemment mesurée et des hommes qui la longèrent. Vous savez une langue bien accordée à l'âme. Parole et pensée n'y font qu'un, et le même mot les révèle, pensée toujours conduite à la perfection de son signe, mais signe plein et dense, vertueux et signifiant 6. #
« Distant des bas fonds et des crêtes, c'est en chœur, oliviers, qu'il vous intéresse d'aller. Sans vous presser l'un l'autre, sociables rameaux qui communiquez entre vous, vous aimez vous toucher en rendant un son qui ressemble aux discours de la Mer intelligemment mesurée et des hommes qui la longèrent. Vous savez une langue bien accordée à l'âme. Parole et pensée n'y font qu'un, et le même mot les révèle, pensée toujours conduite à la perfection de son signe, mais signe plein et dense, vertueux et signifiant. #
« Fils certains de Pallas, rangées d'yeux pers fleuris des modérations éternelles, athénienne semence qui, à son tour, compose le plus délicat des boutons, vous êtes apparus par la sûre volonté de cette déesse : premiers, derniers maîtres du monde, secoués des déluges et victorieux de la nuit, pacifiques, guerriers, auteurs et enfants des cités, exterminateurs des désordres, extincteurs des barbares nuits, il n'y a point de siècle qui ne vous ait reconnus les pères et les mères de ses destinées favorables. Vos diffuses lueurs étant choses humaines, aucun trouble n'en provenait ; mais quand, formés de votre chair et bourrés de vos fruits, les pressoirs épanchèrent un rayon de chrême doré, la Déesse ouvrière en fit éclater son orgueil. Aliment ou breuvage, douce onction de l'athlète ou baume des corps déchirés, elle s'applaudit elle-même et pour que son collaborateur, le peuple athénien, eût sa part de satisfaction, elle lui prit la main et la serra, du geste que le marbre a perpétué. #
« Tout autrement beau que le marbre, soyez-nous, Olivier, le garant animé des assentiments de Pallas. Redites son grand témoignage. Ne vous lassez point d'enseigner ce qu'elle aime et approuve, et comment elle sait sourire à celui qui la sert. L'homme qui la comprend n'a pas besoin d'être encouragé à la suivre. S'il connaît la sagesse, il s'y précipite après vous. Oh ! redoublez l'éclaircissement de votre sagesse ! Sous une pâle armure d'émeraude voilée, annoncez la brillante agoniste de la raison, paranymphe de l'homme qui, digne de son nom, apprivoise, domine, conduit ses frères bestiaux. Bel ordre des Sciences et fine mesure des Arts, gardez-en, communiquez-en plus que n'en veut, plus que n'en souffre l'imbécile dégénéré. Sur les coteaux où procèdent vos théories, rien ne pourra se perdre ; du moment que vous subsistez, la Merveille du monde ne s'abîmera qu'avec vous ! » #

Ici, Maurras renvoie à une note (numéro IV) de l'Appendice d'Anthinéa, que nous reproduisons ci-après :
La barque de Carro
J'ai raconté l'émouvant sauvetage accompli, le 11 janvier 1901, à la bouche du Rhône, par douze matelots attachés au port de Carro. Le récit, paru dans la Gazette de France, m'a valu une intéressante lettre de Mistral. Toujours préoccupé d'ajouter les gloires du passé à la force de l'avenir, le grand poète provençal a proposé d'élever un nouveau marbre sur l'emplacement du bas-relief d'Aristarchê :
« Vous dites, m'écrit-il, qu'à Carro, en 1802, fut trouvé le bas-relief d'Aristarchê, représentant la prêtresse d'Artémis, qui accompagna les Phocéens fondateurs de Marseille ; pourquoi, en ce lieu, ne consacrerait-on pas une stèle de marbre à la sainte prouesse des hommes de Carro ? Et pourquoi la commission qui donne tous les ans aux élèves des beaux-arts, concourant pour le prix de Rome, des sujets tirés des fastes de l'antiquité grecque ou romaine ou biblique, ne choisirait-elle pas pour sujet de concours la Barque de Carro !
« Les mâles têtes de nos pêcheurs, leur costume primitif, leur superbe débraillé se prêteraient à la sculpture autant et beaucoup mieux que le conventionnel antique.
« Tout à vous et aux braves qui nous ont tant émus. F. MISTRAL. »
L'île Marseillès où fut trouvé le bas-relief d'Aristarchê est très voisine de Carro. Le bas-relief d'Aristarchê est déposé à l'Académie de Marseille et rien, dans le pays, ne rappelle le souvenir de ce petit marbre, pas un monument, pas une inscription. Je ne l'ai connu et recherché, pour ma part, qu'après lecture d'un chapitre de la Statistique des Bouches-du-Rhône du comte de Villeneuve, préfet de Marseille sous la Restauration.
(n. d. é.) [Retour]
Pour compléter les lois, il faut des volontés (Auguste Comte). [Retour]
Le Commandant Espérandieu y voit un enlèvement d'Hélène. [Retour]
Le moyen âge en a fait Sainte Victoire. Mais nos marins ne connaissent ni la Sainte ni la Déesse. Ils disent dalubre ou delubre, n'ayant gardé mémoire que du temple, Delubrum Victoriae, qui brillait autrefois comme le flambeau du pays. [Retour]
On retrouvera l'écho de cette phrase « faustienne » dans Le Mont de Saturne, à la fin du chapitre VIII. (n. d. é.) [Retour]
ΛOΓOΣ, VERBUM, RESOUN. [Retour]
